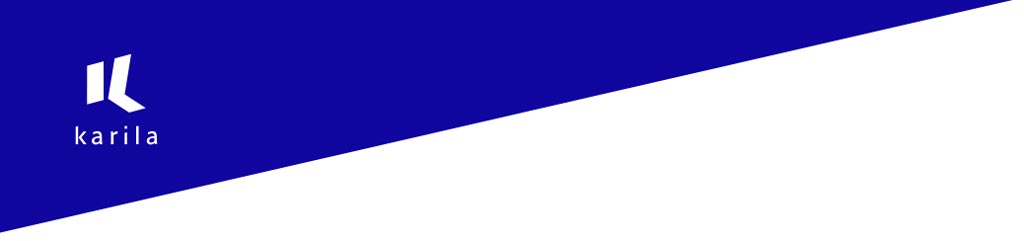La responsabilité pour les désordres affectant des travaux de ravalement ou de peinture – Jean-Pierre Karila – RDI 2001. 201
Sous le régime de la loi du 4 janvier 1978 Sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978, la problématique est différente : elle consiste à déterminer, au regard de l’éventuelle application des garanties légales des articles 1792 et 1792-2, et/ou encore 1792-3 du code civil, si l’on est en présence d’un ouvrage au sens de l’article 1792, ou d’un élément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2, ou enfin d’un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3. Les travaux de ravalement étant a priori insusceptibles de relever du domaine d’application de l’article 1792-2 du code civil, la question s’est essentiellement posée de savoir si lesdits travaux étaient ou non constitutifs de la construction d’un ouvrage (article 1792 c. civ.), ou encore d’un élément d’équipement dissociable du bâtiment (article 1792-3 c. civ.). Mais il y a ravalement et ravalement, ce qui explique et justifie que la jurisprudence ait tantôt refusé de qualifier les travaux de ravalement d’ouvrage ou d’élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, tantôt retenu l’une ou l’autre de ces qualifications. Si le ravalement consiste en un simple « toilettage »/nettoyage des façades d’un immeuble, alors il est clair que l’on ne peut pas qualifier les travaux correspondants de construction d’un ouvrage, comme l’a énoncé la Cour Suprême dans un arrêt remarqué en 1985 ci-dessus évoqué (Cass. 3e civ., 5 févr. 1985, Bull. civ. III, n° 21), la responsabilité de l’entrepreneur « tenu à une obligation de résultat », selon les termes mêmes de l’arrêt, ne pouvant relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, solution réitérée en 1993 par la Cour Suprême (Cass. 1re civ., 7 juill. 1993, RGAT 1994.179, note H. Périnet-Marquet), et reproduite depuis par les juges du fond  (2). (2).Si, en revanche, le ravalement a notamment pour objet d’assurer l’étanchéité des façades, alors les travaux correspondants sont constitutifs de la construction d’un ouvrage, et partant, relèvent des garanties légales, en particulier de celle édictée par l’article 1792 du code civil, comme l’a admis, en des termes plus ou moins clairs, la Cour Suprême dans certains arrêts. C’est ainsi que la Cour Suprême a notamment : • validé (Cass. 3e civ., 3 mai 1990, Bull. civ. III, n° 105) une décision d’une cour d’appel, à laquelle il était reproché une violation de l’article 1792 du code civil, pour avoir retenu la garantie décennale pour des désordres affectant des travaux de ravalement d’un bâtiment, et ce, au considérant ci-après rapporté « Mais attendu que la cour d’appel qui, statuant sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978 applicable en la cause, a, pour motifs propres et adoptés, constaté qu’il avait été appliqué sur le bâtiment C, dans le cadre de sa rénovation, un enduit extérieur destiné à constituer une couche protectrice étanche à l’eau, dont la fissuration entraînait des infiltrations, a, par ces seuls motifs, d’où il résulte que les travaux intéressaient un élément constitutif du bâtiment C et que les désordres constatés rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, légalement justifié sa décision de ce chef. » • cassé (Cass. 3e civ., 5 janv. 1994, RGAT 1994.575, note J.-P. Karila), au visa de l’article 1792, une décision d’une cour d’appel, qui, pour mettre hors de cause un assureur de responsabilité décennale, relativement à des désordres affectant des travaux de ravalement, s’était contentée de retenir que : « S’agissant de rénovation de bâtiments anciens, la responsabilité contractuelle de droit commun était applicable », reproche étant, en conséquence, fait à la cour d’appel d’avoir statué ainsi : « sans rechercher si les désordres de décollement d’imperméabilisation, notamment constatés, ne rendaient pas les immeubles impropres à leur destination » et de n’avoir pas ainsi : « donné de base légale à sa décision ». Les juges du fond procèdent à la même analyse, retenant la qualification d’un ouvrage, et partant l’application de la garantie décennale quand les travaux de ravalement comportent une fonction d’étanchéité et que celle-ci est atteinte  (3). (3).La jurisprudence administrative applique les mêmes principes, en retenant la garantie décennale lorsqu’un ravalement comporte l’application sur les façades d’un enduit destiné à assurer l’étanchéité des façades (CE, 3 janv. 1988, Sté J.-P. Palaud, SA Raub, req. n° 58876), ou la responsabilité contractuelle de droit commun, lorsque les travaux de ravalement constituent de simples travaux de nettoyage des façades, l’entrepreneur n’ayant alors pas la qualité de constructeur d’un ouvrage (CAA Paris, 6 juill. 1995, SARL Onyx, Entreprise Rec., CE, Tables, p. 903 ; AJDA 1996.241, obs. J.-P. Praitre, p. 195  ). ).Le critère d’application de la garantie décennale serait en conséquence la fonction d’étanchéité des travaux de ravalement. Néanmoins, un arrêt de la Cour Suprême du 20 juillet 1999, non publié au bulletin des arrêts civils de la Cour Suprême (Cass. 3e civ., 20 juill. 1999, Juris-Data n° 03128, RDI 2000.55 ; obs. Ph. Malinvaud  ), casse, pour défaut de base légale, un arrêt d’une cour d’appel qui avait justement refusé l’application de l’article 1792 du code civil, et retenu la responsabilité contractuelle de droit commun, au seul motif que le produit utilisé n’était pas un produit d’étanchéité. ), casse, pour défaut de base légale, un arrêt d’une cour d’appel qui avait justement refusé l’application de l’article 1792 du code civil, et retenu la responsabilité contractuelle de droit commun, au seul motif que le produit utilisé n’était pas un produit d’étanchéité.On ne saurait en déduire, comme l’observe Monsieur Ph. Malinvaud, que la solution antérieure est renversée, mais plutôt comprendre que le ravalement peut être la construction d’un ouvrage dans un certain nombre d’hypothèses, au nombre desquelles il faut, en principe, retenir le cas où les travaux ont pour objet d’assurer l’étanchéité de l’ouvrage, mais ce n’est pas le seul cas. La fonction d’étanchéité ne serait en conséquence pas l’unique critère de qualification de la notion d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil. Les travaux de ravalement peuvent en effet, dans certains cas, et alors même qu’ils ne comportent pas l’adjonction d’un produit hydrofuge, constituer la construction d’un ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, et ce, d’autant plus que la jurisprudence interprète cette notion de façon extensive, comme l’illustre un arrêt récent de la Cour Suprême, cassant au visa de l’article 1792, du code civil, pour défaut de la base légale, une décision d’une cour d’appel qui avait refusé l’application de ce texte, sans rechercher si des panneaux de clôture ne constituaient pas en eux-mêmes un ouvrage (Cass. 3e civ., 17 fév. 1999, Bull civ. III, n° 38). Ainsi, si l’arrêt précité du 20 juillet 1999 ne remet nullement en cause la solution selon laquelle, dès lors que les travaux de ravalement comportent une fonction d’étanchéité, ils sont constitutifs de la construction d’un ouvrage, il permet en revanche aux juges du fond de retenir la qualification d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil dans certains cas, même en l’absence de toute fonction d’étanchéité. Peut-être ne faut-il pas attribuer trop d’importance à l’arrêt précité du 20 juillet 1999, qui censure, en définitive, seulement un défaut de motivation des Juges du fond. En tout cas, il est clair que l’on ne saurait – dans le cadre de la recherche du point de savoir si l’on est en présence ou non d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil – distinguer et opposer les notions d’étanchéité et d’imperméabilisation. Cette distinction, opérée à l’initiative de certains professionnels pour mieux « vendre » leurs prestations, est en effet purement artificielle et n’a aucun caractère scientifique. Selon ces professionnels, l’étanchéité constituerait une véritable barrière contre la pénétration de l’eau de pluie, même en présence de mouvements de support sur lequel l’enduit est appliqué, tandis que l’imperméabilisation serait d’un moindre effet permettant seulement à l’eau de pluie de ne pas stagner ! En réalité, la norme NFP 84-403 de juin 1989, relative aux « Façades – Revêtements à base de polymères utilisés en réfection des façades de service » décrit, en son article 5 quatre classes de revêtements imperméables (le terme étanchéité n’étant pas employé), dont la quatrième « s’accommode » de façon plus performancielle et sur une épaisseur plus grande « des fissures du support existantes et à venir » : c’est ce dernier revêtement qui est vendu par certains professionnels, comme étant un produit d’étanchéité…, terme non utilisé par la Norme, comme déjà dit ci-dessus, tandis que la Norme NF 84-404-1 DTU 42-1 d’octobre 1993, qui a pour objet de définir les travaux de réfection des façades en service utilisant des revêtements continus d’imperméabilité à base de polymères, souligne, dans un encadré que : « l’appellation « Revêtement d’imperméabilité de façade » recouvre les appellations « Revêtement d’imperméabilisation » et « Revêtement d’étanchéité » ». Il n’y a pas lieu en conséquence d’opposer étanchéité et imperméabilisation. On ne saurait non plus – comme certains auteurs ont tendance à le faire – estimer qu’en définitive, l’impropriété à destination des travaux de ravalement serait le critère d’application de la garantie décennale, car si l’impropriété à destination est effectivement un critère (parmi d’autres) de l’application de la responsabilité décennale, elle n’est nullement exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun, la ou les véritables lignes de partage entre ces deux types de responsabilité résidant ailleurs (absence ou existence d’une réception de l’ouvrage, absence ou existence de réserves lors de la réception, etc.  (4)) d’une part, tandis que dans tous les cas, la garantie décennale implique d’abord que les travaux considérés soient effectivement constitutifs de la construction d’un ouvrage, d’autre part. (4)) d’une part, tandis que dans tous les cas, la garantie décennale implique d’abord que les travaux considérés soient effectivement constitutifs de la construction d’un ouvrage, d’autre part.Par arrêt du 9 février 2000 (Cass. 3e civ., 9 févr. 2000, Bull. civ. III, n° 27), la Cour Suprême a cassé, pour violation de l’article 1147 du code civil, un arrêt d’une cour d’appel qui : « Pour déclarer irrecevable l’action du Syndicat, retient que les désordres de coulure ne sont qu’inesthétiques et n’atteignent pas la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination, la fonction d’étanchéité n’étant pas atteinte, et que dès lors ils entrent dans le régime de la garantie légale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil dont le délai est en l’espèce expiré » et ce, alors que ladite cour : « avait retenu que les travaux avaient consisté en un ravalement avec une imperméabilisation des façades et pignons, un traitement des fissures non stabilisées, que les désordres affectaient le revêtement de protection et que le syndicat invoquait la faute et la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ». Si la Cour Suprême censure en conséquence clairement la cour d’appel pour n’avoir pas retenu la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, qui était expressément revendiquée, en revanche, elle est muette sur la qualification d’élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil des travaux de ravalement par ladite cour d’appel. On peut néanmoins supposer que la Cour Suprême a implicitement critiqué cette qualification, à défaut de quoi, elle n’aurait pu valider l’arrêt de la cour d’appel, eu égard au principe qu’elle a elle-même posé dans un arrêt de principe du 13 avril 1988, maintes fois réitéré depuis, et selon lesquel : « Même s’ils ont pour origine des non-conformités aux stipulations contractuelles, les dommages relevant d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. » Si donc la Cassation a été prononcée pour violation de l’article 1147 du code civil (par refus d’application comme la Cour Suprême aurait pu le préciser), c’est en raison du fait que la responsabilité contractuelle de droit commun était applicable pour la double raison que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale à défaut d’atteinte à la fonction d’imperméabilité (dont on voit ici qu’elle se confond avec celle d’étanchéité) d’une part, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, les travaux de ravalement, ou encore, pour reprendre la terminologie de la Cour Suprême, le « revêtement de protection » ne pouvant être considérés comme constitutifs d’un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil d’autre part, l’expiration de la garantie biennale de bon fonctionnement édictée par ce texte étant en conséquence totalement indifférente au regard de la problématique ci-avant posée. Aussi, les travaux de ravalement : • soit seraient constitutifs de la construction d’un ouvrage, et dans cette hypothèse relèveraient : – du seul domaine d’application de la garantie décennale, si la condition de gravité impliquée par ladite garantie était avérée ; – ou à défaut de ladite condition de gravité du seul domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun ; • soit ne seraient pas constitutifs de la construction d’un ouvrage, et dans cette hypothèse, ne seraient redevables que de la responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité des dommages les atteignant. Les travaux de ravalement ne pourraient jamais en conséquence relever de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, nonobstant quelques décisions non publiées des juges du fond, la plupart du temps d’ailleurs négatives en ce sens qu’après avoir retenu cette qualification, la demande a été rejetée en raison de l’expiration du délai biennal de l’article 1792-3 du code civil. Le régime juridique de réparation/indemnisation des dommages affectant les travaux de peinture Sous le régime de la loi du 3 janvier 1967 L’article 11 du décret du 22 décembre 1967, pris pour l’application de la loi du 3 janvier 1967 aux bâtiments à usage d’habitation, ou aux caractéristiques similaires, énonce que sont des gros ouvrages notamment les revêtements des murs, à l’exclusion de la peinture et des papiers peints, tandis que l’article 12 dudit décret énonce que sont de menus ouvrages notamment les revêtements de toutes sortes, autres que ceux constituant des gros ouvrages. Il résulte de la combinaison de ces deux textes, dont la jurisprudence a appliqué les principes pour tous les bâtiments, que les travaux de peinture sont des menus ouvrages redevables de la garantie biennale. Néanmoins, lorsque la peinture a une fonction d’étanchéité, on doit considérer qu’il s’agit d’un gros ouvrage, comme cela a été jugé à propos d’une peinture extérieure (Cass. 3e civ., 1er juin 1984, Gaz. Pal. 1984.II, Pan., p. 215), ou d’un polyfilm ayant pour objet d’assurer l’étanchéité des parois d’une salle d’eau (Cass. 3e civ., 4 mai 1976, Bull. civ. III, n° 181), ou encore d’un enduit ne constituant par une simple peinture, mais un véritable revêtement des murs, destiné à les protéger des intempéries et en assurer l’étanchéité et l’isolation (Cass. 3e civ., 3 juin 1981, JCP 1981.IV, p. 298). Etant rappelé que l’article 11 du décret précité fait entrer dans la catégorie des gros ouvrages, d’une manière générale, « les éléments » sans autre précision, qui assurent notamment l’étanchéité. Notre expérience professionnelle nous permet d’affirmer que d’une manière générale, sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967, les juges du fond retenaient la qualification de menus ouvrages, sauf exception, la plupart du temps illustrée en matière de peinture extérieure ayant une fonction d’étanchéité. Sous l’empire de la loi du 4 janvier 1978 La doctrine qualifie la peinture d’élément d’équipement dissociable, ce qui rigoureusement n’est pas inexact, sauf que l’application consécutive de la garantie biennale de bon fonctionnement présente un aspect quelque peu surréaliste, la peinture ne « fonctionnant » pas mal, mais étant simplement atteinte de désordres/défectuosités. Doit-on alors, comme pour les travaux de ravalement penser qu’en l’état du droit positif, la peinture : • soit serait constitutive de la construction d’un ouvrage, et dans cette hypothèse relèverait : – du seul domaine de la garantie décennale si la condition de gravité impliquée par ladite garantie était avérée ; – ou à défaut de ladite condition de gravité, du seul domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun : • soit ne serait pas constitutive de la construction d’un ouvrage et dans cette hypothèse ne serait redevable que de la responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité des dommages les atteignant. Un arrêt de la troisième chambre civile du 27 avril 2000 (Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, Bull. civ. III, n° 88) semble justifier la dichotomie ci-avant opérée : dans l’espèce considérée, le demandeur au pourvoi reprochait à une cour d’appel de l’avoir condamné à réparer des désordres affectant ses travaux de peinture sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que, selon lui, seul était susceptible d’application l’article 1792-3 du code civil instituant la garantie biennale du bon fonctionnement, dont le délai d’action était expiré ; la Cour Suprême rejette le pourvoi validant ainsi l’arrêt de la Cour d’appel, et ce, au considérant ci-après reproduit : « Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, que les peintures, qui n’avaient qu’un rôle esthétique, ne constituaient pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni un élément d’équipement ni un élément constitutif d’ouvrage, et qu’il en résultait qu’elles ne relevaient pas des dispositions de l’article 1792-3 du code civil, la cour d’appel en a exactement déduit que, s’agissant des désordres affectant ces peintures, seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun, quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux, et que l’action engagée de ce chef par la Compagnie des salins du Midi était recevable. » Cet arrêt a le mérite de faire abstraction « des conséquences quant à la destination des lieux »des désordres affectant les peintures, illustrant et justifiant l’avis ci-avant donné selon lequel l’impropriété à destination n’est pas exclusif de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il ne faut pas s’arrêter à la « fonction esthétique », ou encore, si l’on a bien compris l’arrêt, à la fonction exclusivement esthétique de la peinture considérée : en effet, une peinture a toujours une fonction esthétique, quel que soit le résultat au regard de ladite fonction… ; en d’autres termes, ce qui nous semble le plus important, c’est l’affirmation que des peintures ne peuvent constituer, stricto sensu, un élément d’équipement dissociable (implicite sur ce dernier point). L’arrêt précité du 27 avril 2000 est d’autant plus remarquable qu’il a été rendu dans une espèce où les peintures considérées n’avaient pas été mises en oeuvre sur un bâtiment déjà existant, mais dans le cadre de la construction d’un immeuble neuf. On aurait pu en effet penser, à la faveur de deux décisions rendues en 1997 par la haute juridiction de l’ordre judiciaire d’une part, et celle de l’ordre administratif, d’autre part, que, sauf fonction d’étanchéité, les peintures intérieures ou extérieures (ces dernières pouvant être appliquées dans le cadre de travaux de ravalement) réalisées dans le cadre d’un ouvrage existant – hors le cas de rénovation dite « lourde » – relevaient nécessairement de la seule responsabilité contractuelle de droit commun, tandis que dans le cadre d’une opération de construction neuve, lesdits travaux étaient a priori susceptibles de relever des garanties légales, notamment de la garantie biennale de bon fonctionnement. La cour de cassation avait, en effet, le 29 janvier 1997 (Cass. 3e civ., 29 janv. 1997, RGDA 1997.515, note A. d’Hauteville), validé un arrêt d’une cour d’appel qui avait écarté, pour l’application d’une peinture extérieure d’un bâtiment déjà existant, n’assurant pas l’étanchéité de celui-ci, la garantie décennale, en énonçant qu’un tel travail « ne constitue pas un travail de construction d’un ouvrage relevant des articles 1792 et suivants du code civil », la Cour Suprême énonçant par ailleurs, et en réponse à l’une des branches du moyen unique de cassation, qui reprochait à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si les désordres dénoncés ne ressortissaient pas de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 dudit code, que ladite cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes sur la garantie biennale de bon fonctionnement. Tandis que le Conseil d’Etat, le 18 juin 1997 (CE, 18 juin 1997, OPHLM Ville du Havre, req. n° 126612, Rec CE, p. 79 ; RDI 1998.89, Obs. Llorens et Terneyre  ) avait validé un arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait écarté la garantie décennale, à propos de la réfection de la peinture extérieure des huisseries d’un bâtiment, au motif que lesdits travaux de peinture « n’ont pas été réalisés à l’occasion de la construction ou de la reconstruction de cet immeuble ou d’une partie de cet immeuble » ) avait validé un arrêt d’une cour administrative d’appel qui avait écarté la garantie décennale, à propos de la réfection de la peinture extérieure des huisseries d’un bâtiment, au motif que lesdits travaux de peinture « n’ont pas été réalisés à l’occasion de la construction ou de la reconstruction de cet immeuble ou d’une partie de cet immeuble » (5). (5).Dans un article publié en septembre 1998 dans d’autres colonnes  (6), nous avions, commentant l’arrêt précité de la Cour Suprême du 29 janvier 1997, écrit : (6), nous avions, commentant l’arrêt précité de la Cour Suprême du 29 janvier 1997, écrit :« Gageons que si la même peinture (absence de toute fonction d’étanchéité) avait été appliquée à l’occasion de la constuction d’un immeuble, la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil aurait été retenue. » Cette « prédiction » est démentie par l’arrêt précité du 27 avril 2000… Ainsi, comme pour les travaux de ravalement, on peut dire que les travaux de peinture ne relèvent en aucun cas de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais nécessairement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf exception, en cas notamment de fonction d’étanchéité, auquel cas lesdits travaux de peinture seront considérés comme constitutifs de la construction d’un ouvrage, et seront alors susceptibles de l’application de la garantie décennale, si les dommages les affectant sont bien de la nature de ceux visés dans l’article 1792 du code civil. Vers l’éviction de l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement en cas d’élément d’équipement inerte Appliquer la garantie biennale de bon fonctionnement à des éléments d’équipement inertes comme les travaux de ravalement, des peintures, des moquettes, des faux-plafonds, des cloisons, etc., peut heurter le bon sens.L’idée de fonctionnement renvoie en effet à une idée de mouvement, ou encore de machines ou d’appareils, que ne sont à l’évidence pas les éléments d’équipement inertes précités. Sous l’empire de la loi du 3 janvier 1967, de tels éléments d’équipement entraient incontestablement la plupart du temps dans la catégorie des menus ouvrages, et relevaient en conséquence de la garantie biennale des menus ouvrages, laquelle n’était pas applicable – comme d’ailleurs également la garantie décennale – aux éléments d’équipement dynamiques, tels que les appareils mécaniques ou électriques que l’entrepeneur installe en l’état où ils lui sont livrés, l’article 13 du décret du 22 décembre 1967 énonçant expressément que de tels appareils ne sont pas considérés comme des ouvrages. Ce n’est en conséquence que par « réflexe » ou par habitude qu’il a été estimé que les éléments d’équipement inertes – auparavant soumis à une garantie biennale – entraient normalement dans le champ d’application de la nouvelle garantie biennale, alors que celle-ci n’est applicable qu’en cas de « mauvais fonctionnement » d’une part, et qu’à l’évidence, un faux plafond, une peinture, une moquette, etc. « ne fonctionnent » pas bien ou mal, mais sont ou ne sont pas atteints de désordres/défectuosités, d’autre part. Certes, tout dysfonctionnement d’un élément d’équipement dissociable, au sens de l’article 1792-3 du code civil, peut entraîner l’application de la garantie décennale édictée par l’article 1792 dudit code, s’il a pour conséquence de rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, en sorte que déjà, le domaine d’application de l’article 1792-3 code civil apparaît comme résiduel. Mais l’éviction des dispositions de l’article 1792-3 du code civil peut être opérée aussi au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, lorsque l’on est en présence d’éléments d’équipement inertes, comme c’est le cas dans certains des arrêts précités, et ce, tant à l’occasion de désordres peu graves (arrêt du 9 févr. 2000 pour les travaux de ravalement, arrêt du 29 janv. 1997 pour des peintures) qu’à l’occasion de désordres présentant une certaine gravité au regard de la destination des lieux (arrêt du 27 avr. 2000 pour les travaux de peinture). Déjà, dans le fameux arrêt Maisons Enec du 22 mars 1995  (7), la troisième chambre civile avait pu retenir l’applicabilité de la responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres peu graves affectant des cloisons (défaut d’aplomb), et des plafonds (défaut de planimétrie) évinçant donc, comme l’avait finement observé M. Périnet-Marquet dans son commentaire dudit arrêt (RGAT 1995.119), la garantie biennale de bon fonctionnement pour un élément d’équipement inerte, à l’inverse de ce qui avait été estimé par les juges du fond et la Cour Suprême elle-même (à propos d’un faux-plafond : Cass. 3e civ., 7 déc. 1998, Bull. civ. III, n° 174), M. Périnet-Marquet y décelant alors « un infléchissement, pour ne pas dire un revirement de jurisprudence », observant par ailleurs que dans l’arrêt précité du 7 décembre 1988 relatif aux faux-plafond, la Cour Suprême « avait dévié le sens du texte (7), la troisième chambre civile avait pu retenir l’applicabilité de la responsabilité contractuelle de droit commun pour des désordres peu graves affectant des cloisons (défaut d’aplomb), et des plafonds (défaut de planimétrie) évinçant donc, comme l’avait finement observé M. Périnet-Marquet dans son commentaire dudit arrêt (RGAT 1995.119), la garantie biennale de bon fonctionnement pour un élément d’équipement inerte, à l’inverse de ce qui avait été estimé par les juges du fond et la Cour Suprême elle-même (à propos d’un faux-plafond : Cass. 3e civ., 7 déc. 1998, Bull. civ. III, n° 174), M. Périnet-Marquet y décelant alors « un infléchissement, pour ne pas dire un revirement de jurisprudence », observant par ailleurs que dans l’arrêt précité du 7 décembre 1988 relatif aux faux-plafond, la Cour Suprême « avait dévié le sens du texte  (8)en précisant que le plafond (8)en précisant que le plafond  (9)ne répondait pas à sa fonction. Elle avait ainsi insensiblement franchi le Rubicond qui sépare le statique du dynamique ». (9)ne répondait pas à sa fonction. Elle avait ainsi insensiblement franchi le Rubicond qui sépare le statique du dynamique ».En réalité, la cour d’appel avait affirmé que « ni les cloisons intérieures de l’immeuble, ni les plafonds ne peuvent être définis comme des éléments d’équipement », ce qui n’avait pas été discuté devant la Cour Suprême, en sorte que l’éviction de la garantie biennale de bon fonctionnement n’a pas été opérée à raison du fait que les éléments d’équipement considérés étaient inertes, mais en raison de ce que les cloisons et plafonds ont été considérés comme ne constituant pas des éléments d’équipement. Nonobstant ce qui précède, si l’on admet qu’il existerait désormais un mouvement général pour l’éviction de la garantie biennale de bon fonctionnement en cas de désordres/défectuosités d’éléments d’équipement dissociables/inertes, ceux-ci ne pourraient alors désormais relever, comme l’a vu ci-dessus, que de la garantie décennale au cas où ils seraient eux-mêmes constitutifs de la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil d’une part, et seraient atteints de désordres graves d’autre part, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun, quelle que soit la gravité des désordres lorsqu’ils ne seraient pas constitutifs de la construction d’un ouvrage, le domaine de ladite responsabilité contractuelle de droit commun ne se limitant pas à la catégorie des dommages peu graves, dits « intermédiaires », et pouvant être appliquée à des désordres graves ne relevant pas de la garantie décennale. Il reste à s’interroger sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun qui serait alors encourue, ainsi que sur sa durée. Sur le régime, on assiste à une certaine hésitation, ou encore à certaines incohérences de la jurisprudence au regard de la stricte logique ou orthodoxie juridique : si en effet, sous les régimes antérieurs à la loi du 4 janvier 1978, il était énoncé par référence expresse ou implicite (la plupart du temps) à l’ancien article 2270 du code civil, que ladite responsabilité était encourue en cas de faute prouvée, cette dernière exigence (nécessité de rapporter la preuve d’une faute) pour des marchés relevant de la loi du 4 janvier 1978 est moins évidente, dès lors que le recours au nouvel article 2270 est désormais impossible (celui-ci ne visant que les responsabilités et garanties spécifiques instituées et organisées par les nouveaux textes, soit les articles 1792, 1792-2 et 1792-3), seul l’article 1147 du code civil, dont on ne peut dire qu’il serait le texte de référence en matière de responsabilité pour faute prouvée, étant susceptible d’application. Ajoutons à cela qu’un même désordre qui relèverait de la garantie de parfait achèvement, en raison de sa date de survenance comme de celle de l’action dont il serait l’objet (c’est-à-dire à l’intérieur du délai de ladite garantie), serait réparé/indemnisé en l’absence de la démonstration de toute faute eu égard au caractère automatique de la garantie, mais ne pourrait l’être, si l’action est engagée postérieurement à l’expiration de la garantie de parfait achèvement, qu’en cas de faute prouvée… comme nous l’avons déjà relevé dans d’autres colonnes  (10). (10).Quant à la durée de cette responsabilité contractuelle de droit commun, si très rapidement sous l’empire des textes antérieurs à la loi du 4 janvier 1978, un arrêt du 11 juin 1981 (Cass. 3e civ., 11 juin 1981, Bull. civ. III, n° 120), était venu préciser qu’elle pouvait être mise en oeuvre pendant 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage sans réserve, par référence expresse à l’article 2270 du code civil, il n’était pas évident qu’il devait en être ainsi en marge des garanties légales issues de la loi du 4 janvier 1978 pour les mêmes raisons que ci-avant évoquées, c’est-à-dire en l’absence de tout support légal par suite de la disparition de l’ancien article 2270 du code civil et de sa substitution par un texte nouveau ne visant que les garanties spécifiques visées aux articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil. On observera à cette occasion que le fameux arrêt Maisons Enec est muet sur la durée de cette responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ; néanmoins, certains auteurs affirmaient avant l’arrêt précité Maisons Enec, et continuent d’affirmer, sans la moindre démonstration ou fondement juridique quelconque, que cette responsabilité est d’une durée de 10 ans ! Mais l’on sait que la Cour Suprême retiendra, sans fondement légal spécifique, à la prochaine occasion, ladite durée de 10 ans… On peut relever que déjà la Cour Suprême a validé implicitement ladite durée de 10 ans dans le cadre de l’arrêt précité du 27 avril 2000, en rejetant le premier moyen du pourvoi qui reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de droit commun et déduit « que l’action ainsi soumise à la prescription de 10 ans était recevable ». |
| Mots clés : RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS * Responsabilité de droit commun * Ravalement * Peinture * Responsabilité décennale * Ravalement * Etanchéité * Peinture * Etanchéité |
(1) Sur la question, voir J.-P. Karila Garanties légales et responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage immobiliers après réception de l’ouvrage, D. 1990, Chron. P. 307 et suivantes  . .(2) CA Versailles, 6 nov. 1987, RDI 1988.301, obs. Ph. Malinvaud et B. Boubli ; CA Paris, 11 janv. 1988, Rev. Administrer juin 1988, note Franck) ; CA Paris, 23e ch. A, 15 sept. 1999, AXA Courtage c/ Guillou et autres, qui énonce que bien que d’un coût élevé, le ravalement n’avait pas pour fonction de protéger ou de restaurer une maçonnerie préexistante en mauvais état, l’enduit utilisé n’étant pas un produit hydrofuge, et juge que ledit ravalement remplissant une fonction esthétique et non d’étanchéité ou de protection thermique, ne constitue pas un ouvrage ressortissant de la garantie décennale des constructeurs de l’article 1792 du code civil. (3) CA Paris, 6 juill. 1994, Juris-Data n° 022800 ; CA Paris, 18 janv. 1996, Juris-Data n° 020006 ; CA Aix-en-Provence, 24 mai 1994, Juris-Data n° 43642 ; CA Aix-en-Provence, 11 janv. 1994, Juris-Data n° 040136 ; CA Aix-en-Provence, 13 févr. 1996, Juris-Data n° 040581 ; CA Paris, 16 juin 2000, Juris-Data n° 118281. (4) Voir sur cette question nos observations dans la chronique précitée. (5) La décision a été rendue sous l’empire des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 dans leur rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967, mais la solution est parfaitement transportable à l’article 1792 dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978. (6) Garanties des constructeurs. Quelles responsabilités encourues pour les travaux de ravalement ou la peinture ? par J.-P. Karila, MTP du 4 sept. 1998. (7) Bull civ. III, n° 80 ; JCP éd G. 1999 Jurisp. 22416 avec rapport de Joëlle Fossereau. (8) Article 1792-3. (9) En réalité faux-plafond. (10) J.-P. Karila, Bilan des responsabilités et garanties spécifiques des constructeurs et fabricants en matière immobilière, AJP 1997, p. 4 et suivantes  . . |