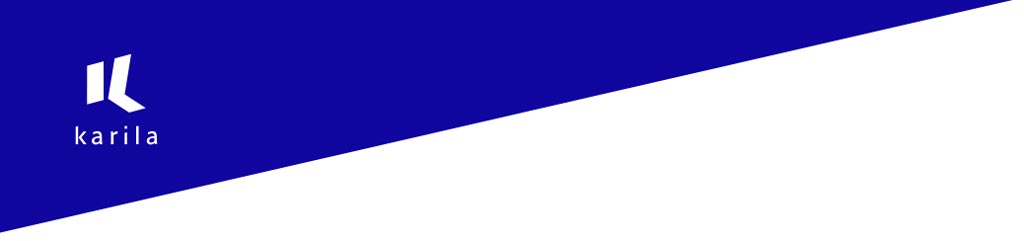Ancien ID : 111
Jean-Pierre Karila
A Joëlle FOSSEREAU,In memoriam.
La 3ème chambre civile a rendu le 16 octobre 2002, deux arrêts importants constituant une étape décisive, mais non ultime, de la volonté de la Cour Suprême de voir uniformiser les délais d’action des différentes responsabilités encourues par les constructeurs d’ouvrages immobiliers.
Lesdits arrêts, objet d’un excellent commentaire de Monsieur PH. Malinvaud seraient, selon la formule d’un haut conseiller de la 3ème chambre civile, en quelque sorte « le testament » de la très regrettée Joëlle FOSSEREAU qui tenait particulièrement à cette uniformisation par l’alignement de la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun sur celle des garanties légales.
Sur ce point, comme beaucoup d’autres, nous partagions son opinion puisque déjà en 1990, nous écrivions :
« Le débat majeur en matière de responsabilité des locateurs d’ouvrages immobiliers n’est pas tant celui de la nature et du régime des diverses responsabilités et garanties spécifiques ou de droit commun auxquelles sont tenus ces professionnels, que celui de la durée de ces responsabilités et garanties, d’une part, et de la prescription qui leur est attachée, d’autre part ».
Pour poursuivre dans les termes suivants :
« La jurisprudence Blambel préfigurait la garantie biennale. La jurisprudence Delcourt qui fixe sans aucun support légal sérieux une durée de dix ans à compter de la réception pour une catégorie de dommages déterminés, ne permet-elle pas de considérer que, quelle que soit la nature des dommages, toute action en responsabilité est éteinte dans les mêmes conditions que pour ceux relevant normalement des garanties légales «
En 1993, nous décelions cette volonté d’uniformisation des délais d’action, au travers de l’examen de certains arrêts qui seront évoqués ci-après, puis à l’occasion du commentaire d’un arrêt rendu le 17 mars 1993 par la 3ème chambre civile dont nous disions alors « qu’il s’inscrit également dans un mouvement plus large d’uniformisation des diverses responsabilités et garanties pesant sur les locateurs d’ouvrages immobiliers », mouvement poursuivi par les arrêts précités du 16 octobre 2002, et ce dans les conditions que nous proposons de préciser dans le présent article.
L’arrêt Maisons Bottemer énonce deux règles :
– la première, dans un « chapeau intérieur », relative à l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre d’un constructeur de maisons individuelles au titre de désordres, objet de réserves lors de la réception, règle selon laquelle « l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception avec ou sans réserves » ;
– la seconde, selon laquelle l’action du maître de l’ouvrage, dans le délai précité de dix ans, n’a pas pour effet de rendre recevable celle exercée à titre récursoire postérieurement au délai précité de dix ans par ledit constructeur de maisons individuelles à l’encontre de l’architecte.
L’arrêt Grobost énonce quant à lui que « la Cour d’appel a, à bon droit, retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur pour manquement au devoir de conseil, ne pouvait être invoquée, quant aux désordres affectant l’ouvrage, au-delà d’un délai de 10 ans à compter de la réception ».
Le lecteur aura remarqué que dans l’arrêt Grobost, il n’est pas ajouté, comme dans l’arrêt Maisons Bottemer, après le terme réception, « avec ou sans réserves ».
Mais il n’y a pas lieu d’attacher trop d’importance à cette différence, qui sans être le résultat d’une inadvertance, pouvait se justifier dans le cadre de l’espèce où il semble que la réception ait été prononcée sans réserves d’une part, et était relative à l’obligation de conseil d’autre part.
L’essentiel est en effet ailleurs : il est dans l’affirmation que la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun, engagée à propos de désordres affectant l’ouvrage réalisé, ne ressortissant pas, pour une raison ou pour une autre, de la responsabilité décennale, est toujours de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, que ladite réception ait été prononcée avec ou sans réserves.
L’uniformisation des délais ainsi consacrée, n’est donc pas, comme attendu, voire annoncé avant la lettre par une partie de la doctrine, cantonnée au domaine des dommages dit intermédiaires puisqu’aussi bien, dans les deux espèces, les dommages considérés présentaient une certaine gravité de sorte qu’ils auraient pu relever de l’application de la responsabilité décennale, si dans un cas l’action n’avait pas été fondée expressément sur l’obligation de conseil au visa exprès de l’article 1147 du Code Civil (arrêt Grobost) et si dans l’autre les dommages n’avaient pas fait l’objet de réserves lors de la réception (arrêt Maisons Bottemer), raison suffisante pour que leur réparation / indemnisation ne puisse être fondée sur la responsabilité décennale, dont le domaine d’application, comme on le sait, est limité aux dommages clandestins lors de la réception et qui se révéleraient postérieurement au prononcé de celle-ci ou pour le moins dont l’ampleur et les conséquences ne se révéleraient que postérieurement à son prononcé.
A ce dernier titre, c’est-à-dire l’absence d’incidence de l’existence des réserves lors de la réception, quant à la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun et/ou plus précisément quant au point de départ de ladite responsabilité, l’arrêt Maisons Bottemer opère une véritable « révolution » alors même que la solution était déjà acquise légalement en ce qui concerne les garanties et responsabilités spécifiques issues de la Loi du 4 janvier 1978, la computation de tous les délais desdites garanties et responsabilités spécifiques, s’effectuant, sous ce régime, toujours à compter de la date de la réception, que celle-ci ait été prononcée avec ou sans réserve.
Mais en outre, et il s’agit ici aussi d’une véritable « révolution », l’arrêt Maisons Bottemer consacre cette uniformisation des délais également dans les rapports des constructeurs les uns à l’égard des autres, du moins lorsque ceux-ci sont contractuellement liés entre eux, ce que ne révèle pas clairement la lecture de l’arrêt considéré, mais que la lecture des mémoires produits devant la Cour Suprême permet néanmoins d’affirmer.
L’uniformisation n’en est pas pour autant complètement aboutie puisque reste en suspens la question de la durée de la responsabilité de droit commun dans cinq hypothèses :
– celle, de nature contractuelle, dans le cadre de la sanction d’obligations totalement indépendantes de la réception de l’ouvrage, comme les dépassements de prix et de délais ;
– celle, de nature contractuelle, engagée au titre de la réparation / indemnisation des défauts de conformité sans désordre ;
– celle, de nature contractuelle, engagée pour les dommages résultant d’une faute dolosive ;
– celle, de nature extracontractuelle en responsabilité des constructeurs les uns à l’égard des autres lorsqu’ils ne sont pas liés contractuellement,
– celle, de nature ici encore extracontractuelle engagée par le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur à l’égard du sous traitant.
Nous nous proposons en conséquence d’examiner de façon plus approfondie que ci-dessus :
– la genèse de l’évolution de l’alignement de la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun sur celles des garanties légales (I),
– les questions demeurant en suspens et/ou non encore résolues (II).
– I –
GENESE DE L’EVOLUTION DE L’ALIGNEMENT DE LA DUREE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE DROIT COMMUN SUR CELLES DES GARANTIES LEGALES.
On distinguera, quant à ce, selon que l’on se situe en marge des régimes antérieurs à la Loi du 4 janvier 1978, ou en marge de ce dernier régime.
Plusieurs étapes et/ou facteurs d’évolution ont conduit à cet alignement.
A/ En marge des régimes antérieurs à la Loi du 4 janvier 1978 :
Première étape : la jurisprudence Delcourt et ses suites.
a) L’incertitude / l’inquiétude créée par l’arrêt Delcourt du 10 juillet 1978.
Le fameux arrêt Delcourt (5) est muet sur la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre de la réparation / indemnisation des dommages mineurs dits « intermédiaires » se révélant postérieurement à la réception, responsabilité contractuelle de droit commun dont il précise toutefois le régime, savoir responsabilité pour faute prouvée, sans pour autant, mais volontairement, viser un texte quelconque qui aurait pu renvoyer à une durée quelconque.
De sorte que pour reprendre l’heureuse expression de Monsieur G. Liet-Vaux « tous les désespoirs étaient permis » puisqu’aussi bien, la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun est par application de l’article 2262 du Code Civil, trentenaire.
Désespoir et sentiment d’incohérence dès lors que l’arrêt Delcourt pouvait donc logiquement et légitimement conduire à ce que pour les dommages d’une certaine gravité, la durée de la responsabilité engagée soit limitée à dix ans à compter de la réception des travaux, tandis que pour ceux mineurs, elle serait trentenaire à compter d’une date d’ailleurs indéterminée (réception des travaux ou apparition du dommage ).
Incohérence que la différence de régime de la responsabilité encourue, de plein droit ou pour faute prouvée, ne pouvait justifier dès lors que l’exigence de la démonstration de l’existence d’une faute imputable au constructeur poursuivi, ne constitue pas, de facto, une véritable difficulté puisque le Juge statue toujours au vu d’un rapport d’expertise dont l’objet est de déterminer les causes et origines des désordres constatés, et partant met indubitablement en relief, les fautes des différents constructeurs.
Aussi, l’idée selon laquelle dans un cas la brièveté du délai serait la contrepartie d’un régime de responsabilité de plein droit tandis que dans l’autre l’application de la durée de droit commun serait justifiée par la difficulté de rapporter la preuve de la faute du constructeur poursuivi, manque en fait.
b) « L’embellie » produite par l’arrêt du 11 juin 1981 et ses suites.
C’est par un arrêt de la troisième chambre civile du 11 juin 1981 rendu au visa exprès cette fois-ci de l’article 2270 du Code Civil, dont elle faisait alors un texte commun de prescription des garanties légales et de la responsabilité contractuelle de droit commun, que la Cour Suprême a posé la règle selon laquelle ladite responsabilité contractuelle de droit commun au titre de la réparation / indemnisation des dommages mineurs, apparus postérieurement à la réception, était d’une durée de dix ans à compter de la réception des travaux (implicitement sans réserves pour ce qui concerne lesdits dommages, puisque ceux-ci sont par définition comme déjà évoqué ci-dessus, des dommages survenant postérieurement à la réception en raison du caractère occulte du vice lors de celle-ci).
La solution énoncée par l’arrêt du 11 juin 1981 sera par la suite réitérée et confirmée à plusieurs reprises par les Juges du fond et par la Cour Suprême, laquelle utilisera la formule selon laquelle « hormis le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, la responsabilité de droit commun de l’architecte et de l’entrepreneur, pour les non conformités aux règles de l’art ou les vices des gros ouvrages ne portant pas atteinte à leur solidité ou ne les rendant pas impropres à leur destination, ne peut être invoquée que pendant le délai de dix ans après la réception des travaux » .
Deuxième étape : l’anéantissement, de facto, du délai trentenaire de la responsabilité contractuelle de droit commun par l’absorption de celle-ci par les garanties légales.
Par un arrêt de principe du 13 avril 1988 rendu sous l’empire du Code Civil d’origine, mais réitéré en 1989 sous l’empire de la Loi du 3 janvier 1967 la Cour Suprême a posé la règle selon laquelle « même s’ils ont comme origine des non conformités aux stipulations contractuelles, les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Les garanties légales absorbent donc la responsabilité contractuelle de droit commun quand les dommages qui auraient dû faire l’objet d’une action sur ce fondement, présentent les caractéristiques techniques ou de gravité de ceux relevant desdites garanties légales.
Il s’en suit de facto un anéantissement de la durée trentenaire de la responsabilité contractuelle de droit commun par l’éviction de celle-ci au profit des garanties légales d’une durée plus courte, c’est-à-dire dix ans ou deux ans, selon le siège des dommages.
Troisième étape : la généralisation de l’alignement de la responsabilité contractuelle de droit commun sur celles des garanties légales.
Cette généralisation s’est produite dès fin 1991 puis en 1993, à propos de désordres affectant des voiries et réseaux divers (VRD) puis s’est poursuivie en 1994 à l’occasion de la sanction de l’obligation de conseil de l’architecte pour des désordres relevant de la garantie biennale de menus ouvrages, le tout après une période d’inquiétude et d’incertitude créée par un arrêt remarqué du 26 janvier 1983 rendu à propos d’une canalisation extérieure à un bâtiment.
a) L’inquiétude née de l’arrêt du 26 janvier 1983 et ses suites.
Par arrêt du 26 juin 1983 , la 3ème chambre civile cassait et annulait un arrêt de la Cour de VERSAILLES qui avait déclaré irrecevable l’action d’un maître d’ouvrage à l’encontre d’un architecte et d’un entrepreneur, relativement à la réparation / indemnisation d’un menu ouvrage en la circonstance, une canalisation extérieure au bâtiment, en raison de l’expiration du délai d’action de la garantie biennale, la cassation étant prononcée au motif : « … qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la canalisation rompue était située à l’extérieur du bâtiment et alors que la responsabilité contractuelle de droit commun était dès lors applicable, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s’imposaient ».
L’arrêt dont s’agit visant expressément l’article 1147 du Code Civil, il était légitime de penser que pour les canalisations extérieures, la responsabilité était donc toujours d’une durée trentenaire.
Cette jurisprudence était confirmée par les Juges du fond et réitérée par la Cour Suprême .
b) La condamnation implicite de l’arrêt du 26 janvier 1983 et l’alignement de la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun sur celles des garanties légales par la jurisprudence des années 1991 à 1994.
Par un arrêt du 4 décembre 1991 , la 3ème chambre civile cassait pour violation de l’article 2270 du Code Civil en sa rédaction issue de la Loi du 3 janvier 1967, un arrêt d’une Cour d’appel qui avait admis la recevabilité d’une action d’un syndicat de copropriétaires à propos de malfaçons affectant des parcs de stationnement et des canalisations extérieures, au motif que lesdites malfaçons « relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, « la prescription décennale » doit être écartée ». La Cassation est prononcée au considérant ci-après reproduit :
« Qu’en statuant ainsi, alors que, sauf le cas de faute dolosive ou extérieure au contrat, la responsabilité de droit commun des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrages, ne peut être invoquée au-delà des délais prévus à l’article 2270 du Code Civil ».
La formulation ci-dessus reproduite que l’on rapprochera de celle de l’arrêt précité du 3 juin 1987 (10), a une portée infiniment plus large car non limitée aux dommages intermédiaires, ni même aux désordres affectant les VRD, objet de l’espèce, ni encore à la responsabilité décennale puisqu’elle se réfère également à la garantie biennale des menus ouvrages.
La solution comme la formulation qui l’accompagne seront réitérées dans le cadre de l’arrêt précité du 17 mars 1993 (7) lequel ne vise cependant que le « délai » de l’article 2270 du Code Civil à une époque où le texte précité, s’agissant du Code Civil d’origine de 1804, ne visait que le délai de la garantie décennale, la garantie biennale des menus ouvrages n’ayant été instituée que par la Loi du 3 janvier 1967.
Enfin, par un arrêt du 12 octobre 1994 , la 3ème chambre civile rejetait un pourvoi à l’encontre d’une décision d’une Cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action d’un maître d’ouvrage à l’encontre d’un architecte sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de ce dernier, pour manquement à son obligation de Conseil lors de la réception à propos du caractère dangereux de l’installation des prises électriques dans une salle de bains au motif que le délai biennal de l’article 2270 du Code Civil était expiré, s’agissant d’un menu ouvrage.
Le moyen unique du pourvoi sans viser expressément l’article 1147 du Code Civil prétendait néanmoins que l’action qui tend à mettre en cause la responsabilité de l’architecte pour n’avoir pas signalé lors de la réception, les défauts de conformité apparents, n’était pas soumis aux délais de l’article 2270 du Code Civil et prétendait en conséquence à la violation de ce texte par fausse application.
La Cour Suprême qui, depuis 1981, comme ci-dessus rappelé avait fait de l’article 2270 du Code Civil un texte commun de prescription des garanties légales et de droit commun, rejetait en conséquence naturellement le pourvoi au considérant ci-après reproduit :
« Mais attendu que si lourde que soit la faute, la responsabilité contractuelle de droit commun des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage ne peut être invoquée, sauf dol ou faute extérieure au contrat, au-delà des délais prévus à l’article 2270 du Code Civil, en sa rédaction de la Loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ; qu’ayant constaté …. et ayant relevé que les prises électriques affectées d’un vice apparent constituaient de menus ouvrages, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la responsabilité contractuelle de l’architecte, qui avait manqué à son obligation de Conseil en ne signalant pas, lors de la réception, la position dangereuse des prises de courant, ne pouvait plus être invoquée ».
On relèvera ici, mais on ne s’en était pas suffisamment rendu compte, que déjà implicitement et indirectement, la Cour Suprême avait aligné la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun sur celle de la garantie légale qui aurait pu être concernée savoir, la garantie biennale de menus ouvrages si les vices n’avaient pas été apparents lors de la réception, l’absence de réserves lors du prononcé de celle-ci n’ayant pu avoir un effet de purge qu’à l’égard de l’entrepreneur.
On peut donc dire, que dès 1991, puis en 1993 et enfin en 1994 de façon encore plus éclatante, la jurisprudence sur la responsabilité contractuelle de droit commun en marge des garanties légales avait aligné la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun sur celles des garanties légales (deux ans ou dix ans à compter de la réception) sur le fondement de l’article 2270 du Code Civil dont elle avait fait depuis le 11 juin 1981 un texte commun de prescriptions tant relativement aux garanties dites légales qu’à la responsabilité contractuelle de droit commun, du moins en ce qui concerne les dommages à l’ouvrage.
Quoique d’origine prétorienne, cette jurisprudence pouvait trouver alors un fondement légal.
B/ En marge des garanties légales issues du régime de la Loi du 4 janvier 1978 :
Première étape : réitération de l’anéantissement de la durée trentenaire de la responsabilité contractuelle de droit commun par l’absorption de celle-ci par les garanties légales.
La règle énoncée ci-dessus depuis l’arrêt de principe du 13 avril 1988 (11), était réitérée également en marge des garanties légales issues de la Loi du 4 janvier 1978, ce qui était attendu, la Cour Suprême dans son rapport annuel de l’année 1988 ayant précisé que :
« Par la généralité des termes utilisés (par l’arrêt du 13 avril 1988), visant à la fois les situations antérieures et postérieures à la Loi du 4 janvier 1978, fait figure d’arrêt de principe, seul le défaut de conformité ne constituant pas un vice de construction reste soumis à la responsabilité de droit commun ».
C’est par un arrêt remarqué du 11 mars 1992 , que la solution sera réitérée en marge du régime issu de la Loi du 4 janvier 1978.
L’arrêt est d’autant plus intéressant qu’en la circonstance, s’agissant d’un problème de consommation excessive d’une chaudière qui avait été installée en remplacement d’une chaudière hors d’usage, il semblait évident que seule la responsabilité contractuelle de droit commun était susceptible d’application, fondement retenu par la Cour d’appel de LYON que la Cour Suprême casse pour n’avoir pas recherché « si les désordres ne relevaient pas d’une garantie légale et notamment de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code Civil qui était invoquée, alors que les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ».
Et ce alors que la Cour Suprême ne pouvait ignorer que le délai d’action de la garantie biennale de bon fonctionnement était largement expiré d’une part, et que les « désordres » invoqués n’en étaient pas vraiment, s’agissant comme déjà dit ci-dessus d’une consommation excessive d’une chaudière, de sorte que cet arrêt, bien plus que la transposition en marge du régime de la Loi du 4 janvier 1978 de la règle posée dès 1988, constitue surtout l’expression de la volonté d’uniformisation de tous les délais ici par le recours en quelque sorte artificiel à la règle de l’absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par les garanties légales.
D’autres arrêts de Cours d’appel mais aussi de la Cour Suprême confirmaient cette volonté d’uniformisation du délai par le recours cette fois-ci plus justifié à la règle précitée de l’absorption de la responsabilité contractuelle de droit commun par les garanties légales, en cas de dommages dont les caractéristiques techniques ou de gravité relevant de l’application desdites garanties.
C’est ainsi que dans un arrêt du 10 avril 1996 , relatif à l’obligation de Conseil d’un architecte, la Cour Suprême cassera une décision d’une Cour d’appel, qui tout en relevant que les désordres objet du litige relevaient de la garantie biennale de bon fonctionnement, expirée, avait retenu la responsabilité contractuelle de l’architecte pour manquement à son obligation de mise en garde pour n’avoir pas attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessaire adaptation des fermetures de menuiseries au chauffage électrique mis en œuvre.
La Cour de BORDEAUX, jugeait le 2 juillet 1996, dans le même esprit, qu’après l’expiration de la garantie biennale de bon fonctionnement, toute action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun était impossible .
Deuxième étape : l’arrêt Maisons Enec du 22 mars 1995 sur les dommages mineurs.
Rendu sur le rapport de la très regrettée Joëlle FOSSEREAU, le fameux arrêt Maisons Enec du 22 mars 1995 énonce :
« Qu’ayant relevé que les désordres des plafonds et cloisons, non apparents à la réception, n’affectaient pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et, ne compromettant ni la solidité ni la destination de la maison, n’étaient pas soumis non plus à la garantie décennale, la Cour d’appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement que la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur concerné n’excluait pas l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée ; »
L’arrêt Maisons Enec constitue la transposition en marge du régime issu de la Loi du 4 janvier 1978 de la solution de l’arrêt Delcourt (rendu également sur le rapport de Madame le Doyen Joëlle FOSSEREAU).
Comme son « frère aîné » Delcourt, l’arrêt Maisons Enec définit le régime de cette responsabilité contractuelle de droit commun, savoir responsabilité pour faute prouvée sans se référer, comme l’arrêt Delcourt, à un texte quelconque et sans préciser la durée de ladite responsabilité.
Mais à l’inverse de la situation de l’arrêt Delcourt, l’absence de référence à un texte quelconque ne résultait pas d’un réflexe de prudence mais d’une impossibilité juridique dès lors que l’article 2270 Nouveau du Code Civil ne pouvait pas être invoqué, s’agissant d’un texte de prescription des seules responsabilités et garanties spécifiques des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code Civil, tandis que la référence à l’article 1147 dudit Code aurait été inopportune car ne correspondant pas à la volonté de la Cour Suprême qui avait fait savoir qu’à la prochaine occasion, elle dirait que la durée de cette responsabilité contractuelle de droit commun, en quelque sorte spécifique, pour les dommages mineurs, serait de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, comme l’énonçait d’ailleurs en filigrane Madame Le Doyen Joëlle FOSSEREAU dans son rapport précité.
Mais les dommages mineurs dont s’agit ne peuvent être qualifiés ou dénommés désormais de « dommages intermédiaires ».
En effet, si cette dernière appellation pouvait à la rigueur se justifier (encore que non particulièrement appréciée par Madame le Doyen Joëlle FOSSEREAU), en ce sens que le terme « intermédiaires » renvoyait à l’idée que les dommages considérés ne pouvaient relever ni de la garantie décennale, à raison de leur absence de gravité, bien qu’ayant leur siège dans un gros ouvrage, ni de la garantie biennale des menus ouvrages qui n’exigeaient certes aucune condition de gravité, mais néanmoins que le dommage eut son siège dans un menu ouvrage, elle ne peut plus avoir une signification quelconque sous l’empire de la Loi du 4 janvier 1978 qui a abandonné toute distinction entre gros et menus ouvrages.
Troisième étape : la jurisprudence sur les travaux de ravalement et/ou de peinture.
L’examen de cette jurisprudence a déjà été fait dans d’autres colonnes ; on se contentera en conséquence ici de rappeler ou de préciser que depuis plusieurs années se dessine un mouvement général tendant à considérer que les travaux de ravalement et/ou de peinture ne constituent pas la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil ni un élément constitutif dudit ouvrage au sens de ce texte, ni encore la réalisation d’un élément d’équipement au sens des articles 1792 ou 1792-2 ou encore 1792-3 du Code Civil.
De sorte que les inconvénients et défauts pouvant affecter lesdits travaux, y compris si en raison de leur généralité et de leur importance ils seraient d’une certaine gravité, relèveraient de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée et non des garanties légales, sauf si lesdits travaux de ravalement ou de peinture comportent une fonction d’étanchéité auquel cas ils seraient alors constitutifs de la construction d’un ouvrage et comme tels, si la gravité des désordres est avérée relèvent de la responsabilité décennale.
Aussi, la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue en la matière dans deux séries d’hypothèses, savoir :
– lorsque les travaux exécutés ne sont pas constitutifs de la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, et ce quelque soit les conséquences quant à la destination des lieux ;
– lorsque les travaux sont constitutifs de la création d’un ouvrage mais les désordres les affectant sont de peu de gravité ou seulement d’ordre esthétique ;
La jurisprudence ci-dessus évoquée ne précise néanmoins pas la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun mais la Cour Suprême a admis implicitement dans le cadre de l’arrêt précité du 17 avril 2000 (23), que celle-ci était d’une durée de 10 ans en rejetant l’un des moyens du pourvoi qui reprochait à la Cour d’appel concernée, d’avoir retenu l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun et déduit « que l’action ainsi soumise à la prescription de dix ans était recevable ».
Quatrième étape : les arrêts Maisons Bottemer et Grobost du 16 octobre 2002.
Outre ce qui a déjà été dit sur la portée des arrêts rapportés, on ajoutera qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action récursoire du constructeur de maisons individuelles à l’encontre de l’architecte avec lequel il était lié (arrêt Maisons Bottemer), la solution est identique à celle déjà adoptée dans le cadre de l’action récursoire du vendeur d’immeuble à construire à l’encontre des constructeurs , mais contraire à celle adoptée dans le cadre de l’action récursoire de l’entrepreneur à l’égard de son sous traitant ou du fabricant, en application de l’adage de l’ancien droit « contrat non valentem agere non currit praescriptio » voire de celui selon lequel « actioni non natae non prescribitur ».
Or, l’éviction de ces deux derniers adages de l’ancien droit dans le cadre de l’action récursoire du vendeur d’immeuble à construire est justifiée par le fait que si le délai d’action au titre de la garantie décennale est un délai de prescription, c’est aussi et surtout un délai d’épreuve de la solidité de l’ouvrage et de la bonne exécution des travaux, délai au-delà duquel les constructeurs sont libérés de toute responsabilité.
C’est donc que, pour la Cour Suprême, le délai de dix ans de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages à l’ouvrage ou l’inexécution de l’obligation de Conseil relative auxdits dommages est ici encore considéré comme un délai d’épreuve au-delà de l’expiration duquel les constructeurs sont libérés de leur responsabilité, laquelle doit être mise en œuvre nécessairement à l’intérieur de ce délai.
Enfin, pour être exhaustif, on soulignera ici que l’arrêt Maisons Bottemer valide à juste titre l’arrêt de la Cour d’appel choqué de pourvoi en ce qu’elle avait « exactement relevé que, lorsque les réserves avaient été formulées, les malfaçons réservées donnaient lieu à une application prolongée de la responsabilité contractuelle… » application prolongée en cumul pendant la première année avec la garantie de parfait achèvement instituée par l’article 1792 du Code Civil en ce qui concerne l’entrepreneur concerné au sens de ce texte, puis pour les neuf années à courir, application totalement autonome.
– II –
LES QUESTIONS EN SUSPENS ET/OU NON ENCORE RESOLUES.
Le domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas cantonné aux dommages à l’ouvrage et/ou à l’obligation de conseil relative aux dommages à l’ouvrage et ladite responsabilité contractuelle de droit commun étant susceptible d’application dans de nombreuses autres hypothèses ci-avant évoquées, tandis qu’il faut aussi s’attacher à examiner dans un cadre prospectif la durée de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun qui peut être encourue également par les constructeurs d’ouvrages immobiliers.
A/ La durée de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre de la sanction d’obligations totalement indépendantes de la réception :
En l’état actuel du droit positif, la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun encourue au titre des dépassements des délais ou de prix par rapport à la promesse contractuelle ou ce qui avait été envisagé par les parties est trentenaire, sauf application de l’article 189 bis devenu l’article L 110-4 du Code de Commerce, auquel cas la durée est réduite à dix ans, durée trentenaire ou décennale dont le point de départ est d’ailleurs incertain, encore qu’on peut la fixer dans les deux hypothèses ci-avant évoquées, au jour de la livraison ou de la réception de l’ouvrage.
Décider dans l’avenir que la durée de la responsabilité encourue serait de dix ans à compter de la date de livraison ou de la réception de l’ouvrage, ne présente aucun inconvénient majeur car on voit mal la victime de la mauvaise exécution des obligations contractées à ce titre, attendre plus de dix ans avant d’agir en Justice.
B/ La durée de la responsabilité contractuelle de droit commun dans le cadre des non conformités sans dommage / désordres à l’ouvrage :
En l’état actuel du droit positif et pour les mêmes raisons que ci-dessus, la durée de la responsabilité contractuelle de droit commun dans l’hypothèse ci-avant évoquée est trentenaire ou décennale, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus avec cette différence qu’ici le point de départ de la prescription / action est nécessairement située au jour de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserve.
Ici encore, il n’y aurait aucun inconvénient à ce que la durée de la prescription et de l’action soit décennale pour les mêmes raisons que ci-dessus évoquées.
C/ La durée de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages à l’ouvrage résultant d’une faute dolosive :
Par arrêt de principe du 27 juin 2001 constituant un revirement de jurisprudence, la Cour Suprême, satisfaisant aux critiques unanimes de la doctrine, a décidé que la responsabilité encourue en cas de dommages à l’ouvrage consécutifs à un dol était de nature contractuelle et énoncé en conséquence que : « …le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ».
Cet arrêt ne précise pas la durée de la responsabilité contractuelle en cas de dommages pour faute dolosive mais il est clair que compte tenu du caractère général de la formule selon laquelle « nonobstant la forclusion décennale… » et non pas « nonobstant la forclusion de l’action en garantie décennale », la durée de la responsabilité serait toujours de 30 ans à compter de la réception de l’ouvrage y compris en matière d’actes de commerce ou d’actes mixtes.
Cette durée est d’ailleurs déjà admise par les juridictions de l’ordre administratif, qui ont toujours considéré que la faute dolosive était de nature contractuelle.
D/ La durée de la responsabilité extracontractuelle de droit commun :
On sait qu’en l’état du droit positif :
– les actions en responsabilité des constructeurs les uns à l’égard des autres lorsqu’ils ne sont pas liés contractuellement entre eux,
– l’action du maître de l’ouvrage à l’égard du sous traitant,
sont nécessairement de nature extracontractuelle et comme telles, régies par l’article 2270-1 alinéa 1 du Code Civil qui énonce que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation », et ce depuis le 1er janvier 1986 en application de la Loi dite BADINTER du 5 juillet 1985.
L’application de la règle ci-dessus énoncée combinée avec les principes généraux de la responsabilité contractuelle de droit commun ou encore avec les responsabilités et garanties spécifiques édictées par les articles 1792, 1792-2 et 1792-4 du Code Civil, conduit à ce que les mêmes professionnels, pour les mêmes dommages, voient leurs responsabilités encourues selon des régimes différents et surtout pendant des durées différentes et ce uniquement en fonction de la qualité de celui qui, à titre principal ou récursoire, les mettrait en œuvre.
C’est à raison surtout de cette situation que dans son rapport annuel pour l’année 2001, la Cour Suprême au titre des suggestions de modifications législatives, a proposé dans la première suggestion une modification des articles 2262 et 2270-1 du Code Civil sous le titre « De la prescription extinctive trentenaire à une prescription décennale ».
Dans le cadre de cette suggestion, la Cour Suprême souligne que les dispositions des durées de prescription pour les actes de commerce ou mixtes, les actions en nullité de convention ou les actions en responsabilité et garanties en matière de construction d’ouvrage et ou encore en responsabilité civile extracontractuelle, aboutissaient à « des incohérences dans le schéma bien connu de la combinaison des articles 1147, 1165 et 1382 du Code Civil lorsqu’un tiers se prévaut de la violation d’une obligation contractuelle qui lui cause un préjudice ».
La Cour Suprême suggérait en conséquence de « généraliser à dix ans le délai maximal de prescription d’action en toute matière » à l’exception toutefois de la prescription acquisitive ou usucapion.
Les arrêts rapportés ne s’inscrivent évidemment pas dans le cadre de la stricte logique qui a conduit la Cour Suprême à proposer la modification ci-avant évoquée concernant l’adoption d’un délai de 10 ans « en toute matière », c’est-à-dire de facto, en matière contractuelle et extracontractuelle dont le point de départ serait alors identique et ce alors même que la suggestion précitée a une portée relativement générale.
On sait que dans les divers projets non encore aboutis d’une réforme du statut du sous traitant, la responsabilité de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage serait de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, ce qui aurait l’avantage de placer ce professionnel au même plan que ceux qui sont liés directement au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il resterait à régler bien sur la question des rapports des constructeurs entre eux les uns à l’égard des autres et on voit mal pourquoi il ne serait pas admis aussi, dans cette configuration, que la responsabilité extracontractuelle desdits locateurs d’ouvrage les uns à l’égard des autres, serait toujours de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Semaine Juridique JCP éd. Notariale 2004, n° 131160 page 545