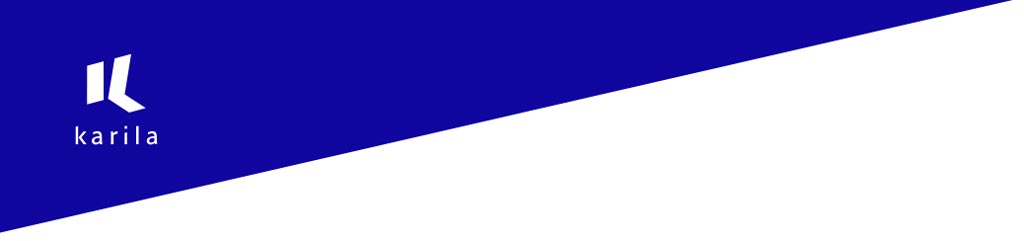Ancien ID : 999
Assurance construction – Assurance dommages ouvrage – Désordres. Persistance et/ou extension. Réparation à l’initiative de l’assureur. Caractère pérenne (oui). Garantie de l’assureur (oui). – Devoir de conseil de l’expert désigné par l’assureur. – Obligation pour le juge de statuer dans les limites de l’objet du litige déterminé par les parties.Une cour d’appel qui relève que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale et retient souverainement que l’extension de ce désordre était prévisible, et induit le caractère insuffisant des travaux de reprise des désordres constatés en 1997 et réparés en 1998, retient exactement que la réparation à l’initiative de l’assureur devait être pérenne et efficace et que ledit assureur devait préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis.
La cour d’appel qui, pour condamner l’entrepreneur/réparateur et son assureur, in solidum avec l’assureur dommages ouvrage, l’expert désigné par celui-ci et le bureau d’étude de sols et l’assureur de celui-ci à payer aux maîtres d’ouvrage des sommes en réparation de leurs préjudices, retient que ledit entrepreneur/réparateur a commis une faute de nature contractuelle à l’égard de l’expert désigné par l’assureur dommages et de nature délictuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage, alors que l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage invoquait une faute de l’entrepreneur réparateur de nature délictuelle et que les maîtres d’ouvrage fondaient leurs actions contre ledit entrepreneur réparateur sur la garantie décennale des constructeurs, modifie l’objet du litige et viole ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Cour de cassation (3e Ch. civ.) 22 juin 2011 Pourvoi no 10-16308
Publié au Bulletin
« Axa France Iard et Autre c/ Société Eurisk et autres
La Cour,
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2010), que les consorts X… Y…, qui avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Assurance mutuelle des constructeurs (AMC), ont fait réaliser une maison individuelle qui a été réceptionnée le 9 juin 1989 ; qu’un sinistre consistant en un affaissement du dallage intérieur en périphérie au droit des murs de façade et du pignon du séjour s’étant manifesté en 1997, la société AMC a mandaté en qualité d’expert la société Eurex dénommée aujourd’hui Eurisk, que cette société a confié une étude de sol à la société Solen, aujourd’hui dénommée CEBTP-Solen, assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les travaux de reprise préconisés ont été confiés, en 1998, à la société Procédés spéciaux de construction (PSC) aujourd’hui dénommée Arcadis ESG, assurée auprès de la société Axa France IARD (Axa) ; que des désordres affectant les murs de la villa étant apparus en septembre 2002, les consorts Z…-A…, devenus propriétaires de la maison, ont au vu d’une expertise ordonnée en référé, notamment assigné la société AMC, la société Eurisk, la société PSC, et la société Solen ainsi que leurs assureurs en réparation et indemnisation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société AMC, qui est préalable :
Attendu que la société AMC fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, et son assureur, la société Axa à payer aux consorts Z…-A… des sommes en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, que l’assurance dommages-ouvrage obligatoire est une assurance de choses qui garantit le paiement des travaux en dehors de toute recherche de responsabilité et qui prend fin à l’expiration d’une période de dix ans à compter de la réception ; que la cour d’appel qui a, par motifs adoptés des premiers juges, relevé que les travaux de reprise effectués en 1997 et financés par la société AMC étaient « efficaces et pérennes », ne pouvait juger que l’assureur dommages-ouvrage était tenu de garantir la réparation de dommages apparus postérieurement à l’expiration dudit délai, découleraient-ils des mêmes vices de construction, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l’article L. 242-1 du Code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres, que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale, et souverainement retenu que l’extension de ce désordre était prévisible, que les travaux préfinancés en 1998 par l’assureur dommages-ouvrage, qui pouvait savoir que les désordres se propageraient aux murs, étaient insuffisants pour y remédier et que les désordres de 2002 ne se seraient pas produits si les travaux de reprise des désordres de 1997 avaient été suffisants, la cour d’appel a exactement retenu que la réparation à l’initiative de cet assureur devait être pérenne et efficace et que la société AMC devait préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que le moyen qui vise des motifs de la cour d’appel relatifs à l’expiration du délai de garantie décennale courant à compter de la réception des travaux de construction de la maison qui est sans effet sur l’action formée par les consorts Z…-A… à l’encontre de la société Arcadis venant aux droits de la société PSC, uniquement intervenue pour réaliser les travaux de réparation en 1998, et de son assureur, est inopérant ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP et de la société CEBTP-Solen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de condamner la société CEBTP-Solen et la SMABTP, in solidum avec la société AMC, la société Eurisk, la société Arcadis, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa, à payer aux consorts Z…-A… des sommes en réparation de leurs préjudices, de condamner la société CEBTP-Solen et la SMABTP in solidum avec la société Eurisk, la société Arcadis, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa à garantir la société AMC de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z…-A… et de condamner la société CEBTP-Solen à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, alors, selon le moyen :
1o/ que la société AMC n’invoquait à l’encontre de la société CEBTP-Solen aucune faute de nature à engager la responsabilité délictuelle de celle-ci à son égard ; qu’en retenant d’office, pour la déclarer, avec son assureur, tenue de garantir la société AMC, que la société CEBTP-Solen aurait manqué à son obligation de conseil en n’évoquant pas un éventuel risque de mouvement des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui constituerait une faute délictuelle à l’égard de la société AMC, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du Code de procédure civile ;
2o/ qu’en statuant de la sorte sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l’article 16 du Code de procédure civile ;
3o/ que la cour d’appel a constaté que la société CEBTP-Solen, suite aux désordres affectant le dallage, avait reçu mission d’effectuer une étude pathologique des sols de fondation, mission de type G 0 + G 32 comprenant la réalisation d’une étude géotechnique du site, l’appréciation de l’origine des désordres, la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptés aux sols rencontrés et à la construction existante ; que la SMABTP et la société CEBTP-Solen faisaient valoir que cette dernière n’avait pas été chargée d’une mission de type G2 et G3 permettant de définir les ouvrages nécessaires pour remédier au sinistre ; qu’en imputant à faute un manquement de la société CEBTP-Solen à son obligation de conseil pour n’avoir pas évoqué un éventuel risque de mouvements des fondations de la construction en raison de la nature du sol, ce qui n’entrait pas dans le cadre de sa mission, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil, ensemble l’article 1382 du Code civil ;
4o/ que la cour d’appel a constaté que les désordres étaient imputables à l’absence de prise en compte de la nature du sol par les constructeurs d’origine lors de l’édification de l’immeuble ; qu’ainsi, l’aggravation inéluctable, pour cette raison, du sinistre affectant le dallage aux murs « périmètriques » était sans lien de cause à effet avec le défaut d’information reproché à la société CEBTP-Solen ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que saisie de conclusions de la société AMC invoquant, pour solliciter la garantie de la société CEBTP-Solen, une faute de celle-ci, la cour d’appel, en l’absence de lien contractuel entre ces parties, a, sans modifier l’objet du litige ni violer le principe de la contradiction, statué à bon droit sur cette demande sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que la société Eurisk avait confié à la société Solen une étude pathologique des sols de fondation comprenant une étude géotechnique du site, l’appréciation de l’origine des désordres et la définition des systèmes de confortement ou mesures de traitement adaptées aux sols rencontrés et à la construction existante, et que la société Solen avait mis en évidence la présence d’argiles gonflantes et rétractables constituant un facteur aggravant ou déclenchant, la cour d’appel a pu retenir que l’extension des désordres était prévisible, que la société Solen avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son mandant, la société Eurisk, quant à cette possible extension et que cette faute contractuelle, en lien direct avec les dommages constatés en 2002, pouvait être invoquée sur le fondement délictuel, notamment par la société AMC tenue de financer de nouveaux travaux de reprise ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Eurisk :
Attendu que la société Eurisk fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société AMC, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa à payer aux consorts Z…-A… la somme de 200 160,57 euros, alors, selon le moyen :
1o/ que l’expert missionné en vue de la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage n’est tenu de préconiser que les travaux, incombant à cet assureur, devant assurer la solidité de l’ouvrage dans le délai de la garantie décennale ; qu’en reprochant à la société Eurisk d’avoir préconisé des travaux, destinés à remédier aux désordres affectant l’immeuble des consorts Z…-A…, qui étaient insuffisants dès lors qu’ils ne faisaient pas obstacle à la survenance de nouveaux désordres inéluctables bien qu’elle ait elle-même relevé que ces désordres étaient apparus au-delà du délai d’épreuve de dix ans, de sorte que les travaux préconisés par l’expert avaient atteint leur objectif, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code des assurances et l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code, ensemble les articles 2270 et 1382 du Code civil ;
2o/ qu’en tout état de cause, la responsabilité d’un expert est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu’en condamnant la société Eurisk à prendre en charge les travaux nécessaires à la réparation de désordres apparus après l’expiration de la garantie dommages-ouvrage sans rechercher, comme l’y invitait la société Eurisk, si, même sans faute de sa part, l’assureur dommages-ouvrage n’aurait pas refusé de les préfinancer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale en violation des articles L. 242-1 du Code des assurances, 2270 et 1382 du Code civil ;
3o/ qu’en tout état de cause la responsabilité d’un expert est subordonnée à l’existence d’un dommage causé par sa faute ; qu’en condamnant la société Eurisk à indemniser les consorts Z…-A… de leur préjudice résultant du coût des travaux de stabilisation de l’immeuble bien qu’elle ait relevé que ces désordres entraient dans le champ d’application de la garantie décennale et que la police dommages-ouvrage en couvrait le paiement, condamnant ainsi l’assureur dommages-ouvrage à les prendre en charge de sorte que, malgré la faute commise par la société Eurisk, ils ne subissaient aucun préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d’une part, que l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage siège des désordres d’atteindre sans nouveaux désordres le délai de dix ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage ;
Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans son devoir de conseil ayant conduit à la réalisation de travaux insuffisants pour empêcher l’extension du premier désordre, la cour d’appel qui n’était pas tenue de rechercher si, bien informé l’assureur dommages-ouvrage aurait préfinancé les travaux nécessaires, a pu décider que cette faute avait contribué à l’entier préjudice subi par les propriétaires ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Eurisk :
Attendu que la société Eurisk fait grief à l’arrêt de la condamner in solidum avec la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, ainsi que son assureur, la société Axa, à garantir la société AMC de l’ensemble des condamnations mises à la charge de celle-ci, alors, selon le moyen :
1o/ que la responsabilité d’un expert est subordonnée à l’existence d’un lien de causalité entre sa faute et le dommage dont la réparation est sollicitée ; qu’en condamnant la société Eurisk à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à indemniser les consorts Z…-A… du coût des travaux de reprise des désordres, bien qu’elle ait constaté que ces désordres étaient dus à l’inadéquation des fondations d’origine au sol argileux sur lequel la construction avait été réalisée de sorte que l’assureur dommages-ouvrage était tenu de les garantir et que le manquement de la société Eurisk à son devoir de conseil n’avait eu aucune incidence sur son obligation de les prendre en charge, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
2o/ que les conséquences d’une obligation volontairement souscrite ne constituent pas un dommage réparable ; qu’en condamnant la société Eurisk à garantir l’assureur dommages-ouvrage de sa condamnation à verser aux consorts Z…-A… le prix des travaux de réparation quand l’obligation de supporter ces travaux n’était que la conséquence de l’engagement de l’assureur dont la cour d’appel a constaté qu’il devait sa garantie, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu que la société Eurisk avait commis une faute dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée et que la société CMA était tenue de préfinancer de nouveaux travaux de réparation en raison de l’extension de désordres que les premiers travaux, auraient dû éviter s’ils avaient été bien évalués par la société Eurisk, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un lien de causalité entre la faute de l’expert et l’obligation de financer des travaux complémentaires imprévus ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Arcadis ESG, venant aux droits de la société PSC, et son assureur, la société Axa in solidum avec la société AMC, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP à payer aux consorts Z…-A… des sommes en réparation de leurs préjudices, l’arrêt retient, d’une part, que la société PSC a commis une faute de nature contractuelle à l’égard de la société Eurisk et de nature quasi délictuelle à l’égard des autres parties, et, d’autre part, que la faute de la société PSC est de nature délictuelle à l’égard des consorts Z…-A… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société Eurisk invoquait une faute de la société PSC de nature délictuelle et que les consorts Z…-A… fondaient leur action contre la société PSC sur la garantie décennale des constructeurs, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident de la société CEBTP-Solen et de la SMABTP qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il :
– condamne, in solidum la société AMC, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen, et son assureur la SMABTP, la société Arcadis ESG, et son assureur la société Axa, à payer aux consorts Z…-A… les sommes qui leur ont été allouées en réparation de leurs préjudices,
– condamne, in solidum, la société Eurisk, la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP, celle-ci selon les clauses et dans limites de la police souscrite, la société Arcadis ESG venant aux droits de la société PSC et son assureur, la société Axa France IARD, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à garantir la société AMC de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z…-A… ;
– condamne la société CEBTP-Solen et son assureur, la SMABTP celle-ci selon les clauses et dans limites de la police souscrite, à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge ;
– condamne la société Arcadis ESG venant aux droits de la société Procédés spéciaux de construction et son assureur, la société Axa France Iard, celle-ci selon les clauses et dans les limites de la police souscrite, à garantir la société Eurisk à hauteur de 25 % des condamnations mises à sa charge, l’arrêt rendu le 1er février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société AMC aux dépens du pourvoi principal dit que les autres parties conserveront la charge de leurs dépens ; »
Note
1. L’arrêt rapporté a été rendu après examen de multiples pourvois formulés à l’encontre d’un arrêt de la Cour de Versailles du 1er février 2010, peu motivé et ne comportant curieusement le visa d’aucun texte, permettant ainsi la formulation des pourvois ci-dessus évoqués, alors même que la solution retenue aurait pu juridiquement être justifiée, au mépris toutefois, et sur ce point le reproche n’est pas formel, d’une violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour ayant modifié l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties au procès.
La cassation a d’ailleurs été prononcée pour ce motif, les autres moyens soutenus dans le cadre des différents pourvois ci-dessus évoqués ayant été rejetés pour des motifs que nous examinerons ci-après dans le cadre de notre commentaire.
I. RAPPEL DES FAITS ET DES PROCÉDURES
2. Un rappel synthétique – bien que relativement long – des faits de la procédure ayant abouti à l’arrêt précité de la Cour de Versailles du 1er février 2010, cassé par l’arrêt rapporté du 22 juin 2011, s’impose en la circonstance pour mieux apprécier la portée des moyens proposés à la Cour de cassation et la solution retenue par celle-ci.
Des Consorts X. et Y. font construire une maison individuelle et souscrivent à cette occasion l’assurance obligatoire dommages ouvrage auprès de la Mutuelle des Constructeurs (AMC). Les travaux font l’objet d’une réception le 9 juin 1989.
En suite de l’affaissement en 1997 du dallage intérieur en périphérie au droit des murs porteurs de la maison les Consorts X. et Y. déclarent le sinistre à l’assureur dommages ouvrage, lequel désigne en qualité d’expert une société EUREX devenue EURISK, laquelle confiera une étude de sols à une société CEBTP-SOLEN assurée par la SMABTP.
Les travaux de reprise préconisés par EURISK sont réalisés en 1998 par une Société Procédés Spéciaux de Construction (PSC) devenue depuis ARCADIS ESG, assurée auprès de la Compagnie AXA France IARD.
Postérieurement à l’expiration de la garantie décennale (soit après le 9 juin 1999 à minuit pour une réception prononcée le 9 juin 1989), les consorts X. et Y. vendent en février 2002 aux consorts Z. et A. leur maison individuelle. Dès septembre 2002, les époux Z. et A. constatent l’apparition de désordres affectant les murs porteurs de ladite maison ; il s’ensuit classiquement une procédure de référé expertise à l’initiative des consorts précités Z. et A. ; le rapport d’expertise judiciaire conclut à la nécessité de travaux de réparation et/ou de consolidation des murs porteurs à raison de l’inadaptation du système de fondation de la maison à la nature du sol.
Saisi en ouverture de ce rapport le Tribunal de Grande Instance de Pontoise met en cause l’insuffisance des travaux effectués en 1998 estimant notamment que l’assureur Dommages-Ouvrage ne pouvait pas ignorer que les désordres affectant le dallage se propageraient aux murs périphériques et retient en conséquence la garantie dudit assureur.
Le Tribunal de Grande Instance de Pontoise retenait également :
– la responsabilité de l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage, la société EURISK, à raison des renseignements dont celle-ci disposait concernant l’état du sol, et desquels il résultait que le désordre allait s’étendre aux fondations des murs porteurs, ce qui aurait dû la conduire en conséquence à prévoir une solution de confortement desdits murs ;
– la responsabilité de l’entrepreneur/réparateur des travaux du dallage au motif qu’il ne pouvait ignorer l’incohérence de la démarche conduisant à doter un simple dallage d’une fondation profonde en faisant abstraction des risques de désordres pesant sur la fondation des murs dans un contexte géologique sensible qu’il connaissait parfaitement.
Statuant sur les différents appels du jugement dont celui principal de la Société EURISK, qui avait été déboutée notamment de son action en garantie contre le bureau d’étude de sols la société CEBTP-SOLEN, la Cour de Versailles, infirmait le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise en ce qu’il avait :
– condamné in solidum l’assureur dommages ouvrage, l’entrepreneur/réparateur et son assureur, l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage (EURISK) à payer aux Consorts Z. et A. les sommes qui leur avaient été allouées en réparation de leurs préjudices et « dont le montant est confirmé » ;
– rejeté les appels en garantie des précités à l’encontre du bureau de sols (CEBTP-SOLEN) et de l’assureur de ce dernier (la SMABTP) ;
– condamné l’entrepreneur/réparateur et son assureur à garantir l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage ;
– condamné in solidum l’expert précité, l’entrepreneur/réparateur ainsi que l’assureur de ce dernier, à garantir l’assureur dommages ouvrage de l’ensemble des condamnations mises à la charge de celui-ci.
La Cour de Versailles réformait dans ces circonstances le jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise et y ajoutant condamnait :
– in solidum l’assureur dommages ouvrage, l’expert désigné par celui-ci, le bureau d’étude de sols et l’assureur de celui-ci, l’entrepreneur/réparateur à payer aux consorts Z. et A. les sommes allouées à ceux-ci en réparation de leurs préjudices ;
– les précités à l’exception de l’assureur dommages ouvrage à garantir ce dernier de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des préjudices des consorts Z. et A ;
– le bureau d’étude de sols et son assureur à garantir l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage à hauteur de 25 % ;
– l’entrepreneur réparateur et son assureur à garantir l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage à hauteur de 25 %.
C’est dans ces circonstances, et à raison notamment d’un défaut de motivation de l’arrêt précité du 10 février 2010 et de la curieuse absence de tout visa d’un quelconque texte que toutes les parties au procès invoquaient, à titre principal ou incident, contre la Cour de Versailles, divers moyens de cassation dont nous apprécierons ci-après la portée ainsi que l’éventuelle pertinence.
II. LA TERMINOLOGIE
3. Liminairement il sera formulé des remarques d’ordre terminologique et traité à cette occasion des deux moyens du pourvoi incident de la Société CEBTP-SOLEN et de son assureur la SMABTP , la Cour de cassation n’ayant pas, pour les raisons qui seront précisées ci-après statué, sur le premier moyen tandis qu’en ce qui concerne le rejet du second, la Haute Juridiction a, selon nous, affecté sa motivation d’un défaut de terminologie.
4. En ce qui concerne la terminologie , on peut regretter que certaines expressions du langage courant aient été en effet utilisées par la Cour de Versailles mais aussi par la Haute Juridiction, alors que leur emploi dans des décisions de justice pouvait être équivoque à raison de leur signification d’un point de vue strictement juridique.
C’est ainsi notamment, que de façon équivoque, la Cour de Versailles a indiqué :
– que l’assureur dommages ouvrage avait « mandaté » la Société EUREX devenue EURISK « pour expertiser le sinistre » (p. 11 de l’arrêt) alors que le rapport qui s’instaure entre l’assureur dommages ouvrage et l’Expert que celui-ci désigne, sous le contrôle de l’assuré qui peut le récuser, n’est que la conséquence de l’obligation légale, réglementaire et d’ordre public qui pèse sur l’assureur, comme il sera plus amplement précisé ci-après et ne peut en aucun cas, également pour des raisons qui seront précisées ci-après, ressortir d’un quelconque mandat ;
– (page 11 de l’arrêt) que l’assureur dommages ouvrage avait « ensuite mandaté la Société Procédés Spéciaux de Construction (PSC) devenue la Société ARCADIS ESG aux fins de reprendre les désordres… » alors qu’à l’évidence le rapport contractuel qui a pu se nouer à cette occasion ne peut être de l’ordre du contrat du mandat mais à l’évidence du louage d’ouvrage !…
On peut regretter également que la Haute Juridiction ait, elle-même, dans le cadre de la motivation du rejet du second moyen du pourvoi incident indiqué que « …la Société SOLEN avait manqué à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde son mandant … », s’agissant en la circonstance de la Société EURISK, expert désigné par l’assureur dommages ouvrage, alors que si un rapport contractuel avait pu se nouer entre ladite Société EURISK et la Société CEBTP-SOLEN (plutôt qu’entre cette dernière et l’assureur dommages ouvrage) ce rapport contractuel ne pouvait dériver que d’un contrat de louage ouvrage, c’est-à-dire d’un contrat d’entreprise mais en aucun cas d’un contrat de mandat.
5. En ce qui concerne les moyens de cassation du pourvoi incident de la Société CEBTP-SOLEN et son assureur la SMABTP .
Nous nous contenterons de relever :
– en ce qui concerne le premier moyen , que la Cour de cassation a indiqué qu’il n’y avait « pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ».
On rappellera à cet égard que les demandeurs au pourvoi reprochaient au soutien de la branche unique de leur premier moyen, à la Cour de Versailles, de les avoir condamnés in solidum avec d’autres à indemniser les consorts Z. et A. de leurs préjudices alors que ceux-ci qui avaient sollicité la confirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance de Pontoise (lequel ne les avait pas condamnés) n’avaient pas sollicité une telle condamnation en cause d’appel.
La situation ainsi décrite, s’agissant du reproche fait à la Cour de Versailles d’avoir statué « ultra petita », ne constituait pas un cas d’ouverture de cassation, mais une irrégularité qui ne pouvait être réparée que selon la procédure prévue à l’article 464 du Code de procédure civile lequel renvoie à l’article 463 dudit code, c’est-à-dire la présentation d’une requête à la juridiction qui a, soit omis de statuer (article 463 du CPC), soit statué sur des choses non demandées (article 464 du CPC).
De sorte que toute demande/critique ou moyen en cassation est, à cet égard, irrecevable (Cass. 3e civ., 8 avril 2009, no 04-18764 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2003, no 01-14283 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2003, no 01-14350 ; Cass. 2e civ., 4 octobre 2007, no 06-17870 ; Cass. civ. 2e civ., 10 juillet 1996, no 94-16906, Bull. civ. II, no 197), raison pour laquelle sans doute, la Haute Juridiction a estimé ne pas devoir statuer sur le moyen dès lors qu’il était insusceptible a priori de permettre l’admission du pourvoi.
– En ce qui concerne le second moyen du pourvoi incident , il ne nous semble pas opportun de nous y attarder outre mesure, la motivation du rejet dudit moyen par la Haute Juridiction étant explicite et parfaitement justifiée en fait et en droit.
Le juge ne modifie pas l’objet du litige en qualifiant juridiquement la faute que l’assureur Dommages Ouvrage avait imputée à la Société CEBTP-SOLEN. Le juge peut retenir, sur le fondement délictuel, une faute contractuelle si celle-ci a causé à un tiers un préjudice (Cass. civ., Ass. plén., 6 octobre 2006, no 05-13255, Bull. civ. no 9).
6. Ce qui précède ayant été précisé et rappelé nous nous livrerons ci-après à un examen critique des différents autres moyens du pourvoi et au sort que leur a réservé la Cour de cassation.
III. SUR L’OBLIGATION DE L’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE DE PRÉFINANCER DES TRAVAUX DE RÉPARATION PÉRENNES ET EFFICACES DES DÉSORDRES (pourvoi incident de l’assureur)
7. Aux termes d’un moyen unique de cassation à l’appui de son pourvoi incident l’assureur dommages ouvrage AMC reprochait à la Cour de Versailles la violation de l’article L. 242-1 du Code des assurances pour avoir jugé qu’il était tenu à garantir la réparation des dommages apparus postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans à compter de la réception alors que par ailleurs et par des motifs adoptés des premiers juges elle avait relevé que les travaux de réparation effectués en 1998 à l’initiative de l’assureur avaient été « efficaces et pérennes » (étant observé que cette dernière affirmation était contraire à la réalité, la Cour de Versailles n’ayant que cité les propos de l’Expert Judiciaire, lequel avait néanmoins suggéré de retenir la responsabilité de l’entrepreneur réparateur pour n’avoir pas prévu ni réalisé le traitement des murs porteurs).
Dans le cadre de l’unique branche de son moyen unique l’assureur dommages ouvrage avait ajouté que les désordres ayant affecté les murs périphériques ne pouvaient être qualifiés de désordres évolutifs puisqu’ils n’étaient pas l’aggravation de désordres constitués par l’affaissement du dallage.
L’assureur dommages ouvrage soutenait aussi que l’obligation de préfinancement de travaux de nature à mettre fin aux désordres ne pouvait concerner que les travaux de reprise eux-mêmes et non la réalisation de travaux dont l’objet aurait été de prévenir l’apparition au-delà du délai décennal de nouveaux désordres.
8. La Cour de cassation rejettera le moyen en énonçant justement, et à bon escient, que la Cour de Versailles avait :
– relevé que les désordres constatés en 2002 trouvaient leur siège dans un ouvrage où un désordre de même nature avait été constaté dans le délai de la garantie décennale ;
– et souverainement retenu que l’extension dudit désordre était prévisible, et que ceux de 2002 ne se seraient nullement produits si les travaux de reprise de 1998 avaient été suffisants,
et dit en conséquence que la cour d’appel avait « exactement retenu » que la réparation à l’initiative de l’assureur dommages ouvrage « devait être pérenne et efficace » et qu’il devait « préfinancer les travaux nécessaires à la non-aggravation des dommages garantis ».
Étant observé qu’à l’occasion de la réponse au premier moyen du pourvoi incident de la société EURISK la Cour de cassation a en outre énoncé « que l’obligation de l’assureur dommages ouvrage à préfinancer les travaux nécessaires à la réparation des désordres de nature décennale n’est pas limitée à la réalisation des seuls travaux permettant à l’ouvrage, siège des désordres, d’atteindre sans nouveaux désordres, le délai de 10 ans courant à compter de la réception initiale de cet ouvrage ».
9. La question de l’efficacité de la réparation préfinancée par l’assureur dommages ouvrage a été abordée pour la première fois dans un arrêt du 18 décembre 2001 (Cass. 1re civ., 18 décembre 2001, no 99-10519, RGDA 2002, p. 124, note J.-P. Karila) dans le cadre d’un recours de l’assureur dommages ouvrage à l’encontre des constructeurs responsables de plein droit et des assureurs de responsabilité, la Cour de cassation ayant cassé pour violation des articles L. 121-12, L. 242-1 et L. 243-1 du Code des assurances un arrêt d’une cour d’appel qui, pour rejeter le recours de l’assureur concernant le coût des premiers travaux de reprise avait énoncé que ceux-ci s’étaient révélés inefficaces et qu’il appartenait à l’assureur dommages ouvrage de faire effectuer des travaux de reprise utiles et efficaces de sorte qu’il ne saurait se retrancher derrière l’accord des parties concernées pour se soustraire à sa responsabilité, alors que lesdits travaux ont été préconisés par son propre expert.
La cassation a été prononcée au considérant ci-après rapporté :
« Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors que, hors le cas de fraude établie, l’assureur dommages ouvrage, chargé par la loi de préfinancer la reprise des désordres qui affectent l’immeuble assuré, n’est pas tenu, à l’égard des participants à l’opération de construction responsables de ces désordres, de garantir l’efficacité des travaux qu’il finance, avec l’accord des autres parties, au vu du rapport de l’expert, lequel n’est pas son mandataire ; qu’en se prononçant comme elle a fait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
10. La question a été ensuite abordée plus « frontalement » par deux arrêts inédits le premier du 18 février 2003 (Cass. 1re civ., 18 février 2003, no 99-12203, RGDA 2003, p. 371, note A. Perinet-Marquet, RDI 2004 p. 100, obs. P. Dessuet), le second du 7 juillet 2004 (Cass. 3e civ., 7 juillet 2004, no 03-12325 RDI 2004, p. 419, obs. P. Dessuet) et le troisième du 7 décembre 2005 publié au Bulletin (Cass. 3e civ., 7 décembre 2005, no 04-17418, Bull. civ. III, no 235, RGDA 2006, p. 122, note J.-P. Karila), arrêt dont la portée a été éclairée par le rapport de la Cour de cassation de l’année 2005.
Aux termes du premier arrêt précité du 18 février 2003, la Haute Juridiction valide au visa de l’article L. 121-1 du Code des assurances consacrant le principe indemnitaire, un arrêt d’une cour d’appel qui avait relevé qu’un expert avait constaté que les travaux nécessaires n’avaient pu être réalisés en raison de l’indemnité insuffisante versée par l’assureur et qui était ainsi entrée en condamnation à l’encontre dudit assureur.
Aux termes du second arrêt précité du 7 juillet 2004, la Haute Juridiction pose plus clairement le principe de l’obligation de l’assureur dommages ouvrage de préfinancer autant de fois que nécessaire, les travaux aptes à assurer la réparation intégrale des dommages successivement intervenus, à raison notamment de l’insuffisance de l’indemnité d’assurance et/ou par voie de conséquence de l’étendue des travaux réparatoires.
On relèvera que l’arrêt dont s’agit a été rendu dans une espèce relative à des sinistres répétitifs (3 sinistres en 6 ans), la garantie de l’assureur ayant été retenue, nonobstant la renonciation par l’assuré, à l’occasion de la signature de la quittance d’indemnité du premier sinistre. Il avait été constaté en effet que les travaux de remise en l’état, exécutés à trois reprises en six ans, avaient été imposés par l’existence de sinistres répétitifs ayant chacun provoqué des dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination, et relevé que les réparations effectuées à deux reprises étaient sans lien avec l’apparition de nouveaux dommages, dont l’origine devait, en définitive, à la suite du troisième sinistre, être attribuée à un vice de conception relevant de la construction d’origine de l’ouvrage assuré.
La Haute Juridiction a ainsi validé un arrêt d’une cour d’appel qui « avait exactement retenu » que l’assureur dommages ouvrage devait assurer le préfinancement des travaux jusqu’à la réparation intégrale des dommages, ledit assureur n’étant pas libéré de ses obligations par le règlement du premier sinistre qui n’avait pas été de nature à mettre fin aux dommages.
Aux termes du troisième arrêt précité du 7 décembre 2005, la Haute Juridiction a cassé, toujours au visa de l’article L. 121-1 et L. 242-1 du Code des assurances un arrêt d’une cour d’appel qui pour débouter un particulier de sa demande en paiement formé contre l’assureur avait retenu que celui-ci n’était pas tenu de garantir l’efficacité des travaux de reprise, la cassation ayant été prononcée au motif :
« qu’en statuant ainsi, alors que le maître d’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages ouvrage est en droit d’obtenir le paiement des travaux de nature à mettre fin au désordre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
La solution a été depuis, à maintes reprises, réaffirmée (Cass. 3e civ. 24 mai 2006, no 05-11708, Bull. civ. III, no 133, RDI 2006, p. 266, obs. P. Dessuet ; Cass. 3e civ., 20 juin 2007, no 06-15686, RGDA 2007, p. 858, note M. Périer ; Cass 3e civ., 11 février 2009, no 07-21761, Bull. civ. III, no 33, RDI 2009, p. 258, obs. G. Leguay).
La formulation de l’arrêt rapporté s’inscrit en conséquence dans le prolongement des arrêts précités, le rejet du moyen ne pouvant en conséquence qu’être approuvé.
11. On retiendra de l’esprit, comme, dans la plupart des cas, de la lettre elle-même de la solution retenue par la Cour de cassation, que l’assureur dommages ouvrage ne garantit pas stricto sensu l’efficacité des travaux qu’il préfinance alors même que l’étendue desdits travaux aurait été suggérée par l’expert qu’il a désigné : seul l’entrepreneur/réparateur est tenu de la garantie des travaux qu’il réalise.
Néanmoins, il est également évident que l’indemnité offerte par l’assureur aux fins de préfinancement de travaux réparatoires doit être suffisante pour assurer l’efficacité de ceux-ci, ce qui ne conduit strictement pas à une garantie de l’assureur dommages ouvrage d’efficacité des travaux qu’il a préfinancés.
IV. ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE ET DÉSORDRES ÉVOLUTIFS
12. Dès lors que l’assurance dommages ouvrage est une assurance de choses, dont l’objet est de préfinancer, en dehors de toute recherche de responsabilité, les travaux nécessaires à la réparation des désordres de la nature de ceux… il faut se garder de confondre :
– la question des conditions d’admissibilité de la notion de désordres évolutifs qui sont des désordres survenus postérieurement à l’expiration de la garantie décennale mais dont la réparation/indemnisation est admise car ils ne sont que l’évolution, l’aggravation de précédents désordres survenus sur les mêmes ouvrages ou fractions d’ouvrage, pendant le délai de ladite garantie décennale et ayant donné lieu, pendant ce délai, à une réclamation ou une action judiciaire ;
– avec l’obligation pesant sur l’assureur dommages ouvrage d’offrir une indemnité suffisante à réparer efficacement les désordres survenus pendant le délai de la garantie et à prévenir, s’il y a lieu, l’apparition de nouveaux désordres dès lors que l’extension du désordre constaté est prévisible, notamment par la connaissance des causes et origines des désordres alors constatés et la définition de l’étendue des travaux de reprise desdits désordres.
L’obligation de l’assureur dommages ouvrage est en effet totalement indépendante des strictes conditions de l’admissibilité, au niveau des responsabilités encourues par les constructeurs du caractère évolutif ou non des désordres.
En ce sens, il importe peu que les désordres initiaux, dont le caractère décennal doit être établi, aient ou non fait l’objet d’une action judiciaire pendant le délai de la garantie décennale : il suffit, au regard de l’obligation de l’assureur dommages ouvrage, qu’ils aient présenté la gravité nécessaire à la mise en œuvre de la garantie décennale d’une part, et que les désordres nouveaux constituent l’aggravation des premiers, qu’ils soient de même nature et affectent les mêmes ouvrages.
Étant rappelé au surplus que l’assureur dommages ouvrage peut-être tenu au-delà du délai de 10 ans visé par l’article 2270 du Code civil dès lors que l’assuré agit en son encontre dans le délai de 2 ans visé par l’article L. 114-1 du Code des assurances, à compter du jour où il a eu connaissance du désordre survenu pendant le délai précité de 10 ans (Cass. 1re civ., 4 mai 1999, no 97-13198, Bull. civ. I, no 141, RGDA 1999, p. 1037, note J.-P. Karila ; Cass. 1re civ., 29 avril 2003, no 01-12406).
V. LA DISTINCTION DES RESPONSABILITÉS ENCOURUES À L’OCCASION DE LA PERSISTANCE OU DE L’EXTENSION DE DÉSORDRES APRÈS L’EXÉCUTION DES TRAVAUX DE REPRISE D’OUVRAGE EXISTANTS
13. Le cas d’espèce renvoie à la question des responsabilités encourues à l’occasion de l’insuffisance des travaux de reprise sur existants ou encore de la persistance ou de l’extension de désordres nonobstant la réalisation de travaux réparatoires sur existants.
La multiplicité des cas de figure possibles, à raison des diverses sources possibles des causes et origines des dommages affectant les travaux réparatoires eux-mêmes ou les existants non directement concernés par lesdits travaux réparatoires, renvoie à des responsabilités de nature différente et par conséquent à des délais d’action en principe également différents (sur l’ensemble de la question, voir par J.-P. Karila in Construction et Urbanisme 2006, étude no 2 : « Les responsabilités encourues par les constructeurs d’ouvrage immobilier après réception des travaux de rénovation ou de réparation d’ouvrage existants »).
14. Le rejet du premier moyen principal de l’entrepreneur/réparateur et de son assureur, dont on peut comprendre qu’il ait été présenté, à raison du défaut de motivation de l’arrêt de la Cour de Versailles du 1er février 2010, est en la circonstance parfaitement justifié puisqu’il était prétendu à la violation de l’article 2270 du Code civil , alors que l’expiration du délai de la garantie décennale courant à compter de la réception des travaux de construction de la maison individuelle soit le 9 juin 1989 , était indifférent/sans effet sur l’action des consorts Z. et A. à l’encontre de l’entrepreneur/réparateur qui n’avait fait que réaliser des travaux de reprise en 1998 .
Si en effet les travaux de reprise effectués par l’entrepreneur/réparateur sont jugés insuffisants, sa responsabilité peut être retenue mais le délai d’action concernant cette responsabilité ne peut être computée qu’à partir de la réception des travaux de réparation qu’il a effectués et non pas à compter de la réception des travaux de construction de la maison individuelle, à laquelle il n’a pas participé.
Le rejet du premier moyen du pourvoi principal en raison de son caractère inopérant, pour les motifs précités est donc parfaitement justifié.
15. Dans ce contexte on rappellera par ailleurs que la Cour de Versailles n’a pas formellement retenu la responsabilité décennale de l’entrepreneur/réparateur à raison du manquement à l’obligation de conseil de celui-ci, qualifiant ledit manquement de faute contractuelle à l’égard de l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage d’une part, et de faute délictuelle à l’égard notamment des acquéreurs Z. et A. de la maison individuelle d’autre part.
Il appartiendra en conséquence à la Cour de renvoi – c’est-à-dire en la circonstance la Cour de Versailles elle-même, bien évidemment autrement composée – de déterminer si les travaux de l’entrepreneur/réparateur ont ou non été mal conçus et/ou mal exécutés et si les désordres ayant affecté les murs périphériques sont imputables aux seuls constructeurs d’origine ou également audit entrepreneur/réparateur.
VI. LES RAPPORTS DE L’ASSUREUR DOMMAGES OUVRAGE ET DE L’EXPERT DÉSIGNÉ PAR CELUI-CI ET LES RESPONSABILITÉS ENCOURUES PAR LEDIT EXPERT (pourvoi incident de l’expert)
16. À l’appui de son pourvoi incident, la Société EURISK avait présenté deux moyens de cassation comportant chacun plusieurs branches savoir :
– un premier moyen de cassation comportant :
• une première branche prétendant à la violation des articles L. 242-1 du Code des assurances et à l’annexe 1 de l’article A 243-1 dudit Code, ensemble les articles 2270 et 1382 du Code civil ;
• une deuxième branche prétendant à un manque de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code des assurances, 2270 et 1382 du Code civil ;
• une troisième branche prétendant à la violation de l’article 1382 du Code civil ;
– un second moyen comportant deux branches soutenant chacune la violation de l’article 1147 du Code civil.
La profusion des textes visés au nombre desquels on aura remarqué que ne sont pas visés les articles 1984 et suivants du Code civil relatifs au mandat , ce qui est logique et normal, la Société EURISK n’ayant pas eu, à l’égard de l’assureur dommages ouvrage la qualité de mandataire, ni les articles 1710 ou encore 1779 et suivants du Code civil en ce qu’ils se réfèrent au louage d’ouvrage ce qui aurait pu se comprendre au regard de la mission confiée audit expert, s’explique par la difficulté qu’il y a à qualifier la nature juridique des rapports de l’assureur dommages ouvrage et de l’expert qu’il désigne.
17. On rappellera ici que la désignation par l’assureur dommages ouvrage d’un expert, sous le contrôle d’ailleurs de l’assuré qui peut le récuser, s’inscrit dans le cadre de l’obligation contractuelle pesant sur lui en vertu d’un texte règlementaire d’ordre public , le contrat, en la circonstance, ne faisant que reproduire la clause type établie par le pouvoir réglementaire en vertu d’une habilitation de la loi.
S’agissant d’un contrat, ne relevant pas stricto sensu de l’autonomie de la volonté des parties mais de la loi et du règlement, on peut s’interroger sur la nature juridique de la responsabilité encourue par l’expert en cas de manquement aux obligations pesant sur lui, en vertu de la mission que lui confie l’assureur, mais dont le contenu est précisé par la loi et le règlement.
On comprend dès lors que la Cour de Versailles, comme d’ailleurs la Haute Juridiction, se soient abstenues de qualifier précisément la nature juridique de la responsabilité encourue par l’expert au titre de la « faute dans son devoir de conseil »…
Si l’on veut néanmoins qualifier juridiquement le rapport contractuel qui se créerait entre l’assureur dommages ouvrage et l’expert que celui-ci désigne, celui-ci ne pourrait être que le louage d’ouvrage ou encore le contrat d’entreprise et en aucun cas le mandat.
18. Dans tous les cas il nous semble que la responsabilité de l’expert désigné par l’assureur dommages ouvrage dans le contexte ci-dessus évoqué est nécessairement une responsabilité pour faute prouvée dont la mise en œuvre suppose classiquement en outre l’établissement d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice subi.
19. Dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité de la Société EURSIK a été retenue au titre d’un manquement à son obligation de conseil .
On peut néanmoins se demander si une telle obligation pèse effectivement sur l’expert désigné par l’assureur alors que la mission lui est confiée par ledit assureur et les conditions d’exécution de celle-ci sont strictement réglementées et fixées à l’annexe I A 243-1 du Code des assurances.
Plus précisément, il résulte des dispositions du paragraphe B/ « Obligations de l’assureur en cas de sinistre » du titre « Obligations réciproques des parties », que l’expertise se déroule en deux ou trois étapes, selon que l’assureur prend, à l’égard de l’assuré, une position positive ou négative quant à la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance, savoir :
1o/ constat des dommages déclarés ;
2o/ rapport préliminaire/mise en jeu des garanties/mesures conservatoires ;
3o/ rapport d’expertise/détermination et règlement de l’indemnité.
C’est ainsi qu’en application du 1o/ ci-dessus :
« Les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d’un expert, personne physique ou morale, désigné par l’assureur.
…
Les opérations de l’expert revêtent le caractère contradictoire. L’assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l’assuré sont contresignées dans le rapport de l’expert. » (Paragraphe B/ 1o/ a/).
C’est ainsi encore que la clause type précise :
« La mission d’expertise définie en a) est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis » (paragraphe B/ 1o/ c/).
20. Le rôle de l’expert désigné par l’assureur sous le contrôle de l’assuré est donc en principe limité à l’examen des dommages visés dans la déclaration de sinistre, sauf que le « rassemblement des données strictement indispensables » notamment « à la réparation rapide des dommages garantis » implique que ledit expert s’interroge et/ou encore procède ou fasse procéder à la détermination des causes et origines des dommages déclarés : c’est ici que se situent la difficulté et l’éventuelle obligation, sinon stricto sensu de conseil, mais d’information et/ou d’alerte ou de mise en garde de l’expert vis-à-vis de l’assureur dommages ouvrage, comme éventuellement même vis-à-vis de l’assuré.
En la circonstance, la consultation par la Société EURISK, du bureau d’étude de sols CEBTP-SOLEN aux fins de détermination des causes et origines de l’affaissement du dallage avait donné lieu à un rapport concluant à l’inadaptation des fondations à la nature du sol, de sorte que la Société EURISK aurait dû s’interroger, eu égard aux causes des désordres constatés, si ces mêmes causes n’étaient pas susceptibles de conduire, dans un plus ou moins proche avenir à des dommages affectant les murs périphériques entourant le dallage lui-même.
21. Dans ce contexte c’est à tort qu’il a été prétendu à la violation de l’article L 242-1 du Code des assurances, de l’annexe I à l’article A 243-1 du même code comme celle de l’article 2270 du Code civil, l’argumentation soutenant de telles prétentions confondant les notions de désordre évolutif et de désordre futur.
Il était par ailleurs évident que si la faute de l’expert devait être retenue, elle était nécessairement à l’origine des préjudices subis.
De sorte que c’est à juste titre que la Haute Juridiction a rejeté les deux moyens du pourvoi incident de la Société EURISK.
VII. SUR L’OBLIGATION DU JUGE DE STATUER DANS LES STRICTES LIMITES DE L’OBJET DU LITIGE
22. L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions des parties.
Dans la stricte logique de ce texte, l’article 5 qui le suit immédiatement, dispose que le « juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 12 du Code précité énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables d’une part, et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée .
La combinaison des textes précités notamment des articles 4 et 12 peut se révéler quelquefois difficile.
23. Le juge peut en conséquence, dans le cadre de l’application de l’article 12 précité, statuer par inadvertance en dehors de l’objet du litige tel que déterminé par les parties (article 4 du CPC) voire même ultra petita (article 5 du CPC).
En la circonstance la violation par la Cour de Versailles de l’article 4 du Code de procédure civile était manifeste et peu « excusable ».
On voit mal en effet et alors que la Société EURISK invoquait, à tort ou à raison, une faute délictuelle de l’entrepreneur/réparateur, c’est-à-dire de la Société PSC devenue ARCADIS ESG à son égard, comment la Cour de Versailles a pu retenir l’existence d’une faute contractuelle sans, pour le moins, inviter au préalable les parties, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile à présenter leurs observations sur ce changement de fondement juridique de la responsabilité encourue.
On voit mal encore comment la Cour de Versailles a pu retenir la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur/réparateur à l’égard des consorts Z. et A. qui n’avaient passé avec lui aucun contrat et qui invoquaient à son encontre une garantie légale en la circonstance la garantie décennale !…
La violation de l’article 4 était donc avérée et a été à juste titre sanctionnée.
On peut cependant s’interroger sur la pertinence du visa de l’article 5 du Code de procédure civile dès lors que la Cour de Versailles n’a pas, selon nous, à proprement parler, statué ultra petita.
Elle a, selon nous, seulement et en appliquant mal les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile, violé de façon flagrante l’article 4 dudit code et outrepassé ainsi son office.
J.-P. Karila – RGDA n° 2011-04, P. 1023