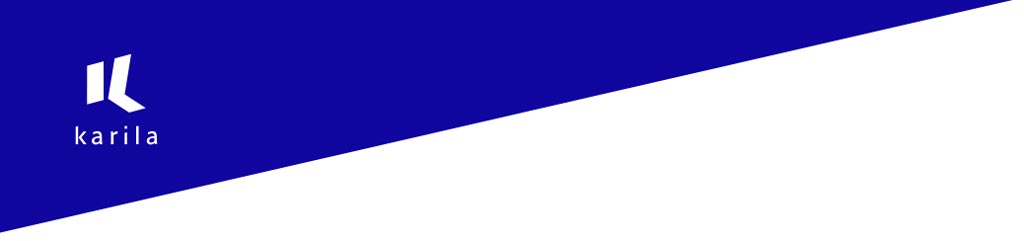Ancien ID : 702
Transaction après désordres. Portée. Garantie décennale : nécessité de préciser la date de la réception. Responsabilité extracontractuelle : nécessité de préciser la date d’apparition des désordres.
Une cour d’appel qui retient, sans dénaturation, que la transaction intervenue entre les parties mettait fin au litige, et comportait une renonciation à tout recours concernant des désordres de même nature, en déduit exactement que cette transaction interdisait, à l’égard de l’assureur de responsabilité décennale, toute recherche de responsabilité pour les désordres de la nature de ceux qui étaient visés dans la transaction.Ne donne pas de base légale à sa décision la cour qui, pour déclarer irrecevable la demande dirigée contre un sous-traitant et son assureur, retient que l’action extracontractuelle se prescrit par dix ans, sans rechercher la date à laquelle lesdits désordres étaient survenus.
Cour de cassation (3e Ch. civ.) 31 octobre 2001
Époux Lopet c/ Rafoni et autres
La Cour,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 16 février 2000), qu’en 1977, les époux Lopet, maîtres de l’ouvrage, ont chargé de la construction d’une maison la société Orcobat, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Rafoni comme liquidateur, assurée par la compagnie La Cordialité Bâloise devenue La Bâloise, qui a sous traité des travaux à la société Rosa, également en liquidation judiciaire avec M. Douhaire pour liquidateur, assurée par la compagnie Le Nord, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via Assurances (compagnie Allianz) ; que la réception est intervenue le 14 octobre 1978 ; que des fissures étant apparues, les époux Lopet ont, aux termes d’un protocole d’accord du 22 juin 1984 accepté les travaux de reprise exécutés par la société Bâti 2000, depuis en redressement judiciaire ayant M. Nespoulos et Mme Bonardi comme administrateur et représentant des créanciers, assurée par la société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), suivant la conception et la direction de la société Grima ; qu’à la suite de fissurations et désordres nouveaux, les époux Lopet ont assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ;
Attendu que les époux Lopet font grief à l’arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes dirigées contre M. Rafoni et la compagnie La Bâloise, alors, selon le moyen : « 1o que les transactions se renferment par leur objet et que la renonciation faite à tous droits et prétentions ne s’entend que de qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu’en l’espèce, la renonciation par les époux Lopet à tout recours contre les constructeurs et leurs assureurs exprimée dans le protocole du 22 juin 1984 ne portait que sur la nature et le volume des travaux de reprise préconisés par l’expert Regeste et non sur la qualité ni l’efficacité desdits travaux de reprise ; que dès lors, en jugeant que la transaction interdisait aux époux Lopet toute recherche de responsabilité de la nature de ceux visés dans le protocole, la cour d’appel s’est livrée à une interprétation extensive de la transaction et a en conséquence, violé les dispositions de l’article 2048 du Code civil ;
2o que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu’en l’espèce, les constructeurs et leurs assureurs respectifs se sont engagés à effectuer des travaux de reprise et ont, par là même, reconnu leur responsabilité dans les désordres survenus ; que cette reconnaissance de leur responsabilité par les constructeurs et leurs assureurs constituait une cause d’interruption de la prescription décennale ; qu’en conséquence, en jugeant irrecevable la demande des époux Lopet contre la société Orcobat et la compagnie La Bâloise, formée en octobre 1989, alors que le délai de garantie décennale avait été interrompu par la transaction du 22 juin 1984, la cour d’appel a violé l’article 2270 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant retenu, sans dénaturation, que le « protocole transactionnel » intervenu entre les parties le 22 juin 1984 mettait fin au litige concernant les fissurations initiales dès lors qu’il était sans réserve et souscrit au bénéfice de la renonciation à tout recours, la cour d’appel en a exactement déduit que cette transaction interdisait, à l’égard de la compagnie La Bâloise, toute recherche de responsabilité pour les désordres de la nature de ceux qui y étaient visés ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que les époux Lopet font grief à l’arrêt de rejeter leur demande dirigée contre M. Bonardi et la SMABTP, alors, selon le moyen ;
1o que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil envers le maître de l’ouvrage quant à l’efficacité des travaux qu’il exécute, même s’il les effectue sur les indications d’un maître d’oeuvre chargé de la conception de ces travaux ; qu’en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les époux Lopet, si la société Bâti 2000 n’avait pas manqué à son obligation de conseil, la cour d’appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
2o qu’en ne recherchant pas si le fait de l’apparition ou la réapparition de fissures qui avaient été traitées dans le cadre des opérations de reprise en sous oeuvre réalisées parla société Bâti 2000, constatées par M. Baestle dans son rapport d’expertise, n’établissait pas que cette entreprise avait manqué aux règles de l’art et avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé qu’en l’absence de tout lien contractuel, l’action des époux Lopet contre la société Bâti 2000 ne pouvait être fondée que sur la preuve d’une faute et constaté que l’expert judiciaire désigné pour examiner les fissures et désordres en relation avec les travaux de reprise en sous-oeuvre avait noté que ces travaux, que la société Bâti 2000 avait réalisés suivant les directives reçues par les experts du « STAC », avec l’accord de l’assureur et des époux Lopet, étaient exempts de toute réserve, la cour d’appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constations rendaient inopérante, a retenu que la preuve de la faute de la société Bâti 2000, dont l’administration incombait aux époux Lopet, n’était pas rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l’article 2270-1 du Code civil, ensemble l’article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande dirigée contre la société Rosa et la compagnie Allianz, l’arrêt retient que l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrit par dix ans ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle s’étaient réalisés les désordres, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l’article 2270 du Code civil, ensemble l’article 2270-1 du même code ;
Attendu que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ; que les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande dirigée contre la société Grima, l’arrêt retient qu’à l’égard de ce bureau d’études, qui a fait procéder aux reprises en sous-oeuvre courant 1984, le délai de dix ans était expiré à la date de l’assignation en intervention du 23 août 1995 tant sur le plan de l’article 1792 que de l’article 2270 du Code civil ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater la date de réception des travaux de reprise en sous-oeuvre exécutés sous la direction de la société Grima et la date d’apparition des fissures et désordres affectant ces travaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
Casse.
NOTE
1. Le rejet du premier moyen du pourvoi, par l’arrêt rapporté, conduit à inviter les rédacteurs de protocoles transactionnels à mieux les rédiger, tandis que la cassation prononcée sur le deuxième et le troisième moyens conduit à inviter les juges du fond à mieux rédiger et à mieux motiver juridiquement leurs décisions, et ce, pour les raisons qui seront exposées ci-après.
2. On sait, conformément à l’article 2248 du Code civil, que la transaction se referme nécessairement sur son objet, comme d’ailleurs le rappelait le demandeur au pourvoi, qui néanmoins, s’agissant de la renonciation à recours que comportait ladite transaction, avait tenté d’en restreindre la portée, occultant de ce fait la règle posée par l’article 2252 du Code civil, selon laquelle la transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
En la circonstance, si l’acte de transaction se référait bien évidemment à des désordres identifiés, s’agissant d’infiltrations, il reste qu’il y a été stipulé en outre une renonciation à recours concernant les désordres de même nature, en sorte que tout recours était impossible pour des infiltrations de même nature qui pouvaient survenir postérieurement à l’exécution de la transaction (travaux de reprises des désordres initiaux) aux mêmes endroits ou à d’autres endroits.
Le ou les rédacteurs du « protocole transactionnel » a ou ont été sans doute maladroit, à moins que, car cela n’est pas impossible, ce soit consciemment qu’il ait été ainsi stipulé, à raison notamment du fait qu’à l’époque de la transaction, le délai d’action en garantie décennale était – sauf l’effet de l’interruption – déjà expiré.
Le moyen fondé sur la violation de l’article 2048 du Code civil ne pouvait donc prospérer.
Il ne pouvait non plus, être utilement excipé d’une violation de l’article 2270 du Code civil, à l’égard de l’assureur de responsabilité, et seulement à l’égard de l’assureur de responsabilité, au prétexte que la transaction constituait une cause d’interruption de la prescription biennale ; certes, la reconnaissance de responsabilité de l’assuré est une cause d’interruption de la responsabilité encourue par celui-ci pour les désordres visés dans la transaction ; certes, il est admis que l’exécution des travaux de réparation peut donner lieu, après leur réception, à un nouveau délai de la garantie décennale, si toutefois les travaux considérés sont suffisamment importants pour constituer la construction d’un ouvrage, mais la renonciation à recours à l’encontre de l’assureur était licite, dès lors qu’elle ne pouvait tomber sous le coup de l’article 1792-5 du Code civil, puisque le chantier relevait de la loi du 3 janvier 1967, ni pour la même raison, sous le coup de l’article L. 241-1 du Code civil, imposant la pérennité de l’assurance pendant toute la durée de la responsabilité de l’assuré.
3. Le deuxième moyen de cassation ne pouvait qu’être accueilli en application de l’article 2270-1 du Code civil, dès lors que pour l’action dirigée contre l’assureur du sous-traitant, la cour d’appel ne pouvait se contenter d’énoncer que l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrivait par dix ans, sans rechercher et préciser le point de départ de la computation dudit délai de dix ans, c’est-à-dire la date de survenance des désordres.
4. Le troisième moyen de cassation a également, à juste titre, été accueilli favorablement, en application, cette fois-ci, de l’article 2270 du Code civil et de l’article 2270-1 dudit code.
Il convient de préciser ici que la cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande formée à l’encontre d’un bureau d’études, « tant sur le plan de l’article 1792 que sur celui-ci de l’article 2270 du Code civil », alors que ledit bureau d’études n’était pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, en sorte que les articles précités du Code civil étaient, à l’évidence, insusceptibles d’application, s’agissant d’un bureau d’études qui avait fait procéder, à la demande d’un assureur, aux travaux de reprises qu’il avait, semble t-il, également dirigés.
La Cour suprême, après avoir rappelé dans un « chapeau » concernant ce moyen, que le délai de dix ans de l’action au titre de la garantie décennale se compute à compter de la réception des travaux, tandis que celui, toujours de dix ans, de l’action engagée au titre de la responsabilité extracontractuelle se compute à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, casse l’arrêt de la cour d’appel, au motif que celle-ci n’avait pas constaté la date de la réception des travaux de reprises, ni celle d’apparition des nouveaux désordres affectant ces travaux, laissant en quelque sorte à la juridiction de renvoi le soin de décider si la garantie décennale ou la responsabilité extracontractuelle est, en la circonstance, applicable.
5. Enfin, la Cour suprême rejette le quatrième moyen du pourvoi qui soutenait une violation de l’article 1382 du Code civil, au motif que la cour n’avait pas recherché si l’entrepreneur n’avait pas manqué à son obligation de conseil (première branche), ni recherché si la réapparition des désordres, n’établissait pas que cette entreprise avait manqué aux règles de l’art et avait commis une faute engageant sa responsabilité (deuxième branche).
Le rejet est fondé sur le fait que la cour avait retenu que la preuve de la faute du constructeur concerné non lié au maître de l’ouvrage n’avait pas été rapportée, et s’agissant de l’obligation de conseil et de la violation des règles de l’art, la cour énonce à juste titre que la cour d’appel n’était pas tenue à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.
L’arrêt, sur ce point, ne peut ici encore qu’être approuvé.
J.-P. Karila – RGDA 2002-01 p. 131