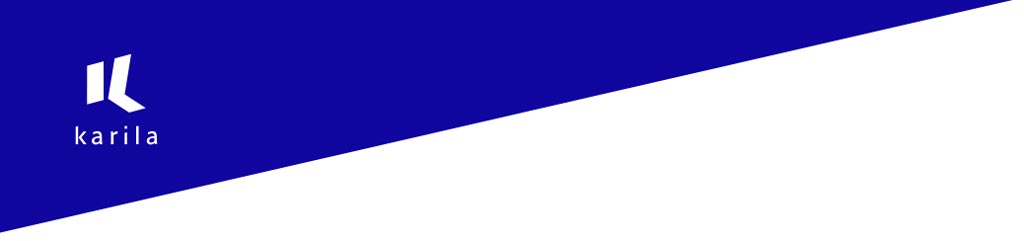Ancien ID : 132
Assurance construction. Assurance de responsabilité décennale
Date d’effet de la garantie. Échange standard d’équipement (insert d’une cheminée). Travail de construction (non). Recours des co-obligés entre eux.
Dès lors que l’entrepreneur principal ne disconvient pas qu’il doit répondre des vices cachés affectant le dispositif d’une cheminée, dont la réception a été prononcée avant la date d’effet du contrat d’assurance d’une part, et que l’intervention sur l’ouvrage considéré pendant la période de validité du contrat ne constitue pas un travail de construction d’un ouvrage d’autre part, la cour d’appel a pu retenir que le fait dommageable s’était produit avant la prise d’effet du contrat d’assurance et n’entraînait donc pas dans la garantie de l’assureur.
Cour de cassation (3e Ch. civ.) 16 septembre 2003
Sté Axa Conseil Iard c/ Sté Plus International & autres
Pourvoi n° 02-12607
La Cour,
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2001), qu’après avoir obtenu de la société Plus International la fourniture et la pose d’une cheminée à foyer ouvert, M. et Mme Guellec ont, ultérieurement, commandé en 1989 à cette même société la fourniture et la pose d’une cheminée à foyer fermé à installer à l’intérieur de la cheminée existante ; que des anomalies s’étant manifestées sur cet ouvrage dont la réalisation avait été confiée à M. Jambou, assuré auprès de la compagnie MAAF, la société Plus International a fait procéder, courant 1994 au remplacement du foyer fermé, par la société Fouquet, actuellement en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa conseil ; qu’un incendie trouvant sa cause dans cette installation a détruit l’immeuble des maîtres de l’ouvrage qui ont fait assigner en réparation de leur préjudice, notamment, la société Plus International laquelle a appelé en garantie la compagnie d’assurances Le Continent auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat à effet au 15 mai 1992 ;
Attendu que la société Plus International fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en garantie formée à l’encontre de son assureur, alors, selon le moyen qu’il résulte des propres constatations du jugement confirmé que la société Plus International était intervenue une seconde fois en 1994 pour faire procéder au remplacement de l’insert initialement posé, ce qui nécessairement avait occasionné une nouvelle ouverture de chantier en période de validité du contrat ; qu’en écartant cependant la garantie de la compagnie La Concorde au prétexte que « cette seconde intervention n’est que la suite de la première intervention au cours de laquelle les travaux correspondant à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ont été réalisés ; que l’ouverture de chantier au sens contractuel du terme ne peut être fixée qu’en septembre 1989, c’est-à-dire à une date antérieure à la prise d’effet du contrat… », les juges du fond ont violé, par refus d’application les stipulations susdites de la police d’assurance et violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société Plus International ne disconvenait pas qu’elle devait répondre des vices cachés affectant le dispositif de cheminée dont la réception était intervenue le 12 décembre 1989, et que, par ailleurs, la société Fouquet, sous-traitant de cette entreprise n’était pas intervenue, courant 1994, en exécution d’une mission de construction d’un ouvrage, mais de réalisation d’un simple échange « standard » de deux équipements réputés interchangeables, la cour d’appel a pu retenir que le fait dommageable s’était produit avant la prise d’effet du contrat d’assurance et n’entraînait donc pas la garantie de la compagnie Le Continent ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pouvoir principal :
Vu l’article 1213 du Code civil ;
Attendu que l’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ;
Attendu que pour procéder à la répartition entre co-obligés de la charge finale de la condamnation, l’arrêt retient que la société Fouquet et M. Jambou, ainsi que leurs assureurs respectifs auront un recours réciproque, selon qu’ils seront l’un ou l’autre poursuivis par la société Plus International, à hauteur de 35 % ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la faute de la société Fouquet était bien moindre que celle de M. Jambou sur qui pesait la charge essentielle de réaliser un ouvrage exempt de vices cachés, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Par ces motifs :
Casse et annule…
Note
1. Il est quelquefois difficile de commenter un arrêt de la Cour Suprême sans être en possession de l’arrêt d’appel, voire des écritures prises devant cette juridiction : tel est le cas de l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rapporté, lui-même intéressant à un double titre :
– d’abord en ce qu’il a trait à la période de la couverture d’assurance de la responsabilité décennale (moyen unique du pourvoi incident) ;
– ensuite en ce qu’il a trait à la question du partage d’une dette commune entre co-obligés in solidum (moyen unique du pourvoi principal).
Arrêt qui implique pour les raisons indiquées ci-dessus que soient au préalable rappelé avec une certaine minutie les faits et circonstances de l’espèce.
1) Les faits de l’espèce
2. Les faits de la cause tels qu’ils peuvent être déduits de la lecture des moyens de cassation proposés sont ceux ci-après résumés :
À une date indéterminée, des particuliers en leur qualité de maître d’ouvrage, commandent à une société Plus International la fourniture et la pose d’une cheminée à foyer ouvert ; ultérieurement et en septembre 1989, ces mêmes particuliers commandent à la même entreprise la fourniture et la pose d’une cheminée fermée à installer à l’intérieur de la cheminée existante ; ces nouveaux travaux de 1989 sont de facto réalisés par un Sieur Jambou en qualité de sous-traitant de la société précitée Plus International ; des anomalies ayant été constatées, cette dernière société fait procéder en 1994 par un autre sous-traitant – en la circonstance une société Fouquet -, au remplacement du foyer fermé ; ultérieurement, et à une date indéterminée, un incendie survient dans la cheminée et provoque la destruction totale de l’immeuble.
Au moment de la réalisation des travaux de 1989, la société Plus International précitée était assurée par une police multirisques qui excluait de la couverture d’assurance la garantie décennale, tandis que le sous-traitant Jambou était assuré par un autre assureur au titre de la garantie décennale.
À l’époque de l’intervention du second sous-traitant, la société Fouquet en 1994, la société Plus International précitée était assurée par un contrat d’assurance de responsabilité civile décennale à effet du 15 mai 1992.
Au titre des conséquences matérielles et immatérielles de l’incendie, les particuliers / maître d’ouvrage poursuivent en justice la société Plus International précitée, laquelle appelle en garantie son assureur la Compagnie Le Continent ; d’autres mises en cause sont effectuées de sorte que sont parties au procès :
– la société Plus International et son assureur de responsabilité décennale la Compagnie le Continent,
– le sous-traitant des travaux réalisés en 1989, c’est-à-dire le Sieur Jambou et son assureur la MAAF,
– le sous-traitant Fouquet qui avait réalisé les travaux de 1994 et son assureur la Compagnie UAP devenue par la suite Axa Conseil.
La cour d’appel rejette l’action en garantie de l’entrepreneur principal la société précitée Plus International à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale, la Compagnie Le Continent, et entre en condamnation in solidum à l’encontre dudit entrepreneur principal et des sous-traitants successifs de celui-ci et de leurs assureurs respectifs, la MAAF d’une part et Axa Conseil d’autre part, et enfin procède à la répartition entre co-obligés de la charge finale de la condamnation.
2) Sur la période de la couverture d’assurance de la responsabilité décennale (moyen unique du pourvoi incident)
3. La loi (art. L. 242-1 C. assur.) et la clause-type relative à la durée de la couverture d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale (ann. I à l’art. A. 243-1 dudit code) règlent, en principe la question, dans des conditions qui semblent avoir été mal appréciées en jurisprudence de sorte qu’il existe à cet égard un débat doctrinal voire jurisprudentiel sur lequel nous reviendrons ci-après.
Ce n’est pas, en effet, sur le fondement des textes ci-dessus évoqués que le litige a été tranché par la cour d’appel, mais en fonction du contenu d’une stipulation du contrat d’assurance qui énonçait que la garantie s’appliquerait « aux travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat », lequel avait été souscrit, comme déjà dit ci-dessus, à effet du 15 mai 2002, la Cour Suprême ayant quant à elle rejeté le moyen unique du pourvoi incident, fondé uniquement sur la violation, par refus d’application de la stipulation contractuelle ci-dessus évoquée, ainsi que de l’article 1134 du Code civil.
4. Pour prétendre à la garantie de son assureur, la société Plus International précitée, avait soutenu que la garantie de celui-ci était acquise dès lors que la seconde intervention de son second sous-traitant en 1994 avait nécessairement provoqué une nouvelle ouverture de chantier en période donc de validité du contrat d’assurance souscrit à effet du 15 mai 1992.
La cour d’appel avait écarté cette prétention en retenant que l’ouverture de chantier « au sens contractuel du terme ne peut être fixée qu’en septembre 1989, c’est-à-dire à une période antérieure à la prise d’effet du contrat… » d’une part, et que « le seul contrat d’entreprise appelant la mise en jeu de la garantie décennale de l’article 1792 du Code civil résulte… du bon de commande du 27 septembre 1989 mis à exécution le 12 décembre 1989 (livraison), soit avant le 15 mai 1992, date de prise d’effet de la police responsabilité décennale no … ».
5. Dans le cadre d’un contrôle dit « léger » la Cour Suprême valide l’arrêt sur ce point en énonçant « qu’ayant relevé que la société Plus International ne disconvenait pas qu’elle devait répondre des vices cachés affectant le dispositif de cheminée dont la réception était intervenue le 12 décembre 1989 et que par ailleurs la société Fouquet, sous-traitante de cette entreprise n’était pas intervenue courant 1994 en exécution d’une mission de construction d’un ouvrage, mais de réalisation d’un simple « échange standard » de deux équipements réputés inter-changeables, la cour d’appel a pu retenir que le fait dommageable s’était produit avant la prise d’effet du contrat d’assurance et n’entraînait donc pas la garantie de la Compagnie Le Continent ».
La solution ne peut qu’être approuvée.
6. Aurait-elle été différente si le débat s’était instauré non sur le plan contractuel mais sur celui des textes ci-dessus évoqués du Code des assurances
Cela n’est pas certain puisqu’aussi bien le moyen unique du pourvoi incident ne critiquait pas le Juge du fond d’avoir considéré que l’intervention en 1994 de la société Fouquet ne se situait pas dans le cadre de l’exécution d’une mission de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, de sorte que la question de savoir si cette intervention avait ou non « nécessairement occasionné une nouvelle ouverture de chantier en période de validité du contrat » ne présentait aucun intérêt.
7. Si l’on fait abstraction de cet épiphénomène, et si l’intervention de la société Fouquet en 1994 avait été considérée comme constitutive de la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792, on pourrait alors se poser la question de savoir si la cour d’appel aurait rendu la même décision, et si la Cour Suprême, dans cette dernière hypothèse, aurait toujours validé l’arrêt frappé de pourvoi, alors qu’il lui aurait été posé la seule question qui aurait dû l’être à notre avis et qui consistait à déterminer ce qu’il fallait entendre par « ouverture de chantier », non pas en la circonstance « au sens contractuel du terme », mais au sens de la loi ou du règlement qui sont censés régler la question.
Il nous semble en effet qu’en ce qui concerne notamment la durée de la couverture d’assurance, le contenu du contrat importe peu puisque ledit contrat d’assurance – s’agissant de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale – n’est que la reproduction obligée des clauses types réglementaires et d’ordre public d’une part, et que l’article L. 243-8 du Code des assurances qui énonce que le contrat d’assurance couvrant la responsabilité décennale « est (…) réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types… » aboutit, de facto, à ce qu’il ne soit pas possible en ce qui concerne la durée de l’assurance, de stipuler une durée et un point de départ de ladite durée différente de celle envisagée par la Loi ou le règlement.
8. À cet égard, il convient de rappeler ce qu’énoncent la Loi et le règlement, car la question est débattue, depuis pour le moins un arrêt de la 1re Chambre civile du 7 mai 2002, non forcément condamné, comme on pourrait le croire, par un autre arrêt rendu par cette même première Chambre civile le 29 avril 2003.
L’article L. 241-1 du Code des assurances édicte en son alinéa 1, l’obligation pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établi par l’article 1792 du Code civil, à propos de travaux de bâtiment, d’être « couverte par une assurance » et ajoute en son alinéa 2 : « à l’ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité ».
L’article L. 241-2 du Code des assurances impose de son côté une obligation d’assurance identique pour ce qu’il est convenu de dénommer les constructeurs non réalisateurs (promoteurs construisant pour autrui en vue de la vente, marchands de biens, etc.), tandis que l’article L. 242-1 dudit code impose l’obligation de la souscription d’une assurance de chose dite « assurance dommages ouvrage » et ce « avant l’ouverture du chantier » à toute personne physique ou morale agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, l’assurance garantissant en dehors de toute recherche des responsabilités, les paiements de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
L’article R. 243-2 du Code des assurances relatif à « la justification de l’assurance » énonce quant à lui, par référence à l’article L. 243-2 dudit Code relatif aux mentions obligatoires que doit comporter tout acte de transfert de propriété ou de jouissance d’un bien (à l’exception toutefois des baux à loyer), que les justifications prévues doivent être apportées « lors de la déclaration d’ouverture du chantier, à l’autorité compétente pour recevoir cette déclaration ».
Enfin, les clauses types applicables au contrat d’assurance de la responsabilité décennale visent (ann. I, art. A. 243-1) quant à elles « les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier », tandis que l’article 14 de la Loi du 4 janvier 1978, codifié depuis (art. L. 111-41 du CCH) relatif à l’application dans le temps de ladite Loi, fait référence « au contrat relatif aux chantiers dont la déclaration réglementaire d’ouverture est établie » postérieurement au 1er janvier 1979.
Ainsi les textes précités emploient selon les cas, soit les termes « d’ouverture de tout chantier », soit ceux « d’ouverture du chantier », soit encore les termes « déclaration d’ouverture du chantier », soit encore et enfin les termes de « déclaration réglementaire d’ouverture du chantier ».
9. On a déduit de l’ensemble de ces textes, mais aussi par référence aux stipulations des contrats d’assurance eux-mêmes que l’assureur de la responsabilité décennale couvre pour la durée de ladite responsabilité du constructeur concerné, les dommages affectant l’ouvrage construit, depuis la date d’effet du contrat d’assurance à condition toutefois que la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) ait eu lieu postérieurement à la date d’effet du contrat.
Tout chantier ayant fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture de chantier depuis la date d’effet du contrat et avant sa résiliation, entre dans le champ d’application dudit contrat.
Si donc le chantier a été ouvert avant la date de prise d’effet de la garantie, il n’y a pas assurance alors même que la construction aurait été réalisée pendant la vie du contrat (Cass. 1re civ., 10 janvier 1990, RGAT 1990, p. 159, note A. d’Hauteville : cette décision a été rendue en vertu de la stipulation du contrat d’assurance lui-même).
Il en est de même du chantier qui a été ouvert postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance, la Cour Suprême ayant cassé pour violation des articles L. 241-1 et A. 243-1, annexe I du Code des assurances une décision d’une cour d’appel qui avait estimé que « l’ouverture réelle du chantier… » devait être fixée à la date où l’assuré avait signé l’ordre de service définissant les conditions d’exécution du chantier, alors que ladite Cour avait constaté que la déclaration d’ouverture du chantier (DROC) était postérieure à la résiliation du contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 7 mai 2002, Bull. civ. I, no 119 ; RDI 2002, p. 303, obs. G. Leguay ; v. également Gaz. Pal. 2003.I, p. 433, note Courtieu).
Ce dernier arrêt a été l’objet de vives critiques d’une partie de la doctrine notamment de M. G. Courtieu qui en a appelé à la « résistance des juges de renvoi » de la Cour de Bordeaux (G. Courtieu, Appel à la résistance à l’adresse des juges de renvoi).
La 19e Chambre A de la Cour de Paris, a quant à elle le 11 décembre 2002, refusé de prendre en considération la clause d’un contrat d’assurance stipulant « pour que vous soient acquises les garanties, la construction ou les travaux doivent avoir fait l’objet d’une déclaration réglementaire d’ouverture (ou à défaut d’un début d’exécution) entre la date d’effet de la présente convention et celle de la résiliation », la date de la DROC étant en conséquence écartée au prétexte qu’elle « n’est qu’une simple déclaration administrative effectuée unilatéralement par le maître de l’ouvrage, tiers au contrat d’assurance, auprès de la mairie du lieu de la réalisation des ouvrages, dépourvue d’effet juridique à l’égard des exécutants, destinée seulement à marquer la date de démarrage d’un chantier par rapport à la date d’intervention du permis de construire ou encore sa délimitation par rapport à la voie publique (art. R. 421-40 C. urb.) » (CA Paris, 19e ch., sect. A, 11 décembre 2002, RCA 2003, comm. no 79).
10. Dans les circonstances de l’espèce, il est clair qu’au moment de l’intervention en 1989 de la société Plus International précitée (par le biais de son premier sous-traitant le Sieur Jambou qui avait réalisé ab initio les travaux de transformation de la cheminée), celle-ci n’était pas assurée en décennale par l’assureur à l’encontre duquel elle avait exercé un recours en garantie puisque le contrat avait été souscrit à effet du 15 mai 1992, de sorte que la question de savoir si la seconde intervention dudit entrepreneur principal pour les travaux effectués par le biais de son second sous-traitant la société Fouquet en 1994, constituait ou non une ouverture de chantier n’aurait eu d’intérêt que si le travail, confié à ce second sous-traitant, avait été considéré comme constitutif de la construction d’un ouvrage, ce que n’avait pas admis la cour d’appel, néanmoins non critiquée sur ce point par le pourvoi.
Il reste que la validation de l’arrêt de la Cour d’appel par la Cour Suprême procède en la circonstance, de l’esprit qui a animé la jurisprudence sur la prise en compte de la date du fait générateur, issue des arrêts de principe du 19 décembre 1990, jurisprudence dite relative à « clause de réclamation » ou encore « claim’s made ».
Fallait-il pour autant raisonner par référence implicite à l’esprit de cette jurisprudence, et ce alors même que le moyen unique du pourvoi incident n’invoquait pas stricto sensu la violation des textes législatifs ou réglementaires précités mais seulement celle de l’article 1134 du Code civil
En d’autres termes est-on certain que l’esprit de la jurisprudence « claim’s made » dont le but évident était de palier l’inéquité de la clause de réclamation, néanmoins licite à l’époque considérée où il n’existait pas d’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, ait vocation à s’appliquer en matière d’assurance obligatoire dont la durée et le point de départ de ladite durée ne peuvent relever de l’autonomie de la volonté, mais seulement de la loi et ou des textes réglementaires ci-dessus évoqués.
Si l’on raisonne par référence aux textes législatifs ou réglementaires notamment du Code des assurances précités, on est frappé par la différence de la terminologie employée selon que notamment la Loi envisage la couverture d’assurance de la responsabilité décennale d’une part, et la couverture d’assurance de la chose à construire (contrat dommages ouvrage) d’autre part.
On constate en effet que dans le premier cas, la Loi vise « l’ouverture de tout chantier » (art. L. 241-1 C. assur.), tandis que dans le second cas, elle se réfère à « l’ouverture du chantier » (art. L. 242-1 C. assur.).
Doit-on considérer que la première dénomination renvoie nécessairement à la possibilité de plusieurs chantiers correspondant chacun à la première opération de construction ab initio de chaque entrepreneur, constituant en ce qui le concerne l’ouverture du chantier, tandis que la seconde dénomination renverrait nécessairement à l’unicité du chantier
Certes la différence de terminologie ci-avant signalée n’est peut être que le fruit d’une inadvertance, mais il est légitime d’y trouver matière à réflexion ; à cet égard, la dichotomie de la définition de la notion de chantier ou encore de la portée de cette notion selon qu’on est en matière d’assurance de responsabilité ou en matière d’assurance de chose, ne heurte pas a priori le bon sens dès lors qu’en assurance de chose, l’assurance doit être en principe, s’agissant du contrat dommages ouvrage, souscrite « avant l’ouverture de chantier » nécessairement unique puisque visant nécessairement la chose à construire globalement (avant même sa réalisation et les diverses interventions des différents locateurs d’ouvrage), tandis qu’en assurance de responsabilité, il serait logique de considérer que le chantier pour tel ou tel entrepreneur ne peut être que celui qu’il aurait lui-même initié en exécutant ses propres travaux, chantier qu’il aurait en conséquence « ouvert » en quelque sorte, lors de sa première intervention sur le site considéré, et ce sans considération de la date de la DROC, laquelle ne dépend pas de lui, ce qui n’est d’ailleurs pas toujours effectué, à telle enseigne que les contrats d’assurance du marché prévoient d’une manière générale, comme ci-dessus évoqué, que la garantie est due pour les travaux ayant fait l’objet d’une DROC « ou à défaut d’un début d’exécution » entre la date d’effet du contrat d’assurance et celle de sa résiliation.
Une telle solution aurait l’avantage de permettre la couverture d’assurance d’un intervenant sur un chantier important, plusieurs mois, voire plusieurs années après la DROC alors qu’il n’aurait souscrit l’assurance obligatoire que quelques semaines, voire quelques jours, avant son intervention, étant souligné que dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité de la Cour de Paris du 11 décembre 2002, l’entrepreneur concerné était bien intervenu sur le chantier postérieurement à la date d’effet de son contrat d’assurance, lequel était néanmoins lui-même intervenu postérieurement à la DROC, époque à laquelle ledit entrepreneur qui exerçait son activité sous la forme d’une société commerciale, n’avait pas encore constitué ladite société… de sorte que, comme le souligne l’arrêt précité du 11 décembre 2002, retenir dans ces circonstances la date de la DROC, revient à interdire toute intervention sur un chantier important d’une entreprise nouvellement créée.
Mais de fait, la question est extrêmement complexe, car outre qu’indirectement on en reviendrait à retenir la date du fait générateur, dont on sait que depuis la Loi du 1er août 2003 créant un nouvel article L. 124-5 du Code des assurances, il ne serait plus, en matière d’assurance de responsabilité civile en général, toujours le « déclencheur » de la couverture d’assurance qui pourrait être, selon le choix des parties, la date de réclamation, entrent sans doute aussi des questions d’ordre économique liées au régime de la capitalisation qui pourrait conduire à une nécessaire unicité de la notion d’ouverture de chantier pour une même opération de construction envisagée dans sa globalité.
On voit que de quelque côté qu’on aborde le problème, il n’est pas aisé à résoudre facilement.
Nous y reviendrons sans doute, à l’occasion et après approfondissement de certaines des questions ci-dessus simplement évoquées.
Pour l’heure, nous constatons simplement et seulement :
– que la Cour de Paris, dans un arrêt du 20 octobre 1993, a, mais cela était logique et pertinent, pris en compte par référence à l’article 14 précité de la Loi du 4 janvier 1978, la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) et non celle du commencement effectif des travaux pour déterminer le régime de responsabilité applicable (CA Paris, 19e ch., sect. , 20 octobre 1993, Sté HLM Travail et Propriété c/ Sté ERTEC, Juris-Data 1993 no 023353) ;
– que la Cour de Limoges, dans un arrêt du 13 décembre 1988 qui a écarté la garantie d’un assureur au motif que l’entrepreneur n’avait pas rapporté la preuve de l’existence d’une DROC postérieure à la prise d’effet du contrat (CA Limoges, 1re ch., 13 décembre 1988, Calvo c/ AGF, Juris-Data 1988 no 046436) ;
– que la Cour d’Aix-en-Provence a admis la garantie d’un assureur à défaut même de justification d’une DROC dès lors que les travaux exécutés par l’assuré avaient bien commencé avant la résiliation de la police ainsi qu’avait permis de l’établir, à défaut de justification de la DROC, le calcul fait à partir de la date de la réception et du délai contractuellement prévu pour l’exécution des travaux dont s’agit (CA Aix-en-Provence, 3e ch. civ., 18 mai 2000, Compagnie Uni Europe c/ SA Marignan Immobilier, Juris-Data 2000 no 126954) ;
– que la Cour Suprême a validé un arrêt d’une cour d’appel qui, à propos de la garantie de livraison édictée par l’article L. 231-6 du Code de la construction et d’habitation, avait estimé que pour la constatation de l’ouverture du chantier, la date à prendre en considération était celle de la DROC, la date d’exécution des travaux étant indifférente pour la mise en jeu de ladite garantie de livraison contre les risques d’inexécution et de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus (Cass. 3e civ., 26 juin 2002, Bull. civ. III, no 150) ;
– enfin, que l’arrêt ci-dessus évoqué du 29 avril 2003 (Cass. 3e civ., 29 avril 2003, RGDA 2003, p. 512, note H. d’Hauteville) ne condamne pas nécessairement la solution retenue le 7 mai 2002 puisqu’elle ne fait que valider l’interprétation à laquelle le juge du fond avait nécessairement procédé à raison de l’ambiguïté de la clause du contrat d’assurance qui visait « l’ouverture du chantier » sans autre précision, conduisant ledit juge du fond à estimer que « faute d’une clause stipulant explicitement que le « chantier » représente l’ensemble du marché, ni que la date de déclaration administrative d’ouverture constituait la date de référence, seule pouvant être retenue la date du début des travaux de l’assuré qui constituait pour lui le début du chantier » en la circonstance antérieurement à la DROC, mais postérieurement à la prise d’effet du contrat…, mais en la circonstance, la 3e Chambre civile n’a fait que rejeter le grief de dénaturation reproché au juge du fond souverain pour interpréter la convention des parties, sauf bien entendu dénaturation ; si donc la cour d’appel, dont la Cour Suprême n’a fait que contrôler la cohérence du raisonnement et de l’interprétation à laquelle elle s’est nécessairement livrée en raison de son ambiguïté de la clause litigieuse, elle n’a pas pour autant validé nous semble-t-il, l’idée selon laquelle c’est forcément le contrat qui règle la question de la durée de la garantie de l’assureur…
On voit que de quelque manière qu’on aborde la question, celle-ci est extrêmement complexe, l’hésitation étant permise à émettre un avis tranché et définitif sur la question sauf à y revenir ultérieurement comme déjà dit ci-dessus.
P.S.Ce commentaire était achevé lorsque la Cour de cassation a rendu un arrêt le 13 novembre 2003 (Civ. 13 novembre 2003, P + B, no 01-02428).
Cet arrêt tranche la difficulté d’interprétation de l’article L. 241-1 du Code des assurances.
L’hypothèse de cette espèce correspondait à celle décrite au § 10 du présent commentaire à savoir : une DROC, l’intervention d’une première entreprise mise en liquidation judiciaire et la reprise du chantier par une seconde entreprise très postérieure à la DROC. La Compagnie GAN IARD en sa qualité d’assureur décennal de la seconde entreprise formait un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Aix-en-Provence (4 mars 1999) qui avait jugé que l’assureur décennal devait sa garantie.
La Compagnie demandait à ce que l’arrêt choqué de pourvoi soit censuré pour violation des articles 1134 du Code civil et, ensemble, les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances au motif que la Cour avait estimé qu’il était indifférent que la DROC ait été faite avant la prise d’effet du contrat d’assurance décennal conclu par la seconde entreprise dès lors que les travaux avaient été éffectués après cette prise d’effet.
La Cour de cassation dans cet arrêt de principe publié au bulletin confirme l’arrêt d’appel dans les termes suivants : « Mais attendu qu’ayant relevé que la garantie de la compagnie GAN n’était pas sollicitée pour des désordres imputables à la première entreprise ayant réalisée des travaux jusqu’à la date de résiliation du marché du 2 juin 1988, mais pour ceux relevant de la société Sogeba, qui était intervenue postérieurement au 29 juin 1988 après avoir, le 7 juin 1988, souscrit la police, la cour d’appel a retenu à bon droit, que l’application de l’assurance de responsabilité décennale ne pouvait être contestée, malgré l’intervention du premier entrepreneur à une date antérieure ; ».
Il en découle nécessairement que l’expression « l’ouverture de tout chantier » figurant à l’article L. 241-1 du Code des assurances doit s’entendre désormais comme l’ouverture du chantier de l’entreprise concernée, c’est-à-dire, comme nous l’envisagions lors de sa première intervention sur le site.
RGDA 2003-4, p. 750