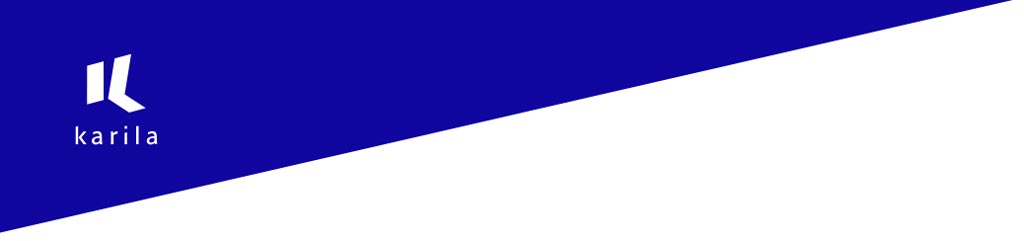Assurance construction RGDA – 01/04/1996 – n° 1996-2 – page 362
Jean-Pierre Karila
Cour de cassation (1re Ch. civ.), 30 janv. 1996, no 93-16493, Compagnie Rhône Méditerranée c/Maison idéale Midi-Pyrénées O.B.A.T. et autres
La Cour,
Attendu que la société Maison idéale a souscrit, le 2 avril 1979, auprès de la compagnie Rhône Méditerranée une « assurance de responsabilité décennale des constructeurs de maisons individuelles » dont les garanties s’appliqueraient aux travaux pour lesquels les marchés avaient été passés ou qui avaient commencé à compter de la date de prise d’effets du contrat fixée au 1er janvier 1979 ; que, toutefois, une clause étendait ces garanties « à des sinistres survenus ou déclarés dont les assurés n’avaient pas connaissance le 1er janvier 1979 et qui concernaient des ouvrages livrés ou réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 » ; qu’à la suite de malfaçons ayant affecté un immeuble dont Mme Gourdel avait, en 1970 et 1971, confié la construction à la société Maison idéale, un premier sinistre s’est produit après la réception, survenue le 19 octobre 1972, et a abouti à un accord aux termes duquel furent réalisés des travaux de réparation et de consolidations, qui firent eux-mêmes l’objet d’une réception le 30 juin 1975 ; que de nouveaux désordres étant apparus, Mme Gourdel a assigné la société Maison idéale, qui a appelé en garantie la compagnie Rhône Méditerranée ; qu’après la condamnation par le premier juge de la société Maison idéale à réparer les malfaçons, et celle de l’assureur à garantir son assurée, cette société a été mise en redressement judiciaire ; que la Cour d’appel a condamné la compagnie d’assurance à indemniser Mme Gourdel sur le fondement de l’action directe invoquée pour la première fois dans les conclusions d’appel de cette dernière ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rhône méditerranée reproche à la Cour d’appel d’avoir, en raison de l’élément nouveau résultant de la mise en redressement judiciaire de la société Maison idéale, déclaré recevable la demande formée en cause d’appel par Mme Gourdel sur le fondement de l’article 555 du nouveau Code de procédure civile, alors que l’assureur était déjà partie en première instance, de sorte qu’aurait été violé l’article 554 du même Code ;
Mais attendu que la mise en redressement judiciaire de la société Maison idéale, postérieurement au jugement la condamnant à réparer les malfaçons affectant l’immeuble de Mme Gourdel, constituait à l’égard de cette dernière une évolution du litige la rendant recevable à demander pour la première fois en cause d’appel, sur le fondement de l’action directe lui appartenant, la condamnation de la société Rhône méditérranée, et cela alors même que cet assureur avait été partie en première instance ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour retenir la garantie de l’assureur, la Cour d’appel a énoncé que le sinistre, objet du litige, était survenu après le 2 avril 1979 date de signature du contrat d’assurance ;
Attendu, cependant, que la garantie de l’assureur ne concernait que les travaux dont les marchés avaient été passés ou l’exécution commencée après le 1er janvier 1979, avec une extension aux ouvrages livrés et réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 ; d’où il suit que la Cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises de la police d’assurance ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Rhône Méditerranée à indemniser Mme Gourdel, l’arrêt rendu le 13 avril 1993, entre les parties, par la Cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Bordeaux ;
I. NOTE
- L’arrêt rapporté est intéressant à double titre. D’abord relativement à la portée de l’article 555 du nouveau code de procédure civile (N.C.P.C.), ensuite relativement à la portée d’une clause du pasé stipulée dans un contrat d’assurance.
- Sur la portée de l’article 555 du NCPC. On sait qu’aux termes de l’article 555 du N.C.P.C. peuvent être appelées pour la première fois devant la Cour d’appel, même aux fins de condamnation, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance quand « l’évolution du litige implique leur mise en cause ».
La notion d’évolution du litige est un concept indéterminé et il a appartenu à la jurisprudence d’en fixer les conditions et limites (sur l’ensemble de la question voir F. Ferrand in Encyclopédie Dalloz, Procédures Civiles verbis appel n° 397 à 418) d’autant plus que le texte susvisé constitue une exception remarquable au principe du double degré de juridiction.
La Cour de cassation semble avoir opté pour une conception restrictive de ladite notion d’évolution du litige.
Sans entrer ici dans l’analyse qui en a été faite par la Cour suprême, on retiendra qu’elle implique l’existence d’un élément nouveau survenu ou révélé postérieurement au jugement de première instance et impliquant ou justifiant la mise en cause d’une partie pour la première fois en cause d’appel.
C’est en application de ce principe qu’une jurisprudence constante déclare recevable le tiers lésé recevable à mettre en cause l’assureur pour la première fois en cause d’appel, lorsque postérieurement au jugement de condamnation de l’assuré, ce dernier est déclaré en état de redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
En revanche, la Cour suprême n’avait pas eu jusqu’ici à apprécier la question de savoir si le tiers lésé pouvait exercer à l’encontre de l’assureur, déjà partie au procès de première instance, ayant abouti au jugement de condamnation de l’assuré, une action directe, l’élément nouveau étant constitué par la mise en redressement judiciaire de l’assuré postérieurement au jugement le condamnant.
Dans les circonstances de l’espèce, l’élément nouveau ci-avant envisagé était avéré mais dès lors que l’assureur était déjà partie au procès de première instance, l’action directe du tiers lésé exercée pour la première fois en cause d’appel, n’entrait pas les strictes prévisions de l’article 555 du N.C.P.C.
La Cour suprême valide cependant un arrêt de la Cour de Toulouse, en énonçant que la mise en redressement judiciaire de l’assuré, postérieurement au jugement le condamnant à réparer les malfaçons affectant l’immeuble du tiers lésé, consitue à l’égard de ce dernier une évolution du litige, le rendant recevable à demander pour la première fois en cause d’appel, sur le fondement de l’action directe lui appartenant, la condamnation de l’assureur, « et cela alors même que cet assureur avait été partie en première instance », c’est-à-dire en définitive sans motiver juridiquement cette validation.
Cette décision tranche avec l’esprit de fermeté animant les solutions antérieures. C’est ainsi notamment que par un arrêt du 15 juillet 1982 (Bull. civ. II, n° 155 ; Rev. trim. de droit civil 1983, obs. R. Perrot, p. 394), la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé à l’encontre d’une décision d’une Cour d’appel qui avait déclaré irrecevable le recours en garantie à l’encontre d’une personne déjà partie en première instance, mais qui n’avait été alors appelée qu’aux seules fins de déclaration de jugement commun.
La solution retenue par l’arrêt rapporté est néanmoins opportune et doit en conséquence être approuvée en ce qu’elle est malgré tout conforme à l’esprit de l’article 555 du N.C.P.C. dans la mesure où ce texte, admettant par exception au principe du double degré de juridiction – en cas d’élément nouveau postérieur au jugement – la mise en cause d’une personne qui n’était pas partie en première instance, on voit mal pourquoi il exclurait une telle solution au seul prétexte que la personne dont s’agit était partie au procès de première instance, sauf bien évidemment à invoquer – ce qui n’a pas été le cas – l’interdiction des demandes nouvelles en appel (article 564 du N.C.P.C.).
L’assureur était en fait, selon nous, mal venu de soulever le moyen tiré du non-respect de l’article 55 du N.C.P.C., tendant en définitive à reprocher à un tiers lésé qui n’y était pas obligé, de n’avoir pas exercé plus tôt une action directe à son encontre, ce dont il s’était, sûrement à l’époque considérée, réjoui…
L’arrêt rapporté invite donc les assureurs, qui y ont à l’évidence intérêt, à poser dès le procès de première instance auquel ils seraient parties, la question de leur garantie.
- Sur la portée de la clause de reprise du passé. Le caractère lacunaire de la cassation prononcée, comme celui de la clause de reprise du passé, conduit pour une meilleure compréhension de la question posée, à reproduire intégralement ci-après le second moyen de cassation, soit :
« Pris de ce que l’arrêt attaqué a reçu l’action directe de Madame Gourdel à l’encontre de la compagnie Rhône Méditerranée et a condamné cette compagnie à consigner la somme de 418 000,00 F actualisée ;
Aux motifs que : « la compagnie d’assurances fait valoir que les conditions particulières du contrat, signé le 2 avril 1979, stipulent une reprise du passé en ces termes :
« Les garanties du présent contrat sont étendues à des sinistres survenus ou déclarés dont les assurés n’avaient pas connaissance le 1er janvier 1979 et qui concernaient des ouvrages livrés et réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 » ;
« La compagnie d’assurances a donc accepté une reprise du passé limitée dans le temps, c’est-à-dire pour les trois années antérieures à la signature du contrat : 1978, 1977 et 1976, la date butoir étant le 31 décembre 1975 ; or l’immeuble de Mme Gourdel a été réceptionné en 1972 et, si l’on tient compte des premiers désordres, au plus tard en juin 1975, c’est-à-dire à une date antérieure au 31 décembre 1975 ; la compagnie d’assurances estime que Mme Gourdel ne peut bénéficier de la reprise du passé ; le sinistre, objet du présent litige, est survenu après le 2 avril 1979, date de signature du contrat d’assurances ; à cette date le premier sinistre a été clôturé par le protocole d’accord du 10 septembre 1974 et il n’existait aucun autre sinistre ; la garantie de la police doit donc jouer pour les désordres ayant fait l’objet de l’assignation du 11 décembre 1981, ces désordres s’étant aggravés en 1989 ; la compagnie d’assurances doit sa garantie ; c’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée » ;
- Alors que, en l’état de tels motifs qui laissent incertaines les stipulations de la police d’assurance en vertu desquelles ladite policedoit jouer pour les désordres ayant fait l’objet de la réclamation judiciaire de Mme Gourdel à l’encontre de la société Maison Idéale, la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil, des articles L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances ;
- Alors que la garantie de reprise du passé qui était stipulée dans les conditions particulières ne pouvant s’appliquer au sinistrelitigieux qui concernait un ouvrage réceptionné avant la date butoir du 31 décembre 1975, la Cour d’appel, en décidant que la compagnie d’assurances devait néanmoins sa garantie, a violé la loi du contrat et l’article 1134 du Code civil ;
- Alors que la police d’assurance ne pouvait non plus jouer par application des garanties moins favorables prévues dans lesconditions générales, prenant effet à la date d’effet du contrat, sous condition que le marché des travaux ait été passé depuis cette même date ; qu’en décidant que la compagnie d’assurances devait sa garantie parce que le sinistre litigieux, constitué par la réclamation judiciaire du 11 décembre 1981, était survenu après la date de signature du contrat, alors qu’elle avait constaté en fait que la société Maison Idéale avait construit la maison de Mme Gourdel suivant contrat du 6 février 1970, et avenant du 24 mars 1971, la Cour d’appel a donc violé l’article 1134 du Code civil et, par fausse application, l’article L. 124-1 du Code des assurances ».
Le litige était donc relatif à des ouvrages réalisés en vertu d’un marché du 6 février 1970 et d’un avenant du 24 mars 1971 et objet d’une réception prononcée le 19 octobre 1972 ; des dommages ayant affectué l’immeuble construit, des travaux de réparation avaient été effectués en exécution d’un protocole d’accord du 10 septembre 1974 et objet d’une réception prononcée le 30 juin 1975.
Les dommages objet de la procédure avaient donné lieu à une réclamation judiciaire du maître de l’ouvrage, initiée le 11 décembre 1981, c’est-à-dire tant après la signature du contrat d’assurance le 2 avril 1979, que de sa date d’effet, au titre de la garantie « normale » ou « de base », soit le 1er janvier 1979.
Il était donc clair, s’agissant d’un ouvrage exécuté avant la date d’effet de la garantie « de base », que le contrat d’assurance n’était susceptible d’application qu’au seul titre de la reprise du passé dans les termes de la clause litigieuse, dont la Cour suprême a estimé que la Cour de Toulouse en avait dénaturé les termes clairs et précis.
La clause litigieuse n’est cependant pas, du moins à une première lecture, d’une clarté évidente, tant en ce qui concerne le membre de phrase « les sinistres survenus ou déclarés dont les assurés n’avaient pas connaissance au 1er janvier 1979 » qu’en ce qui concerne celui relatif au « ouvrages livrés et réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 ».
Une lecture littérale, sans considération du consensus des parties sur la signification du premier membre de phrase précité d’une part, et de l’impérieuse nécessité qu’il n’y ait aucun « trou de garantie » qui aurait vidé la clause de reprise du passé de sa substance d’autre part, peut conduire à une incompréhension totale de la cassation prononcée.
En ce qui concerne le membre de phrase « les sinistres survenus ou déclarés dont les assurés n’avaient pas connaissance au 1er janvier 1979 », la question qui se pose est celle de savoir si la date du 1er janvier 1979 est relative seulement à la date de survenance du sinistre et/ou en outre à l’ignorance des assurés de la survenance dudit sinistre.
Une réponse affirmative conduirait à une absurdité, du moins en ce qui concerne le sinistre « déclaré », tant il est évident que lors de la signature du contrat d’assurance le 2 avril 1979, il ne pouvait y avoir eu de sinistre qui aurait été « déclaré » au 1er janvier 1979, sans que les assurés n’en aient eu connaissance !…
En revanche, si l’on se réfère à la seule date de survenance de sinistre, il est clair que cette date peut se situer tant entre le 1er janvier 1979 et le 2 avril 1979, date de signature du contrat, que postérieurement à cette dernière date, car dans les deux cas, les assurés pouvaient et/ou encore ne pouvaient qu’ignorer le sinistre le 1er janvier 1979.
On doit donc, pour donner un sens à la clause litigieuse, considérer que les sinistres doivent nécessairement être survenus ou déclarés pendant la période de validité du contrat d’une part, et que le sinistre se définit – du moins s’agissant des clauses de reprise du passé – comme la réclamation amiable ou judiciaire, faite à l’assuré par le tiers lésé.
C’est ce qu’a d’ailleurs déjà énoncé la première Chambre civile de la Cour suprême dans un arrêt remarqué du 16 mai 1995 (Bull. civ. I, n° 209, R.G.A.T. 1995.422, note J. Bigot) de façon claire, du moins en ce qui concerne la définition du sinistre dans les assurances de responsabilité, en visant à la fois l’article 1134 du Code civil et l’article L. 124-1 du Code des assurances, lequel, énonce que l’assureur n’est tenu à garantie que si, à la suite du fait dommageable, une réclamation amiable ou judiciaire, est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Le pourvoi, objet de l’arrêt rapporté, visait également les dispositions précitées du Code civil et du Code des assurances, mais en outre l’article L. 124-3 dudit Code, d’ailleurs de façon curieuse, puisque ce texte ne fait que poser le principe selon lequel l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé, tant que celui-ci n’a pas été désintéressé, les conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré, tandis que ce dernier pourrait être responsable sans pour autant être garanti, eu égard aux termes de la clause de reprise du passé.
La Cour suprême dans l’arrêt rapporté ne vise que l’article 1134 du Code civil, mais il est acquis que tant la Cour de Toulouse que les parties au procès ont considéré que le sinistre était bien constitué par la réclamation du tiers lésé.
A ce stade de notre commentaire, il convient de souligner que l’arrêt rapporté ne contredit pas la fameuse jurisprudence relative à la durée de la garantie, après résiliation du contrat, prohibant la clause dite de réclamation.
Le problème de la reprise du passé et celui de la garantie après résiliation, sont d’une nature différente.
Comme l’a relevé Monsieur J. Bigot dans son commentaire précité de l’arrêt du 16 mai 1995, « le premier relève de l’article L. 124-1 du Code des assurances et des clauses contractuelles. Le second du principe établi par la Cour de cassation selon lequel l’assurance s’applique aux faits générateurs survenus pendant le cours de la police ».
Dans ce dernier cas, il importe peu que le dommage survienne postérieurement à la période de validité de la police, dès lors que le fait dommageable ou encore le fait générateur, s’est produit pendant la période de validité du contrat, tandis que dans le second, le fait « générateur » du sinistre et de la garantie consécutive, ne peut être apprécié que par référence à la convention des parties (article 1134 du Code civil) et au principe selon lequel, dans les assurances de responsabilité, c’est la réclamation du tiers lésé qui constitue le sinistre.
C’est probablement pour donner primauté au fait générateur ou pourrait-on encore dire « déclencheur » de la garantie, par référence à sa détermination par les parties elles-mêmes, que la Cour suprême n’examine pas la première branche du second moyen et ne se prononce qu’au regard dudit moyen « pris en ses deuxième et troisième branches » auquel il renvoie.
Il reste à apprécier la signification du membre de phrase « … et qui concerneraient des ouvrages livrés et réceptionnés au plus tard le 31 décembre 1975 » qu’une lecture littérale pourrait dénaturer, ce qui a été le cas de l’espèce. La Cour de Toulouse avait, en effet, implicitement estimé que la reprise du passé s’appliquait aux ouvrages réalisés ou réceptionnés avant le 31 décembre 1975, tandis qu’il était reproché dans la seconde branche du moyen que « la garantie de reprise du passé ne pouvait s’appliquer au sinistre litigieux qui concernait un ouvrage réceptionné avant la date butoir du 31 décembre 1975 ». Les termes « au plus tard » consituent bien une date « butoir », avant laquelle, il ne pouvait y avoir garantie de reprise du passé, dès lors que conformément à l’article 1156 du Code civil, on ne doit pas s’arrêter au sens littéral des termes, mais bien à la commune intention des parties, sans dénaturer, sous prétexte d’interprétation, celle-ci (article 1134 du Code civil).
L’interprétation de la Cour de Toulouse entraînait en outre un double inconvénient. D’abord elle emportait la conséquence que le point de départ de la reprise du passé, sans être stricto sensu indéterminable, pouvait êre situé dans le cas d’un chantier où l’exécution des travaux se serait poursuivie pendant plusieurs années, jusqu’à 10 ans avant le 31 décembre 1975, c’est-à-dire le 31 décembre 1965, ce qui aurait pu être tout à fait exceptionnel pour un contrat signé le 2 avril 1979. Ensuite de laisser un « trou » de garantie pour les années 1976, 1977 et 1978, ce qui est radicalement contraire à l’esprit de toute clause du passé, laquelle est justement stipulée pour éviter un tel inconvénient.
C’est donc à juste titre que l’assureur soutenait que sa reprise du passé était « limitée dans le temps, c’est-à-dire pour les trois années antérieures à la signature du contrat : 1978, 1977 et 1976, la date butoir étant le 31 décembre 1975 ».
On ne peut en conséquence que saluer ici encore, l’esprit de rigueur de la Cour suprême au regard du respect des clauses du contrat d’assurance, tout en soulignant qu’elle a envisagé celles-ci, tant au regard de la garantie que nous avons qualifiée « de base », qu’en ce qui concerne celle de la reprise du passé : la survenance du sinistre, constituée par la réclamation du tiers lésé du 11 décembre 1981, est au regard des deux garanties, située après le 2 avril 1979, date de la signature du contrat, sans pour autant relever d’une des deux garanties.
Le sinistre ne pouvait en effet pas relever de la garantie de reprise du passé puisque l’ouvrage avait été réceptionné avant la date « butoir » du 31 décembre 1975, ni de la garantie « de base » puisque celle-ci n’était susceptible d’application qu’à la condition que le marché de travaux ait été passé depuis la date d’effet du contrat, c’est-à-dire le 1er janvier 1979.
On se hasardera cependant à exprimer un regret tiré du fait que la clause de reprise du passé n’était pas si claire, ni si précise que l’envisage la Cour de cassation.
En réalité la cassation aurait peut-être prononcée non seulement pour violation (implicite) de l’article 1134 du code civil, mais également par application des principes généraux d’interprétation des contrats et notamment par application des articles 1156 et 1162 du Code civil, mais il est vrai que le demandeur au pourvoi n’avait pas invoqué l’application de ces textes, sans doute parce qu’il estimait que la clause litigieuse était claire et précise, opinion qui a été, en la circonstance, partagée par la Cour suprême.