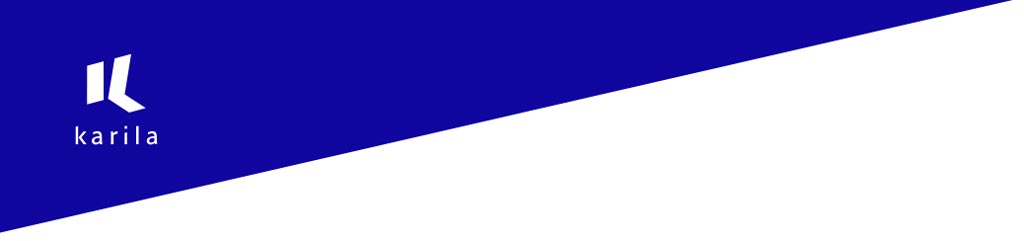Ancien ID : 72
Responsabilité civile décennale
Les équipements participant à un proces industriel et/ou à fonction strictement professionnelle ne relèvent pas du champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil.
« Dès l’instant qu’on ne limite pas les articles 1792 et suivants aux éléments d’équipement à vocation de construction, on ouvre la boite de Pandore !… (Ph. MALINVAUD) »
La 3e Chambre civile de la Cour suprême a rendu, le 22 juillet 1998, Gaz. Pal. 1998.2, panor. Cass. p. 339 / no 358 p. 339 (24/12/98), un arrêt important, l’arrêt SMABTP c. Atelier Danno et autres (Bull. III, no 170) qui a fait l’objet déjà d’un commentaire de M. H. Périnet-Marquet (J.C.P. éd. G. II.10183), dans une affaire où le dysfonctionnement d’une machine à soupe automatisée d’une porcherie, avait eu pour conséquence de rendre celle-ci impropre à sa destination.
Cet arrêt intervient à une époque et dans un contexte jurisprudentiel et factuel, qui nous donne l’occasion de rappeler l’état du droit positif relativement à la question de savoir si des équipements d’un ouvrage immobilier quelconque, que celui-ci soit ou non un bâtiment, entrent ou non dans le champ d’application des responsabilités et garanties spécifiques des locateurs d’ouvrages immobiliers, telles qu’organisées et instituées par la loi du 4 janvier 1978, notamment par les articles 1792 et suivants du Code civil, alors que les équipements considérés n’auraient qu’une fonction professionnelle ou économique.
I. – La position de la doctrine au regard du problème posé.
A. – La problématique.
L’article 1792 du Code civil, en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1978, édicte une responsabilité de plein droit à la charge de tout constructeur (au sens de la loi) d’un ouvrage, en cas de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui « l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1792-2 dudit Code étend la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci sont indissociables au sens de la loi, tandis que l’article 1792-3 du Code civil édicte une garantie biennale de bon fonctionnement des autres éléments d’équipement du bâtiment, c’est-à-dire de ceux qui sont dissociables au sens de la loi.
On sait que la loi du 4 janvier 1978 n’a donné aucune définition de la notion d’élément d’équipement stricto sensu, mais il est clair que l’élément d’équipement s’oppose aux éléments constitutifs de l’ouvrage de l’article 1792 du Code civil d’une part, ainsi qu’aux ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, visés par l’article 1792-2 dudit Code d’autre part.
On observera surtout que la loi ne fait aucune distinction, selon que l’équipement considéré participe ou non à la « fonction construction » de l’ouvrage réalisé, étant rappelé à cet égard que le rapport de la Commission interministérielle présidée par M. Adrien Spinetta, avait dans le cadre de ses propositions, pour une réforme des responsabilités des constructeurs et de leur couverture d’assurance, en ce qui concerne les responsabilités spécifiques des constructeurs, abandonné la distinction entre gros et menus ouvrages de la loi du 3 janvier 1967, et articulé le système des diverses responsabilités et garanties des constructeurs sur une distinction plus subtile et fonctionnelle opposant :
– les ouvrages relevant de la « fonction construction », englobant l’infrastructure, la structure, le clos et le couvert,
– aux ouvrages relevant de la « fonction équipement », incluant tous les aménagements intérieurs de l’espace délimité par le clos et le couvert.
On sait aussi que si l’article 13 du décret du 22 décembre 1967, pris pour l’application de la loi du 3 janvier 1967, seulement en ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation ou à caractéristiques similaires, énonçait que « ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l’entrepreneur installe en l’état où ils lui sont livrés », en revanche, la loi du 4 janvier 1978 n’a nullement prévu une telle éviction du domaine des responsabilités et garanties spécifiques des locateurs d’ouvrages immobiliers.
Or les éléments d’équipements sont le plus souvent des appareils mécaniques ou électriques que l’entrepreneur installe en l’état où ils lui sont livrés, en sorte qu’il n’est nullement discuté en doctrine le fait que relèvent désormais, en application de la loi du 4 janvier 1978, des éléments d’équipement tels que les chaudières, les ascenseurs et monte-charge, mais aussi les appareils électroménagers, lesquels derniers éléments seront la plupart du temps considérés comme des éléments d’équipement relevant normalement de l’application de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code civil, mais peuvent aussi relever du champ d’application de la responsabilité décennale par l’effet de l’article 1792, si leur dysfonctionnement a pour conséquence de rendre l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.
On sait enfin que la loi du 4 janvier 1978, comme il résulte incontestablement de la lecture des débats parlementaires, a eu pour but essentiel de protéger le « consommateur » de logement.
En sorte qu’au lendemain du vote de la loi du 4 janvier 1978, une partie de la doctrine s’était légitimement posée la question de savoir si la notion d’élément d’équipement avait le même contenu, selon que l’équipement considéré était mis en œuvre en l’occasion de la réalisation d’un bâtiment à usage d’habitation ou non, et si, plus précisément il ne fallait pas distinguer, s’agissant d’un bâtiment à usage industriel ou commercial, entre les éléments d’équipement jouant un rôle dans la fonction construction du bâtiment ou ouvrage, et ceux qui ont un rôle purement industriel ou commercial.
« Rendons à César ce qui est à César » : c’est semble-t-il, M. Jean Bigot, qui le premier, a posé le problème dans son ouvrage sur la réforme de l’assurance construction (Ed. Argus 1978, p. 90 et 91), suivi par nous-mêmes dans la première édition de notre ouvrage « Les responsabilités des constructeurs » (Encyclopédie Responsabilités des constructeurs, Encyclopédie Delmas pour la Vie des Affaires, 1re édition 1981, chap. I, p. 129), opinion maintenue dans la seconde édition, chap. J, J 47, p. 225 et 226), et par MM. Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz dans leur ouvrage sur « la promotion immobilière » (précis Dalloz no 144), lesquels tout en reconnaissant que l’éviction des équipements industriels allait de soi dans l’esprit des auteurs du projet de loi, avaient souligné que rien ne permettait de penser qu’elle avait été implicitement adoptée par le législateur, et redoutaient en conséquence que les équipements industriels ne relèvent du champ d’application de la responsabilité décennale. La prédiction de MM. Ph. Malinvaud et Ph. Jestaz s’est réalisée, comme on va le voir.
II. – La solution jurisprudentielle du problème.
A. – Avant 1996.
Nous avions obtenu du Tribunal de grande instance de Paris un jugement le 9 février 1990 (T.G.I. Paris [6e Ch.], Phildard et autres c. Serete et autres inédit, commenté par Ph. Malinvaud et B. Boubli, R.D.I. 1990.497) rendu à propos de dommages affectant les canalisations et tuyauteries d’une teinturerie industrielle, et qui avait admis l’éviction desdits éléments d’équipement industriel, du champ d’application des articles 1792 et suivants du Code civil, dans les termes ci-après rapportés :
« Les dommages dont il est demandé réparation n’atteignent pas les éléments d’équipement d’un bâtiment au sens des articles 1792-2 et suivants du Code civil, car les canalisations qui sont ici atteintes de désordres, ne sont pas destinées à répondre aux contraintes d’exploitation et d’usage d’un bâtiment. »
« Et les textes applicables en la cause ne sont pas les articles 1792 et suivants, issus de la loi du 4 janvier 1978, qui gouvernent le domaine bâti, mais s’agissant en l’espèce de la réparation de désordres atteignant un ouvrage de production ou de traitement industriel, ou son équipement, ceux qui régissent la responsabilité contractuelle de droit commun. »
La Cour de Paris, dans un arrêt du 30 juin 1993 statuant à l’occasion d’un vice de l’équipement de ventilation et de désilage d’un silo à grains, avait débouté le propriétaire dudit silo de son action à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage – mais la question de l’assurance est ici indifférente au regard du problème posé – au motif notamment que la notion d’élément d’équipement ne saurait avoir le même contenu, s’il s’agit d’un local d’habitation ou d’un local industriel ou commercial, qu’il convenait en conséquence « d’interpréter restrictivement ladite notion d’élément d’équipement » , seuls pouvant « bénéficier des procédures spécifiques d’indemnisation, des litiges relatifs à des malfaçons affectant des éléments d’équipement remplissant une fonction dans la construction, par opposition à ceux dont la fonction est purement industrielle. »
Cet arrêt a été cassé par la Cour suprême le 26 mars 1996 dans les conditions que nous examinerons ci-après, étant cependant d’ores et déjà observé qu’alors qu’aucun débat n’avait été instauré devant la Cour de Paris sur la question d’impropriété à destination du silo à grains, en raison du dysfonctionnement de l’équipement considéré, cette question devenait le centre et l’objet principal de celui instauré devant la Cour suprême (premier moyen en sa première branche, second moyen en sa première branche).
B. – Les arrêts de la Cour suprême des 26 mars 1996 et 6 novembre 1996.
1) L’arrêt Letierce et Fils c. UAP de la 1ère Chambre civile du 26 mars 1996
La 1re Chambre civile, dans un arrêt désormais célèbre connu sous son nom d’arrêt Letierce et Fils c. UAP (Cass. 1re civ. 26 mars 1996, Gaz. Pal. 1996.2, somm. p 309 / no 179 p. 31 (27/06/1996), note G.C. [’96/1813(] – Bull. I no 149) a cassé, comme déjà dit, l’arrêt précité de la Cour de Paris du 30 juin 1993, en énonçant en son « chapeau » qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon que les techniques de travaux de bâtiment mises en oeuvre concernent un local d’habitation ou un local industriel ou commercial.
Cet arrêt a provoqué un certain émoi dans le milieu de l’assurance construction, tant chez les assureurs de responsabilité que chez les assureurs suivant police Dommages Ouvrage et a donné lieu à des commentaires, pour la plupart critiques (obs critiques Ph. Malinvaud in R.D.I. 1996.380 ; note critique JP Karila sous l’arrêt in R.D.G.A. 1997.199 ; J. Bigot Plaidoyer pour une limitation de l’obligation d’assurance in Assurance Française no 727, p. 41 ; pour une approbation sans réserve H. Groutel R.C.A. 1996, Chr. p. 26 ; voir également sur la question en général de la définition des ouvrages et équipements exclus du champ des obligations d’assurance G. Leguay R.D.I. 1997.86).
2) L’arrêt de la 3e Chambre civile du 6 novembre 1996.
Quelques mois plus tard, la 3e Chambre civile, dans un arrêt du 6 novembre 1996 (Cass. 3e civ. 6 novembre 1996, R.G.D.A. 1997.502, note JP Karila – R.D.I. 1997.99, obs. G. Leguay), statuant cette fois-ci relativement à la garantie d’un assureur de responsabilité décennale, a rejeté un pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Bourges dans une espèce où il s’agissait aussi notamment du dysfonctionnement d’un équipement industriel, abrité par un bâtiment (il s’agissait de l’insuffisance des machines de production d’électricité d’une micro-centrale électrique), ladite Cour d’appel, ayant considéré que les turbines et alternateurs atteints d’un vice de conception ne constituaient pas des éléments d’équipement d’un bâtiment, le défaut de leur fonctionnement ayant, en outre, pour résultat l’insuffisance de la production électrique n’entrant pas dans l’objet de la garantie de l’assureur de responsabilité décennale.
Il serait excessif d’affirmer que l’arrêt rendu par la 3e Chambre civile, le 6 novembre 1996, s’oppose à celui précité rendu par la 1re Chambre, le 26 mars 1996, dès lors que dans ce dernier arrêt, le vice de l’équipement industriel considéré (ventilation et desilage d’un silo à grains) était avéré, tandis que dans l’arrêt rendu par la 3e Chambre civile, il ne s’agissait que d’une défaillance au regard de la promesse contractuelle ; et alors surtout que dans un cas (1re Chambre), il s’agissait de l’élément d’équipement de l’ouvrage lui-même, considéré par ailleurs comme relevant de l’assurance obligatoire, au prétexte que le silo avait été construit selon les techniques de travaux de bâtiment, tandis que dans l’autre (3e Chambre), la Cour d’appel de Bourges avait souverainement décidé que l’installation de production industrielle d’électricité n’était pas un élément d’équipement du bâtiment lui-même, dont la seule fonction était en définitive d’abriter l’installation dont s’agit.
Il reste cependant que la 3e Chambre civile n’est pas tombée dans le piège de l’impropriété à destination de l’ouvrage dans sa globalité, marquant, selon nous, une certaine résistance par rapport à la solution retenue par la 1e Chambre civile.
C. – En 1998.
1) Les juges du fond.
La Cour d’appel de Reims (C. Reims, 1re sect. 7 janvier 1998, Lamyline, S.A. Marne et Champagne c. SMABTP) a eu également à statuer sur la question de savoir si les équipements industriels d’ouvrages immobiliers, entraient ou non dans le champ d’application de la responsabilité décennale, et par suite, de la couverture d’assurance de cette responsabilité.
Elle y a apporté une réponse négative à propos d’un système d’automatisation d’une cuverie de champagne constituant « un process vinicole », en y énonçant que :
« L’automatisation de la « fabrication »ci-dessus décrite constitue en effet un process industriel de l’extension de cuverie proprement dite » ;
« … Qu’il s’ensuit qu’il ne s’agit pas de travaux de bâtiment ou de génie civil, entrant dans les prévisions de l’article 1792 du Code civil, peu important que la société SPTV ait été également chargée de l’exécution des travaux d’extension de la cuverie dont il résulte clairement des éléments de la cause qu’ils ne sont pas concernés par le litige qui porte exclusivement sur la fiabilité du système automatique de « fabrication » de champagne » ;
« Qu’il ne peut dès lors être soutenu que les défaillances de cet équipement industriel destiné à moderniser la fabrication du champagne, notamment par une réduction de la main d’oeuvre, rendaient impropres à leur destination les cuves elles-mêmes, construites antérieurement et qui sont utilisables sans ce process ».
La Cour d’appel de Reims a souligné dans l’arrêt, dont des extraits ont été ci-dessus rapportés, que l’automatisation de la fabrication du champagne était intervenue postérieurement à l’extension de la cuverie elle-même qui avait été confiée à l’entrepreneur ; elle a également souligné le fait que les cuves étaient utilisables sans ce process.
Néanmoins, il semble que la solution aurait été identique, alors même que l’automatisation aurait été réalisée en même temps que l’extension de la cuverie d’une part, et que la défaillance dudit système d’automatisation aurait rendu inutilisable les cuves à champagne d’autre part, dès lors que ledit système dans son ensemble est totalement étranger au droit de la construction et à la responsabilité décennale des constructeurs.
2) L’arrêt SMABTP et Atelier Danno et autres de la 3e Chambre civile du 22 juillet 1998.
Par l’arrêt précité du 22 juillet 1998, la Cour suprême a entendu limiter l’application des garanties légales aux seuls travaux de construction stricto sensu.
Nous apprécierons ci-après la portée de cet important arrêt de principe (IV)
III. – Le contexte factuel : le rapport du comité Périnet-Marquet et ses suites
Le 13 mai 1997, le ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, en accord avec les ministères de la Justice et de l’Economie et des Finances, constituait un comité restreint de trois juristes, présidé par le professeur Hugues Périnet- Marquet, les deux autres membres dudit Comité étant le professeur Corinne Saint-Alary-Houin d’une part, et le rédacteur de la présente chronique d’autre part, avec pour mission de poursuivre la réflexion engagée par les groupes de travail, en 1996, sur le champ d’application de l’assurance construction obligatoire et de proposer toute solution permettant de circonscrire l’obligation d’assurance, cette proposition devant servir de base à la discussion avec les professionnels en vue de la formulation d’une solution.
Le déficit chronique du secteur de l’assurance construction, mis en relief par des pertes qui se sont élevées de 1983 à 1993 pour un encaissement de primes de l’ordre de 40 millions de francs, tandis qu’en 1994, les pertes se sont élevées à environ 2,8 millions de francs pour un encaissement de 3,2 millions de francs, avait en effet conduit à une concertation en juin 1995 entre assureurs et entrepreneurs, et en février 1996 entre assureurs et maîtres d’ouvrage.
Ces deux ordres de concertation, dont les différents partenaires avaient été réunis, l’initiative du ministère de l’Equipement, dans les locaux dudit ministère, ont abouti à la création d’un certain nombre de groupes de travail en 1996, celui relatif à la clarification des règles des responsabilités des constructeurs et au domaine de l’assurance construction, n’avaient pas permis de dégager une solution recueillant un accord majoritaire et a fortiori unanime.
Le même jour, soit le 13 mai 1997, par arrêté conjoint du ministère de la Justice, du ministère de l’Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, il était constitué une Commission technique de l’assurance Construction avec pour mission :
– d’améliorer et d’élargir la diffusion d’informations sur le régime de responsabilité et d’assurance dans le domaine de la construction, défini par la loi no 78-12 du 4 janvier 1978 ;
– d’étudier les questions posées par la mise en oeuvre du dispositif et de suggérer aux pouvoirs publics toute mesure en cette matière.
Le Comité de juristes présidé par Périnet-Marquet déposait son rapport le 18 décembre 1997 (R.D.I. 1997, p. 1 et suiv. ; R.G.D.A. 1997, p. 171 et suiv.)
Il est notamment apparu aux auteurs dudit rapport que les éléments d’équipement professionnel, fussent-ils installés dans un bâtiment à usage professionnel, n’avaient aucun lien, si ce n’est le lieu de leur installation, avec la construction, leurs fabricants n’étant pas des constructeurs, tandis que les locateurs d’ouvrage procédant à leur installation, ne devaient pas être recherchés sur le fondement des garanties spécifiques édictées par les art. 1792 et suiv. du Code civil.
La nécessité d’exclure de tels éléments d’équipement d’un ouvrage ou d’un bâtiment a conduit, en conséquence les auteurs du rapport, à suggérer la création d’un article 1792-7 du Code civil, à rédaction alternative, selon que seraient ou non supprimés tant dans le Code civil que dans le Code des Assurances, les termes bâtiment ou encore travaux de bâtiment, soit :
• dans la première hypothèse
« Sont considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage, au sens des articles 1792 et 1792-4, ou comme des éléments d’équipement d’un bâtiment au sens des articles 1792-2 et 1792-3, les seuls éléments d’équipement nécessaires à la destination immobilière de cet ouvrage ou de ce bâtiment, à l’exclusion de ceux qui sont spécifiques à l’activité économique devant y être exercée. »
• dans la seconde hypothèse
« Sont considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage, au sens des articles 1792, 1792-3 et 1792-4, les seuls éléments d’équipement nécessaires à la destination immobilière de cet ouvrage, à l’exclusion de ceux qui sont spécifiques à l’activité économique devant y être exercée. »
L’adjectif spécifique visant à limiter au maximum les problèmes de frontière entre ce qui ressort du droit de la construction et ce qui lui est étranger ou encore entre ce qui ressort de la destination strictement immobilière d’une part, et de la destination strictement professionnelle d’autre part.
Le rapport Périnet-Marquet a fait depuis lors l’objet d’une large discussion au sein de la Commission technique de l’assurance construction.
Prenant en compte les travaux considérés (rapport Périnet-Marquet et travaux du Comité de rédaction de la Commission technique de l’assurance construction), le ministère de l’Equipement a proposé, dans le dernier état (version du 5 novembre 1998), la suppression du terme bâtiment visé dans les articles 1792-2 et 1792-3 du Code Civil, et des termes travaux de bâtiment visés dans les articles L 242-1, L 241-1, L 242-2 et L 242-1 du Code des assurances, en les remplaçant par le terme ouvrage, et en conséquence la rédaction d’un article 1792-7 du Code Civil qui serait ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage. »
IV. – La portée de l’arrêt SMABTP/SA Atelier Danno et autres du 22 juillet 1998.
La Cour de Riom, dans un arrêt du 27 avril 1995, avait relevé que le marché conclu entre le maître de l’ouvrage « comprenait non seulement l’édification du bâtiment mais également l’installation d’une machine « à soupe » destinée à assurer l’alimentation automatisée des porcs », puis dit et jugé :
« En conséquence ce matériel, indispensable au fonctionnement de la porcherie dont les caractéristiques – notamment l’existence d’une machine à soupe – avait été contractuellement déterminées par les parties aux termes mêmes du marché, constitue bien un élément d’équipement de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil » .
« Le constructeur est dès lors responsable des dommages liés au dysfonctionnement de ce matériel en application de l’article 1792 du Code civil susvisé, sans même y avoir lieu de rechercher s’il fait indissociablement corps avec le bâtiment » ;
« L’article 1792 du Code civil dispose en effet notamment que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des désordres qui, affectant cet ouvrage dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination », rejetant l’argumentation de l’assureur de l’entreprise qui avait soutenu que la machine à soupe était « un outillage industriel et non un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage. »
En fait, la machine à soupe, pouvait fort bien être considérée comme un élément d’équipement du bâtiment à usage agricole/ industriel que constituait la porcherie, la question de savoir si cet élément d’équipement, était ou non indissociable au sens de l’article 1792-2 du Code civil (et il ne l’était à l’évidence pas), étant indifférente dès lors que les désordres l’affectant rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, et ce conformément au strict texte de l’article 1792 du Code civil et à une jurisprudence constante en la matière (Cass. 3e civ. 23 janvier 1991, Gaz. Pal. 1991.1, panor p. 118 / no 138 p. 14 (18 mai 1991) [’91/1531(] – Bull. civ. III, no 30 ; Cass. 3e civ. 12 juin 1991, Gaz. Pal. 1992.1, somm. p. 2 / no 60 p. 10 (29/02/92), Gaz. Pal. note M. Peisse [’91/3213( – Bull. civ. III, no 167 ; Cass. 3e civ. 14 octobre 1992, Gaz. Pal. 1993.2, somm. p. 540 / no 336 p. 12 (2 décembre 1993), note M. Peisse [’93/1137(] – Bull. civ. III no 267).
La seule question à trancher était en conséquence celle de savoir s’il fallait ou non distinguer selon que l’élément d’équipement considéré remplissait ou non une fonction dans la construction de la porcherie, étant observé que si le législateur de 1978 n’a sûrement pas voulu faire entrer dans le champ d’application de la loi les éléments d’équipement spécifiques à l’activité économique devant être exercée dans l’ouvrage construit, que celui-ci soit ou non un bâtiment, il reste que les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil sont muets sur la question des éléments d’équipement professionnels, industriels ou commerciaux.
C’est cette question que la 3e Chambre civile a tranché de façon indirecte, en cassant au visa de l’article 1792-2 du Code civil la décision de la Cour de Riom, aux considérants ci-après rapportés :
« Attendu que pour condamner l’entrepreneur au titre de la garantie décennale, l’arrêt retient que le marché conclu entre le maître de l’ouvrage et la société Danno comprenait l’édification d’un bâtiment et l’installation d’une machine à soupe automatisée et que ce matériel indispensable au fonctionnement de la porcherie constituait un élément d’équipement dont le mauvais fonctionnement rendait l’ouvrage impropre à sa destination » ;
« Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si le matériel atteint de désordres relevait des travaux de construction faisant l’objet de la garantie légale, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
Le visa de l’article 1792-2 du Code civil peut étonner, dès lors que la Cour de Riom n’avait, quant à elle, retenu l’application de la garantie décennale qu’en fonction de l’article 1792 dudit Code.
Il s’explique cependant par le fait que, très habilement, le demandeur au pourvoi n’avait pas prétendu à la violation de l’article 1792 du Code civil, mais à celle de l’article 1792-2 dudit Code, au prétexte que la machine à soupe automatisée constituait un outillage industriel ou encore un élément d’équipement industriel, et non pas un élément d’équipement du bâtiment que constituait la porcherie.
La Cour suprême statuant dans la limite des moyens qui lui sont soumis, a en conséquence exclu de son raisonnement la question de l’impropriété à destination.
Le matériel « atteint de désordres » dit la Cour suprême, ou encore dont le « le mauvais fonctionnement » pour reprendre la terminologie de la Cour de Riom, pouvait relever soit de l’application de l’article 1792 du Code civil, dans le cadre d’une approche au regard de l’impropriété à destination (c’est la solution retenue par la Cour de Riom,), soit de l’article 1792-2 du Code civil, au cas non avéré, où il aurait été atteint dans sa solidité.
Nonobstant le fait que le pourvoi prétendait à la seule violation de l’article 1792-2 du Code civil, la Cour suprême aurait pu, semble-t-il, casser l’arrêt de la Cour de Riom en énonçant seulement que le matériel « atteint de désordres » ne relevait pas des travaux de construction, objet de la garantie légale des constructeurs, en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil.
Elle ne l’a pas fait, invitant la Cour de renvoi à se poser la question et à la trancher, inévitablement par la négative.
Elle aurait pu aussi – mais en l’état des textes c’eut été plus audacieux – dire qu’il importait peu que le dysfonctionnement du matériel considéré rendît la porcherie industrielle impropre à sa destination, dès lors que l’élément d’équipement considéré était totalement étranger à la « fonction construction » de ladite porcherie et était seulement d’ordre professionnel.
La voie médiane choisie par la 3e Chambre civile présente l’inconvénient ou l’avantage de ne pas entrer en conflit ouvert avec la 1re Chambre civile (laquelle a posé la règle, s’agissant du domaine d’application de l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale, que relèvent dudit domaine non seulement les travaux de bâtiment stricto sensu, mais ceux qui sont réalisés suivant « les techniques de travaux de bâtiment »), encore qu’en la circonstance, il appartenait à la 3e Chambre civile et à elle seule, plutôt qu’en concours avec la 1 re Chambre civile, de définir le domaine d’application des garanties légales des constructeurs d’ouvrages immobiliers.
Dans sa note précitée, sous l’arrêt de la 3e Chambre civile du 22 juillet 1998, Me H. Périnet-Marquet émet l’avis que les positions de la 1re Chambre civile et de la 3e Chambre civile sont parfaitement conciliables, dès lors que dans son arrêt du 26 mars 1996, la 1re Chambre civile n’a nullement dit que les éléments d’équipement industriels ou professionnels devaient être soumis à la garantie décennale , mais seulement qu’aucune distinction ne devait être faite selon que les techniques de travaux de bâtiment mises en oeuvre concernaient un local d’habitation ou un local industriel ou commercial.
En réalité même si par l’arrêt du 22 juillet 1998, la 3e Chambre civile n’entre pas en conflit avec la 1re Chambre civile, puisque les notions de techniques de travaux de bâtiment et de travaux de construction ne s’excluent nullement l’une de l’autre, il est clair, à notre avis, que dans un cas (1re Ch. civ.), l’absence de distinction entre les locaux à usage d’habitation et les locaux à usage commercial ou industriel, conduit de fait à faire entrercass. soc. dans le domaine de la garantie décennale, et donc de l’assurance obligatoire, les dysfonctionnements d’un élément d’équipement industriel ayant pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, tandis que dans l’autre (3e Ch. civ.), la limitation du domaine de la garantie légale des constructeurs aux seuls travaux de construction, doit légitimement conduire – alors même que les dysfonctionnements de l’élément d’équipement industriel ou professionnel rendraient l’ouvrage impropre à sa destination – à son éviction du domaine de la responsabilité décennale des constructeurs et donc de l’assurance obligatoire.
Il est vrai que le critère retenu par la 3e Chambre civile déborde largement la stricte question des éléments d’équipement.
Il est clair également que ledit critère ne posera aucun problème de qualification, lorsqu’il s’agira de la construction d’un ouvrage stricto sensu .
On sait que cette dernière notion est infiniment plus large que celle d’édifice ou de sa sous-catégorie qu’est le bâtiment, et renvoie ce qui est oeuvré par la main de l’homme, comme notamment les travaux de réalisation de voies et réseaux divers (VRD) ou d’un ouvrage d’art comme les ponts et viaducs, mais aussi, si l’on veut aller à l’extrême de la définition, à des travaux de réalisation des parcs, jardins ou terrains de sport, la Cour de Paris ayant, dans un arrêt récent, estimé, à juste titre, que la réfection totale de la pelouse du Parc des Princes, constituait la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil (C. Paris [23e Ch. B], 25, octobre 1998, S.A.S.E.S.E. c. S.C.P. Pernaut-Pernaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Footgreen Sport et autres).
Il faut bien sûr que l’ouvrage soit de nature immobilière, celle-ci se caractérisant par un lien de rattachement au sol ou au sous-sol, ou encore au bâtiment lorsqu’il s’agira d’une partie d’ouvrage,cass. soc. notion qu’il ne faut pas confondre avec celle d’éléments d’équipement, que celui-ci soit dissociable ou indissociable au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil.cass. soc. L’éventuelle difficulté d’application du critère retenu résidera justement dans la question de savoir si les travaux d’installationcass. soc. d’un élément d’équipement constituent ou non des travaux decass. soc. construction.
A priori, la réponse ne peut qu’être négative, s’agissant d’un matériel ou d’une machine que l’entrepreneur installe en l’état, même s’il réalise un support destiné à recevoir ledit matériel ou ladite machine, seule la réalisation du support pouvant constituer la construction d’un ouvrage.
Mais, il est vrai qu’il est arrivé que la jurisprudence assimile la mise en oeuvre d’un ensemble d’éléments d’équipement à la construction d’un ouvrage, comme une installation de chauffage comportant notamment une pompe à chaleur enterrée (Cass. 3e civ. 18 novembre 1992 Gaz. Pal. 1993.1, panor. p. 69 / no 91 p. 69 (1er avril 1993) (’93/1028() – Bull. civ. II no 298) tout en se refusant à une telle assimilation pour des travaux de ravalement ne comportant pas l’adjonction d’un revêtement d’étanchéité (Cass. 3e civ. 5 février 1985, Gaz. Pal. 1985.2, somm. p. 167, note P. Jestaz – Bull. civ. III, no 21), l’admettant dans l’hypothèse contraire (Cass. 3e civ. 3 mai 1990 – Bull. civ. III, no 105 ; Cass. 3e civ. 5 janvier 1994, R.G.A.T. 1994.575, note J.P. Karila), mais l’adoption du critère retenu par la 3e Chambre civile le 22 juillet 1998 devrait conduire désormais, à une approche plus rigoureuse des notions d’ouvrage, de partie d’ouvrage et d’élément d’équipement.
Une telle solution ne conduirait pas pour autant à l’éviction du domaine des garanties légales, l’installation de chauffage ou les travaux de ravalement comportant l’adjonction d’un revêtement d’étanchéité, dès lors que dans les exemples précités, les éléments d’équipement considérés participent bien à la fonction construction de l’ouvrage considéré et sont susceptibles, à l’évidence, de l’application tant des articles 1792-2 et 1792-3 du Code Civil, que celle de l’article 1792 dudit Code, en cas d’impropriété à destination dudit ouvrage dans son ensemble.
Dans d’autres hypothèses, où l’entrepreneur réalisera à la fois des travaux de construction d’un ouvrage d’une part, et d’installation ou de mise en oeuvre d’un élément d’équipement d’autre part, la stricte application du critère retenu par la 3e Chambre civile ne devrait, poser également aucun problème alors même que le juge déciderait d’opérer une dichotomie entre les travaux de construction eux-mêmes et ceux d’installation de l’élément d’équipement considéré, si ce dernier n’a pas une vocation purement professionnelle.
Dans cette hypothèse, le juge raisonnera d’ailleurs, la plupart du temps, de façon « globale », solution qui même si elle n’est pas strictement exempte de critiques, ne lui sera jamais reprochée, si l’ouvrage considéré est à usage d’habitation ou à caractéristique similaire, puisqu’en tout état de cause l’élément d’équipement considéré participera à la fonction construction de l’ouvrage considéré, objet des travaux de construction.
Un exemple récent (Cass. 3e civ. 25 février 1998, Gaz. Pal. 1998.2, somm. p. 605 no 356 p. 7 (22 décembre 1998), note M. Peisse [’98/158(] – Bull. civ. III, no 46) en est donné par la 3e Chambre civile, qui a validé un arrêt de la Cour de Dijon, laquelle avait estimé que l’installation, dans une maison d’habitation existante, par un entrepreneur d’une cheminée intérieure, comportant la création d’un conduit maçonné, d’un système de ventilation et de production d’air chaud et d’une sortie en toiture, constituaient un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
On remarquera à cette occasion que la Cour de Dijon pour admettre l’application de l’article 1792 du Code Civil, y compris en ce qui concerne l’élément d’équipement (système de ventilation et de production d’air chaud à propos duquel d’ailleurs lacass. soc. lecture de l’arrêt ne permet pas de savoir s’il s’agit de fait d’un matériel constituant un élément d’équipement stricto sensu ou seulement d’un dispositif construit), n’a pas retenu, comme l’avait fait la Cour de Riom dans son arrêt cassé par la Cour suprême le 22 juillet 1998, le fait que les travaux de construction stricto sensu et ceux de l’installation de l’élément d’équipement avaient fait l’objet d’un unique marché ; si tel avait été le cas, la 3e Chambre civile aurait probablement condamné ce raisonnement, tout en validant pour les motifs ci-dessus évoqués, l’arrêt de la Cour de Dijon.
L’arrêt SMABTP c. Atelier Danno du 22 juillet 1998 est un arrêt important, qui arrive à point nommé, dans le contexte ci-dessus évoqué des différents projets en cours, en vue d’une clarification du domaine de la responsabilité décennale et de son assurance obligatoire, notamment par la création d’un article 1792-7 du Code civil.
Jean-Pierre Karila – Gazette du palais 1999, doctr. p. 612, J. n°140, 20 mai 1999 page 2