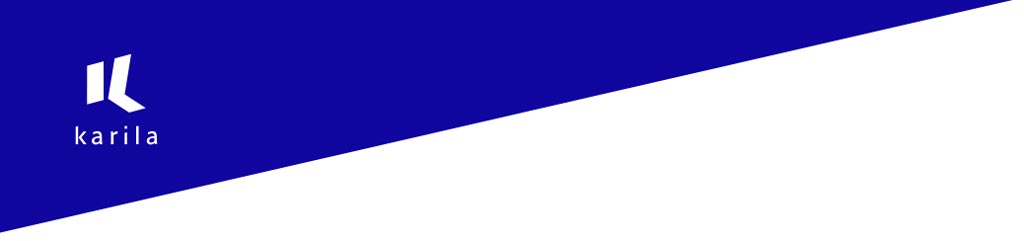Jean-Pierre Karila, Docteur en droit, avocat à la cour, professeur à l’ICH chargé d’enseignement à l’université de Paris I
Les faits de l’espèce rapportée sont les suivants : un sous-traitant bénéficiant du paiement direct, organisé par le titre II de la loi du 31 décembre 1975, exécute des travaux supplémentaires dont il n’arrive pas à obtenir paiement du maître de l’ouvrage public, nonobstant les efforts déployés à cet égard par l’entrepreneur principal.
Le sous-traitant en question assigne en conséquence ledit entrepreneur principal en paiement du coût desdits travaux supplémentaires, et ce sur le fondement de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 qui édicte que l’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours à partir de la réception des pièces justificatives, servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation et que, passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées ; subsidiairement, le sous- traitant invoquait l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause.
La cour d’appel de Paris le déboute de son action au motif que l’article 7 de la loi du 31 décembre 1975 dispose que toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite, qu’il lui incombait donc de mettre en oeuvre d’abord cette procédure à l’encontre du maître de l’ouvrage, débiteur éventuel du paiement, et à qui les travaux ont profité et que, dès lors, la demande formée à l’encontre de l’entrepreneur principal sur le fondement de l’article 8 de la loi et sur l’enrichissement sans cause ne pouvait être déclarée ni recevable ni fondée, faute de respect préalable des dispositions de l’article 7, étant observé notamment que les dispositions de l’article 8 qui règlent les conditions du visa d’acceptation par l’entrepreneur principal des pièces justificatives servant de base au paiement direct ne créent nullement à la charge de ce dernier une obligation de payer le montant des travaux à la place du maître de l’ouvrage.
L’unique moyen de cassation au soutien du pourvoi reprochait à la cour de Paris, d’une part, la violation de l’article 8 précité de la loi du 31 décembre 1975, au motif que dès lors que l’entrepreneur principal n’avait pas respecté les dispositions dudit article il devait être considéré comme ayant accepté tacitement les différentes situations et décomptes qui lui ont été adressés, et condamné à en régler le montant, d’autre part et subsidiairement la violation de l’article 1147 du Code civil, ainsi que de celle de l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975, pour n’avoir pas pris parti dans le délai de quinze jours sur les factures relatives aux travaux supplémentaires, l’entrepreneur principal ayant commis en conséquence une faute à cet égard justifiant sa condamnation au paiement du montant desdits travaux, et enfin un manque de base légale au regard de l’article 1371 du Code civil et des principes régissant l’enrichissement sans cause pour n’avoir pas recherché si les travaux supplémentaires, bien qu’effectués pour le compte du maître de l’ouvrage, n’avaient pas néanmoins, compte tenu du contrat de sous-traitance, profité à l’entrepreneur principal qui a délivré aux dépens du sous-traitant un ouvrage exempt de vices.
La Cour suprême rejette le pourvoi et valide la décision entreprise au motif que l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ne crée pas à la charge de l’entrepreneur principal une obligation de payer des travaux à la place du maître de l’ouvrage qui s’est refusé à le faire, tandis que l’enrichissement sans cause allégué ne pouvait être celui de l’entrepreneur principal et que la responsabilité contractuelle de ce dernier ne pouvait en conséquence être engagée, dès lors qu’il avait transmis toutes les réclamations de son sous-traitant au maître de l’ouvrage et organisé une réunion avec lui sur les travaux en litige et enfin écrit à son sous-traitant que lesdits travaux n’étaient pris en compte par le maître de l’ouvrage qu’à la condition d’avoir été commandés par celui-ci.
On observera que la Cour suprême ne valide pas l’arrêt critiqué sur le fondement de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1975, la référence faite par le juge du fond audit article étant à l’évidence inappropriée, dès lors qu’il n’existait aucune renonciation écrite au paiement direct, d’une part, et que l’institution du paiement direct ne dégage pas l’entrepreneur principal de son obligation de payer, comme on le verra ci-après, d’autre part.
La Cour suprême valide l’arrêt par référence à l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975. Formellement, sa décision n’est pas critiquable, mais n’est-elle pas trop abrupte ?
Il est clair en tout cas qu’elle est dans son principe contraire, du moins formellement :
- à des précédents arrêts rendus par la Cour suprême les 10 mai 1991 (Cass. 3e, Bull. civ. III, n° 131) et 15 janvier 1992 (Cass. 3e civ., Bull. civ. III, n° 20) desquels il résulte que « l’institution dans les marchés passés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques, d’un paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage n’a pas pour effet de décharger l’entrepreneur principal de son obligation au paiement des travaux réalisés » (v. J.-P. Karila, Sous-traitance, JCI Construction, fasc. 207, n° 81) ;
- à la solution retenue par la jurisprudence administrative qui a décidé à l’occasion que le sous-traitant a droit également au paiement direct des travaux supplémentaires, du moins lorsque ceux-ci sont jugés « indispensables » (CE 13 février 1987, Sté Ponticelli, n° 67314, AJDA 1988, p. 15) ou « rendus nécessaires par l’existence d’ouvrages anciens existants à démolir » jusqu’à ce que le sous-traitant ait reçu un ordre de service du maître de l’ouvrage de cesser les travaux (CE 14 novembre 1984, OPHL Paris c/ Entreprise Olivo, Leb. tables p. 670).
Certes, la jurisprudence précitée, relative au fait que l’institution du paiement direct ne décharge pas l’entrepreneur principal de son obligation à paiement, a été rendue ensuite de la défaillance du maître d’ouvrage public qui ne contestait pas la créance du sous-traitant à son égard, tandis que, dans les circonstances de l’espèce, la commune avait contesté devoir payer le coût des travaux supplémentaires au prétexte qu’elle ne les avait pas commandés.
Mais, à notre avis, la solution des arrêts précités du 10 mai 1991 et du 15 janvier 1992 ne doit pas être limitée au cas exceptionnel de la défaillance du maître d’ouvrage public, et devrait pouvoir être appliquée non seulement en cas de résiliation du contrat principal (ce qui était le cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt précité du 15 janvier 1992), mais aussi en cas de travaux supplémentaires, et encore au cas où le sous-traitant prétendrait au bouleversement de l’économie du sous-traité conclu à un prix forfaitaire.
Encore aurait-il fallu que le moyen ait été soulevé… et qu’il eût résulté des faits que lesdits travaux supplémentaires aient été demandés par l’entrepreneur principal.
Cela ne semble pas avoir été le cas, mais dès lors que l’entrepreneur principal n’avait ni transmis les différentes situations et décomptes du sous-traitant à la commune ni pris parti sur leur bien-fondé, mais encore était intervenu auprès du maître de l’ouvrage pour leur paiement, ne pouvait-on pas induire, soit son accord sur l’exécution des travaux supplémentaires, lequel n’avait pas à être donné dans les termes de l’article 1793 du Code civil – inapplicable dans les rapports de l’entrepreneur principal et du sous-traitant (Cass. 3e civ. 15 février 1983, Bull. cass. III, n° 44 ; Cass. 3e civ. 15 décembre 1984, JCP 1985.IV, p. 79 ; CA Paris 23 e ch. B 19 avril 1991, D. 1992, som. p. 116, obs. A. Benabent) – et dont il devait être tenu compte, nonobstant le fait que le bénéficiaire desdits travaux, c’est-à-dire la commune, ne les ait pas commandés, soit sa faute contractuelle, voire quasi délictuelle ?
On observera cependant que la troisième branche de moyen unique indiquait incidemment que lesdits travaux supplémentaires avaient été « effectués pour le compte du maître de l’ouvrage ». Ne faut-il pas lire « au profit du maître de l’ouvrage » ?
Il est difficile de se prononcer sur ce point, mais il est clair que les arguments ci-dessus évoqués auraient pu être soutenus devant le juge du fond.
Enfin, la Cour suprême écarte l’application de la théorie de l’enrichissement sans cause, en observant seulement que l’enrichissement ne pouvait être celui de l’entrepreneur principal, décidant implicitement et nécessairement qu’il ne pouvait être que celui de la commune.
Sur ce dernier point, il serait hâtif de considérer que l’action de in rem verso, dans la présente matière, n’aurait vocation à s’appliquer que dans les seuls rapports du sous-traitant et du maître de l’ouvrage, ladite action étant susceptible d’application également dans les rapports du sous-traitant et de l’entrepreneur principal.
Mais la jurisprudence la plus récente, tant celle rendue dans la première hypothèse que dans la seconde, déclare infondée ladite action au prétexte que l’enrichissement aurait toujours une cause, à savoir le contrat de sous- traitance.
Cette dernière observation nous conduit à nous interroger sur le point de savoir si en définitive, en alléguant que les travaux supplémentaires bien qu’« exécutés pour le compte du maître de l’ouvrage » avaient « néanmoins profité à l’entreprise principale qui a délivré aux dépens » du sous-traitant « un ouvrage exempt de vices », ledit sous-traitant n’avait pas, sans le percevoir sans doute, excipé du caractère « indispensable » desdits travaux « nécessaires » à la perfection de l’ouvrage…
Mots clés : MARCHES, TRAVAUX, RESPONSABILITE * Sous-traitance * Action en paiement à l’encontre de l’entrepreneur principal