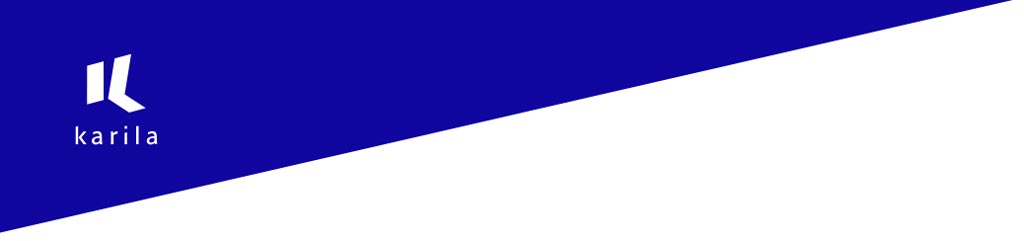Ancien ID : 499
Nature et régime de la responsabilité des constructeurs d’ouvrages immobiliers en cas de faute dolosive (Cass. 3e civ., 27 juin 2001)
Jean-Pierre Karila, Avocat à la Cour, Professeur à l’Institut d’études économiques et juridiques appliquées à la construction et à l’habitat (ICH), Professeur à l’Institut des assurances de Paris (IAP), Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I
Tout est dit par Monsieur l’avocat général Weber dans ses conclusions, au vu desquelles la 3e Chambre civile – aux destinées de laquelle il préside désormais – a rendu l’arrêt rapporté qui, bien que de rejet sur les différents moyens relatifs à la faute dolosive, fera figure d’arrêt de principe.
Tout est dit sur :
– les critiques de la doctrine relativement au caractère artificiel du fondement délictuel de la responsabilité en cas de dol, Monsieur Weber mettant, plus que d’autres, en relief l’ambiguïté de la formulation « sauf dol ou faute extérieure au contrat » impliquant, par elle-même, que le dol ne peut être une faute extérieure au contrat puisqu’elle est exclue de cette catégorie.
– l’opposition de la jurisprudence administrative et de la jurisprudence judiciaire, tant en ce qui concerne la nature de la responsabilité engagée – contractuelle pour la première, délictuelle pour la seconde – qu’en ce qui concerne ce qui en est la conséquence, c’est-à-dire la durée de ladite responsabilité, puisqu’aussi bien depuis la loi du 5 juillet 1985 instituant l’article 2270-1 du code civil, la durée de la responsabilité extra-contractuelle est de 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation tandis que la responsabilité contractuelle est d’une durée de 30 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
Etant rappelé que l’uniformité des délais avant la loi précitée, soit 30 ans dans les deux cas, n’était qu’apparente, la doctrine étant hésitante sur le point de départ de ladite responsabilité : date du fait dommageable, date de la réception ou date de la survenance du dommage , tandis que la jurisprudence ne s’est jamais prononcée à cet égard, car les espèces qui lui étaient soumises lui permettaient de faire l’économie de cette précision puisqu’elles concernaient des dommages qui étaient apparus après l’expiration du délai de l’action en garantie décennale mais jamais de plus de 30 ans après la date du fait dommageable.
– l’absence d’assimilation – à l’inverse du droit commun de la responsabilité – de la faute lourde au dol,
– le fait que, ce qui justifie « la perte de la protection que constitue, pour les locateurs d’ouvrage, le terme du délai de forclusion décennale qui met fin à la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du code civil », c’est seulement la fraude ou la dissimulation.
M. Weber a en conséquence :
– proposé l’abandon de l’exigence de l’intention de nuire, tout en ayant parfaitement conscience qu’un tel abandon pourrait « faciliter à l’excès la remise en cause de la forclusion décennale »,
– proposé, « afin de limiter ce risque », de définir la faute dolosive, permettant de s’affranchir de la forclusion décennale comme celle consistant en la violation délibérée par dissimulation ou fraude des obligations contractuelles.
Cette définition a été adoptée, à un mot près, par l’arrêt rapporté qui reprend les termes « de propos délibéré » utilisés par la 1re Chambre civile présidée par M. Aydalot dans un arrêt du 4 février 1969 qui avait cassé pour la violation de l’article 1150 du code civil un arrêt d’une cour d’appel qui, pour admettre l’efficacité d’une clause pénale et refuser de l’écarter, avait relevé que l’intention de nuire n’était pas démontrée, le chapeau dudit arrêt énonçant que « le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n’est pas édicté par l’intention de nuire »
La Cour suprême énonce donc dans l’arrêt rapporté :
« Mais attendu que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage de sa faute dolosive, lorsque, de propos délibéré même sans intention de nuire, il viole par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles ».
Cette formulation claire et précise constitue un revirement caractérisé de jurisprudence tant en ce qui concerne la nature de la responsabilité engagée en cas de dol, qui est nécessairement contractuelle, qu’en ce qui concerne la définition même de la faute dolosive contractuelle, laquelle n’exige désormais plus la démonstration de l’intention de nuire, mais seulement que la violation consciente/volontaire des obligations contractuelles l’ait été par dissimulation ou par fraude, quels que soient les mobiles de ladite violation.
Ainsi le caractère délibéré de la violation des obligations contractuelles est insuffisant, à lui seul, pour caractériser la faute dolosive laquelle suppose que son auteur ait « de propos délibéré » transgressé/violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou fraude, lesquelles notions étaient retenues dans les décisions consacrant la responsabilité des locateurs d’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à l’occasion – ce qui ne faisait qu’ajouter au caractère artificiel dudit fondement – de manquements contractuels qui étaient alors mis en relief !
Ce sont d’ailleurs ces mêmes notions qu’avait retenu la Cour de Paris pour caractériser la faute dolosive et dire l’action des acquéreurs non prescrite ou encore « plus prescrite » (), sans pour autant qualifier expressément la faute dolosive de contractuelle, ladite faute dolosive ayant été retenue au préjudice du vendeur d’immeuble à construire et des constructeurs pour avoir fait croire que les fondations étaient conformes aux prescriptions contractuelles, alors qu’elles ne l’étaient pas.
La 3e Chambre civile valide donc l’arrêt de la Cour de Paris par substitution ou encore « précision » de motifs quant à la nature de la responsabilité engagée, étant observé que, dans sa définition de la faute dolosive contractuelle, la Cour suprême ne fait pas référence à l’hypothèse où l’inexécution des obligations contractuelles est le résultat de la volonté ou de la simple intention de causer le dommage.
Est-ce à dire qu’une telle volonté implique par elle-même l’intention de nuire, désormais abandonnée ? Rien n’est moins certain : certes, dans la plupart des cas sans doute, la volonté de causer le dommage implique en elle-même l’intention de nuire mais l’assimilation ne peut être érigée en principe comme l’ont relevé de célèbres auteurs (1), qui, il est vrai en matière d’assurance, distinguent l’intention de nuire de la volonté de causer le dommage, laquelle peut être dictée par un autre mobile, ces auteurs distinguant en outre, à juste titre, la faute intentionnelle et le dol, distinction mise en évidence dans un arrêt du 8 octobre 1975 de la 1re Chambre civile cité par Monsieur Weber.
On ajoutera que l’intention/volonté de causer le dommage peut ne pas être clandestine, auquel cas en l’absence de dissimulation, voire de fraude, car la « tromperie » serait en quelque sorte « affichée », il n’y aurait pas, à s’en tenir à la définition donnée par la Cour suprême, faute dolosive.
On aura observé en outre que la Cour suprême s’abstient également de toute référence à la faute lourde, laquelle ne peut et ne doit pas être assimilée – à l’inverse de la solution retenue en droit commun de la responsabilité – au dol, étant rappelé que, selon sa propre formulation, « si lourdes que soient les fautes reprochées par le maître de l’ouvrage à l’architecte ou aux entrepreneurs, relatives à des manquements à leurs obligations contractuelles, l’action en garantie est éteinte après l’expiration du délai de 10 ans » (2) ou encore que, « si lourde que soit la faute, la responsabilité contractuelle de droit commun des architectes, entrepreneurs et autres locateurs d’ouvrage ne peut être invoquée, sauf dol ou faute extérieure au contrat, au-delà des délais prévus à l’article 2270 du code civil, en sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable en la cause, par conséquent, après deux ans à compter de la réception pour les menus ouvrages » (3).
A l’époque considérée le refus d’assimilation de la faute lourde ou dol s’inscrivait dans un contexte où la jurisprudence estimait que la faute dolosive était nécessairement délictuelle.
Est-ce à dire que, dès lors que la faute dolosive est désormais nécessairement contractuelle, toute faute lourde serait équipollente au dol ? Sûrement pas, selon nous, dès lors que ce qui domine et anime l’idée de faute dolosive contractuelle, ce n’est pas tant la gravité de la faute que les conditions de sa réalisation ou plus précisément l’environnement de sa réalisation, c’est-à-dire la dissimulation ou la fraude, quels que soient les mobiles de l’agent fautif ; en ce sens, une faute lourde n’est pas nécessairement commise par dissimulation ou fraude.
De telles réflexions en suscitent d’autres…
Doit-on alors considérer que, pour des dommages à l’ouvrage d’ordre mineur, survenus postérieurement au délai de 10 ans après la réception de l’ouvrage ou objet d’une action judiciaire postérieure à l’expiration dudit délai, il y aurait place pour une action sur le fondement de la faute dolosive contractuelle
La réponse ne peut qu’être affirmative : en tout cas rien n’autorise une réponse négative même si, dans les espèces dans le cadre desquelles le problème de la responsabilité des locateurs d’ouvrages immobiliers, postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans de la garantie décennale, ne s’est posé qu’à propos de dommages graves, de la nature de ceux qui engagent la responsabilité décennale, et non pas à propos de dommages mineurs.
Ainsi la responsabilité contractuelle de droit commun serait susceptible d’application non seulement à l’intérieur du délai décennal pour les dommages mineurs ou dit intermédiaires (4) en cas de faute prouvée, mais aussi postérieurement à l’expiration du délai de 10 ans en cas de faute dolosive contractuelle, caractérisée par la violation délibérée, par dissimulation ou fraude, des obligations contractuelles.
Mais la Cour suprême n’écarte pas pour autant la possibilité de la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle des constructeurs postérieurement à l’expiration de la garantie décennale, en cas « de faute extérieure au contrat », notion introduite par un arrêt du 30 mai 1978 (5), sans doute pour tenter de renforcer le prétendu caractère délictuel de la faute dolosive à laquelle elle était néanmoins opposée…
On peut espérer qu’à la prochaine occasion la Cour suprême abandonne la formule « sauf faute extérieure au contrat » car il s’agit d’un cas d’école et, en tout état de cause, difficilement sinon impossible à qualifier et à caractériser ; d’ailleurs la jurisprudence n’en donne, dans notre matière, aucun exemple positif, la notion n’étant évoquée que de façon négative.
On remarquera enfin que la Cour suprême emploie la formule selon laquelle la cour d’appel « a pu déduire… » et non celle de « a légalement justifié sa décision… » ou encore « a à bon droit (ou exactement) énoncé que… ».
La validation de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, frappé de pourvoi, est en conséquence opérée par suite « d’un contrôle léger », traditionnel d’ailleurs en matière de faute, la Cour vérifiant seulement la cohérence des faits sur lesquels la cour s’est fondée, ledit contrôle léger de motivation n’enlevant rien au principe énoncé dans le « chapeau » de l’arrêt.
Si la validation est intervenue dans les termes ci-dessus rappelés, c’est sans doute en raison – à lire l’arrêt de la Cour de Paris et les différents mémoires produits devant la Cour de cassation – de ce qu’il n’était pas certain que l’entrepreneur et le maître d’oeuvre aient, de facto, commis une faute dolosive, le changement de la nature des fondations ayant été opéré, semble-t-il, sinon avec l’accord exprès du vendeur d’immeuble à construire, du moins en toute connaissance de celui-ci lequel, lors de la vente, puis lors de la réception de l’ouvrage, n’ignorait pas la non-conformité des fondations aux documents contractuels.
En tout cas, si dépassant le cas d’espèce considéré, on devait s’interroger sur ce que serait la juste solution dans le cas ci-avant envisagé, à savoir : inexécution de ses obligations contractuelles par un locateur d’ouvrage, en toute connaissance de cause du maître de l’ouvrage, voire avec l’accord de celui-ci, il est clair que dans une telle hypothèse l’acquéreur de l’ouvrage ne pourrait recourir valablement contre les locateurs d’ouvrage sur le fondement de la faute dolosive contractuelle, en l’absence justement de toute dissimulation ou fraude ; en revanche, l’acquéreur pourrait rechercher son vendeur sur le fondement de la faute dolosive contractuelle si l’inexécution des obligations contractuelles des constructeurs avait été scellée, de propos délibéré, par ledit vendeur, par dissimulation ou fraude. Une telle solution, logique dans la mesure où la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire est « calquée » sur celle du locateur d’ouvrage, ne saurait à notre avis être affectée par le caractère spécifique de la vente d’immeuble à construire qui ne commande l’éviction du droit commun de la vente qu’en ce qui concerne la garantie des vices cachés de la chose vendue, au profit des garanties légales édictées par les articles 1792 et suivants du code civil ; l’arrêt de la Cour de Paris, validé par la Cour suprême, « aligne » d’ailleurs, compte tenu des circonstances de l’espèce, la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire sur celle des locateurs d’ouvrage.
Bien évidemment la cassation est prononcée pour défaut de motivation de la condamnation prononcée à l’encontre des différents assureurs qui avaient soutenu ne pas garantir la faute dolosive. Sur ce point, l’arrêt rapporté ne peut aussi qu’être approuvé ; la cassation était d’ailleurs inévitable, à l’inverse de la solution retenue relativement à la définition de la faute dolosive et à la nature de celle-ci (délictuelle ou contractuelle), Monsieur Weber n’ayant pas exclu dans ses conclusions que la Cour suprême veuille s’en tenir à sa jurisprudence antérieure à cet égard.
Recueil Dalloz 2001, p. 2998